
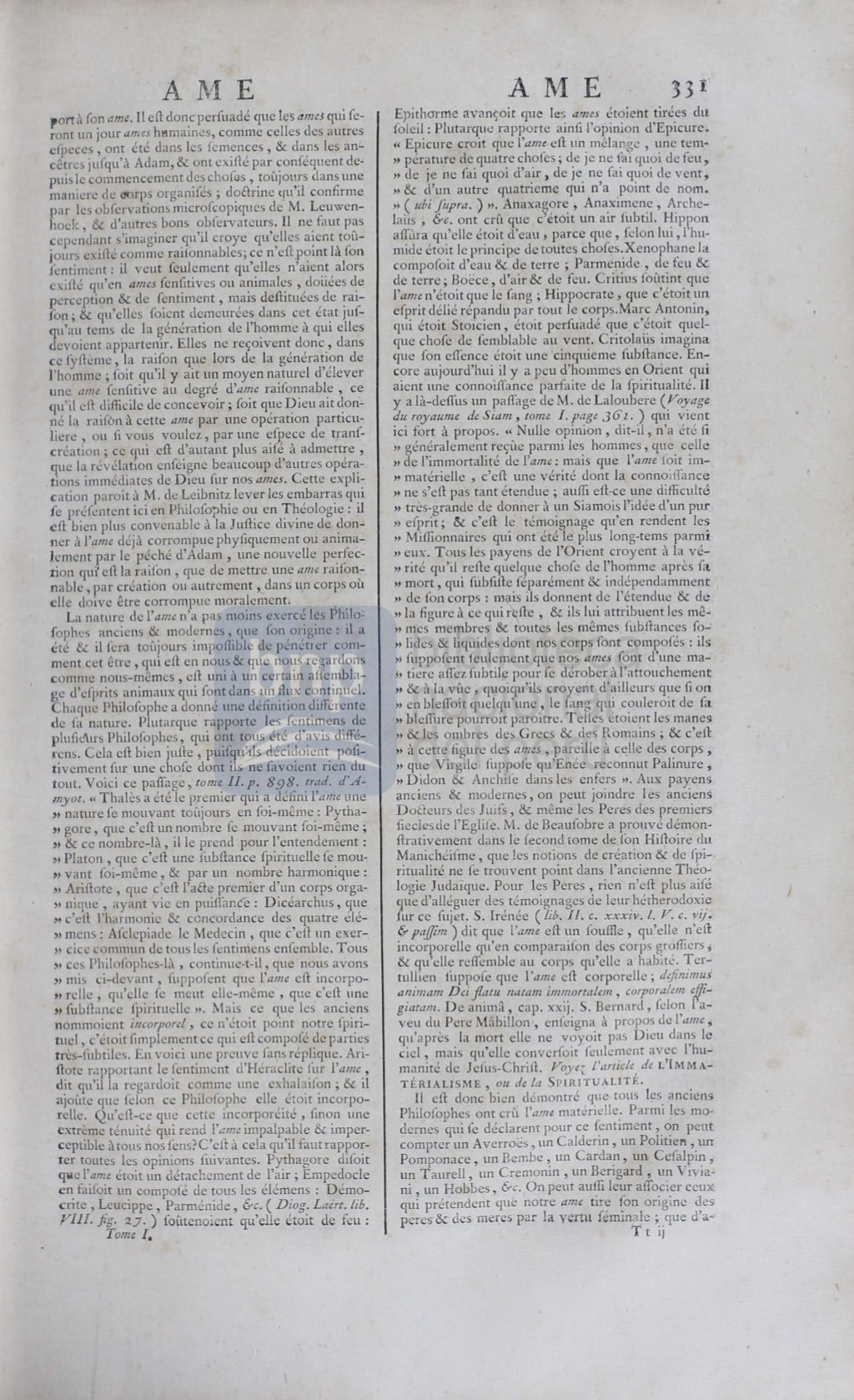
A
1\1 E
porta fon
ame.
Il eftdonc pe¡{uadé que les
ames
qui fe–
ront un jour
tlmes
hl!lmaincs, comme eelles des auues
cfpeces ,ont été dans les femences ,
&
dans les
an~
cetres jufqu'a Adam, & ont exifté par conféquent de–
puis le ommeneement des chofes , tOlljOurS dans une
maniere de oorps organifés ; dofuine tjl,¡'jl confirme
par les obfervations microfeopiques de M. Leuwen–
hoek, & d'autres bons obfervateurs.
Il
ne faut pas
cependant s'imaginer qu'il croye qu'elles aient to\¡–
jours exifté comme rai/onnables;
ce
n'eftpoint la fon
{cntiment: il veut feulement qu'elles n'aient alors
cxifté 'fu'en
ames
fcnfitives ou animales, doiiées de
perception & de fentiment, mais deilituées de rai–
{on; & qu'eIles foient derneur'es dans cet état juf–
qu'au tems de la géneration de I'homme a qui elles
devoient appartenir. Elles ne
re~oivent
donc, dans
ce [yfrcme, la raifon que lors de la genération de
l'homme ; foit qu'il y ait un moyen naturel d'élever
une
tlme
feníitive au degré d'
tlme
raifonnable, ce
qu'il efr difficile de concevoir; foit que Dieu ait don–
ne la raifon a eeUe
ame
par une opération particl1-
Jiere , ou fi vous voulez, par une efpece de tranI–
créalion ; ce qui efr d'aulant plus aifé a admettre ,
que la révelation enfeignc beaucoup d'auues opéra–
rions illlmédiates de Dieu
[ur
nos
tlmes.
Cette expli–
cation parolt a M. de Leibnitz lever les emba¡'ras epú
{e pré(cntent ici en Philofo?hie ou en Théologie : il
eft bien plus convenable
a
la Juiliee divine de don–
ner a
I'mTJe
déja corrompuc phyfiquement ou anima–
lement par le péché d'Adam , une nouvelle perfec–
rion 'luí' efr la raifon , que de meto'e une
tlme
raifon–
nable, par création ou auu'ement , dans un corps Oll
elle doive I!tre corrompue moralementl
.
La nature de l'
tlme
n'a pas moins exercé les Philo!
{ophes anciens
&
modernes, que fon origine: il a
été & il [era tolljours impoíIible de p 'nétrer com–
ment cet erre, qui ea en DOUS
&
que nous regardons
comme
nous-memes , ca uní
a
un cerlain aírembla–
ge d'eljJrits animaux qui [ont dans un flux continuel.
Chaque Philofophe a donné une dé6nition différente
de [¡I nature. Plutarque rapporte les fentimens de
plllfic\u's PhilofophCl.s, qui ont tous été d'avis diffé–
rens. Cela efr bien jnfre , puifqu'ils décidoient pofi–
tivement (ur une chofe dont ils ne favoient rien du
tout. Voici ce paírage,
tome 11.p.
898.
trtul. d'A–
myol.
"Thales a été le premier qui a dé6ni l'
ame
une
" nahlre fe mouvant tOlljours en foi-meme: Pytha–
" gore, quc e'cft un nombre fe mouvant foi-meme ;
" &
ce nombre-la, ille prcnd pour l'entendement :
~,Platon
, que c'efr une ítlbfrance [piritueUe te mou–
"vant foi-mcme,
&
par un nombre harmonique :
.. Arifrote , que c'efr I'alle premier e1'un eorps orga–
.. niquc , ayant vie cn plliflanée: Dicéarchus, 9ue
~
c'en I'harmonic
&
ccncordance des quatre elé–
), mens : Mclcpiade le Medecin , que c'eH un exer–
H
cie eonunun de tous les (entimen en[emble. Tous
), ces Phil%phes-Ia , continue-t-il, que nous avons
"mis ei-devant, [urpo[ent que
I'tlme
cfr incorpo–
tI
relle, qu'elle [e meut elle-meme, que e'eH une
), fubfrance fpirituelle
/l.
Mais ce que les anciens
nommoient
incorpor~l)
ce n'étoit point notre fpiri–
tuel, c'étoit íimplementcc qui efrcompo[é de parties
tres-filbtiles. En voici une preuve fans réplique. Ari–
fiote r;:pportant le fentiment d'Héraclite fm
l'ame,
dit qu'illa regardoit cornme une exhalauon; & il
ajollte que fclon ce Philofophe elle étoit ineorpo–
relle. Qu'eH-ce que cettc incorporéité, finon une
c\.'Trcme ténuité qui rend
1'<11l!~
impalpable & imper–
ceptible a tous nos Icns?C'ef1
a
cela qu'il faut rappor–
ter toures les opinions fuivantes. Pythagore difoit
qlote
rame
étoit un d 'tachemcnt de l'air; Empedocle
en. failoit un eomporé de tous les elémens : Démo–
cnte , Lcuclppe, Parménid
,&c.
(
Diog. Ltlert.
lib.
1"111.
ji;;.
27. )
fOlltenoi
nt
qu'eHe étoit ele feu ;
Tome
1.
AME
Epithorme
¡¡van~oit
ejl-Ie les
ames
étoieht tirées du
foleil: PlutarCfuc rapporte ainÍl l'opinion d'Epicure.
" Epicure croit que
['ame
eH un mclarue , une tel11
4
/1
péranlre de quatre chofes; de je ne
[ai
quoí de feu>
/1
de je ne [ai quoi d'air ) de je ne fai quoi de vent,
/1
& e1'un ¡¡utre quatríeme qui n'a point de nOI11.
" (
ubi
Jnpra.
)
11.
Anaxagore , Anaximene , Arehe–
laits)
&c.
Ont crCI que c'étoit un air íitbtil. Hippon
aír'lra qu'elle étoit d'eau , parce que, [e1on lui, I'hu–
mide étoit le principe de tolItes chofes.Xenophane la
compo[oit d'eau & de terre ; Parmenide , de feu
&
de terre; Boeee, d'air & de feu. Critius [Olltint que
I'mm
n'étoit 9ue le [ang ; Hippocrate, ejl-le c'étoit un
e[prit délié repandu par tout le corps.Marc Antonin,
qui étoit Stolcien, étoit perfuadé que c'étoit quel–
que chofe de femblable au vento Critolaiis imagina
que fon eírence étoit une cinquieme fubfrance. En–
core aujotud'hui il y a peu d'hommes en Orient 'luí
aient une connoiírance parfaite de la {piiitualité.
Il
y a la-deírus un paírage de M. de Laloubere
(Voyage
du royaume de Siam, tome
l.
page
3GI.
)
CfLú vient
iei fort a propos. " Nulle opinion, dit-il, n'a été
íi
" généralement re<;úe parmi les hommes, quc eelle
"de I'immortalité de
l'ame:
mais que
I'ame
loit ím–
" matérielle ) c'efr une vérité dont la eonnoiírance
»
ne s'eft pas tant étendue ; auffi eH-ce une diflieulté
" tres-grande de donner a un Siamois I'idée d'un pur
" efprit;
&
c'efr le témoignage qu'en rendent les
11
Miffionnaires qui ont
eré
le plus long-tems parmi
11
eux. Tous les payehs de l'Orient eroyent a la vé–
"rité qu'il refre quelque chofe de I'homme apres fa
11
mort, ejl-lÍ fub(úle [éparément & indépendamment
" de fon eorps : mais i1s donnent de I'étendue & de
"la 6gtue a ce CfLlÍ
r~ae,
& ils lui attribuent les me–
"mes membres & toutes les memes fubfrances fo–
Il
lides
&
Üquides dont nos corps font compo[és : i1s
" fuppofent [eulement CfLle nos
tlmes
(ont d'une ma–
;, tierc aírez fubtile pour fe dérober a l'attouchement
" &
a
la vlle, quoiCfLI'ils eroyent d'ailleurs que fi
011
11
en bleíroit quelqu'une , le /ang qui eouleroit de fa
11
bleírure pourroit paro'itre.Telles étoient les manes
,,&lcs ombres des Crecs & des Romains; & c'efr
11
a cette 6gtue des
tlmes
,
pareille
a
celle des eorps ,
" que Virgile fuppo/e Cju'Enée reconnut Palinure ,
"Didon
&
Anchi[c dans les enfers
11.
Aux payens
anciens & modernes, on peut joindre les aneiens
D olleurs des Juifs,
&
meme 1es PeTes des premiers
Í1eclc.:sde l'Eglile.
M.
de Beaufobre a prouve c1émon–
fuativement dans le {econd tome de fon Hilloire e1u
Manichéifme, que les notions de création
&
de [pi–
rinlalité ne fe trouvent point dans l'ancienne Théo–
logie ludaiejl-Ie. Pour les Peres , rien n'efr plus aifé
que d'aUéguer des témoignages de lcur hétherodoxie
{ur
ce fujet. S. Irénée
(lib.
ll.
c. xxxiv.
l.
V.
c. vij.
&
p«;[Jim
)
dit que
I'ame
eH un foume, qu'eUe n'eH
incorporelle qu'en eomparaifon des corps groffiers
1
& CfLI'elle reíremble au corps CfLI'elle a habité. Ter–
tullien /tlppofe que
l'ame
ea eorporelle;
deJinimus
animtlm Dei
flata
natam immorttllem, corportllem
efti–
giatam.
De anima, cap. xxij. S. Bernard, [e1on I a-
eu du Pere Mabillon, enfeigna a propas de l'
tlme;
CfLl'apres la mort elle ne voyoit pas Dieu dans le
ciel , mais qu'elle converfoit [eulement avee I'hu–
manité de Jetils-Chrifr.
Voyet L'tlrticle de
L'fMMA–
TÉRIALI ME,
ou
de
la
SPIRITUALITÉ.
II
efr donc bien démontré que tous
I~s
ancien
Philofophes ont cni
l'ame
matérielle. Parmi les mo–
dcrne qui [e déclarent pour ce fentiment, on peut
compter un Averroes, un Calderin, un Politien, un
Pomponace, un Bembe , un Cardan, un Ccfalpin,
un Taurell, un Cremonin , un Berigard, un Vivia–
ni, un Hobbes,
&c.
On pellt auíIi leur aíroeier eeux
qlli prétenelent que notre
tlme
tire fon origine des
p res & d s mer s par la
yernl
fémina
le
;
que
d'a-
Tt
ij
















