
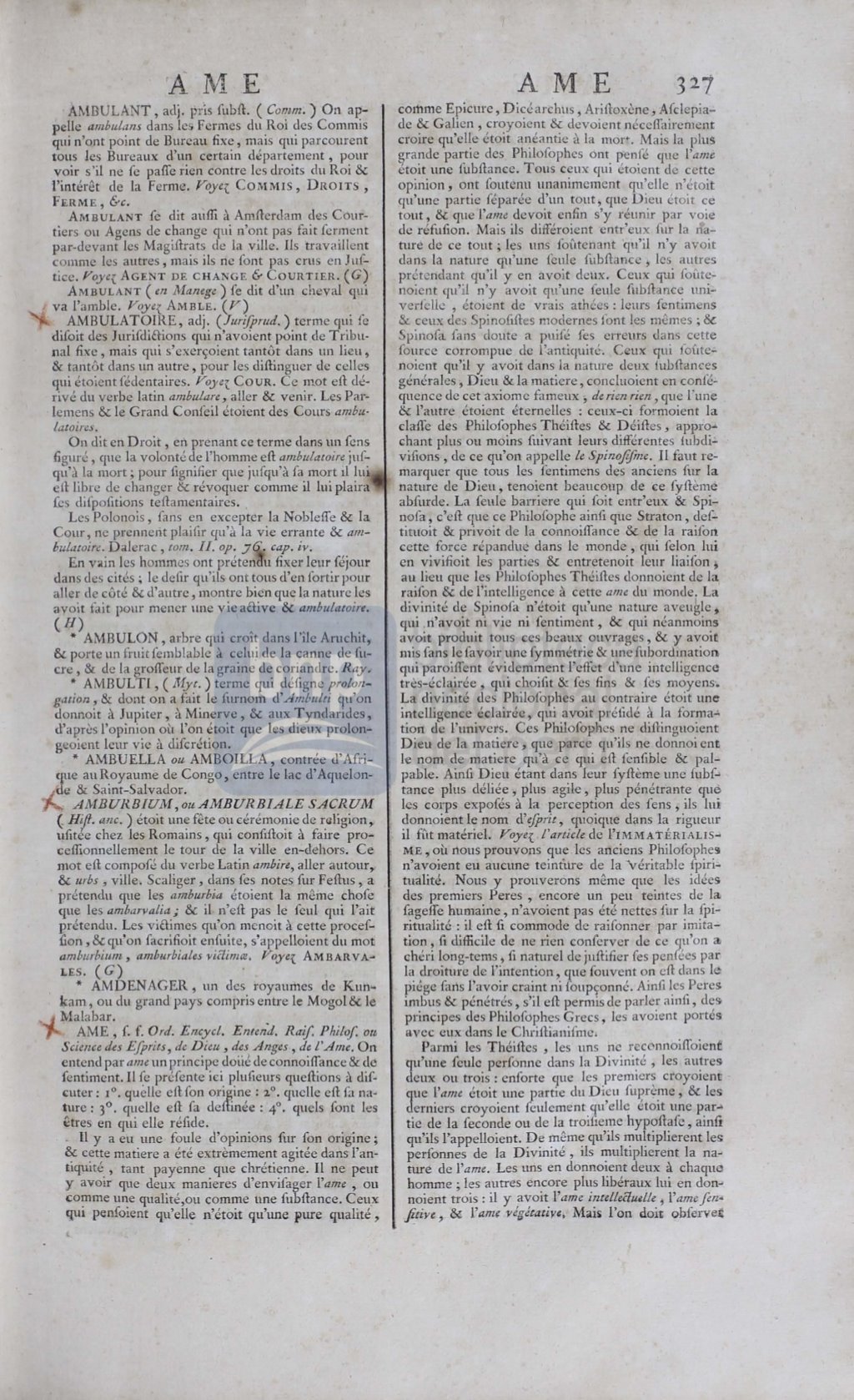
AME
AMBULANT, adj. pris fubfr.
C
Comm.)
On ap–
pelle
ambalans
dans les Fermes du Roi des Commis
qui n'ont point de Bureau fixe, mais qui parcourent
tons les Bureaux d'un certain département, pour
voir s 'il ne fe paífe rien contre les droits du Roi
&
I'intéret de la Ferme.
Voye{
COMMIS, DROITS ,
FERME,
&c.
AM:BULANT fe dit auffi a Amaerelam eles Cour–
tiers ou Agens de change qui n'ont pas fait ferment
par-devanr les Magifuats de la ville. 115 travaillent
comme les autres, mais ils ne font pas crus en Juf–
tice.
l/oye\.
AGENT DE CHANGE
&
COURTlER.
CG)
AMBULANT (
en Manege
)
fe dit d'un cheva! qui
va l'amble.
Voye{
AMBLE.
(V)
AMBULATOIRE, adj.
(Jurifpruá. )
terme qui fe
difoit des Jurifdiétions
qui
n'avoient point de TriDuo
nal fixe, mais qui s'exerc;:oient tantot dans un lieu.
&
tantot dans un autre , pour les diilinguer de celles
qui étoientfédentaires.
Voyet
COUR. Ce mot
ea
dé–
rivé du vel'be latin
ambulare,
aller
&
venir. Les Par–
lemens
&
le Grand Confeil étoient des Cours
ambll'
latolr~s.
On dit en Droit , en prenant ce terme dans un fens
figure. que la volonté de l'homme ea
ambulaLOire
juf–
qu'a la mort; pour íignifier que jufqu'a fa mort 1l1ui
eft libre de changer
&
révoquer comme il lui plaira
fes di(poíitions teaamentaireso
Les Polonois, fans en excepter la NobLeífe
&
la
Cour, ne prellneñt plaiíir qu'a la vie errante
&
alll–
bul,uoir•.
Dalerac ,
tomo
11.
op.
76.
cap. ¿v.
En vain les hommes ont
préten~u
fixer leur féjour
dans des cités ; le deíir qu'ils ont tous d'en fortir pour
a!ler de coté
&
d'autre, montre bien que la natme les
avoit fait pour mener une vie aétive
&
ambulatoire.
CH)
."
*
AMBULON, arbre ql1l crOlt dans l'lle Amchit,
&
porte un fmie femblable a celui de la canne de fu–
cre,
&
de la groífeur de la graine de coriandre.
Ray.
*
AMBULTI, (
1I'fyt.
)
terme qui déíigne
prolon–
gation,
&
dont on a fait le llunom
d'Amb"Lei
qu'on
donnoit a Jupiter, a Minerve,
&
allx Tyndarides,
d'apres I'opinion
Ol!
l'on étoit que les dieux prolon–
geoient leUT vie
a
di[crétion.
*
AMBUELLA
oa
AMBOILLA, contrée el'Afri–
que anRoyaume de Congo, entre le lac d'Aquelon–
de
&
Saint-Salvador.
AMBURBIUM
,
Oll
AMBURBIALE SACRUM
( Hifl.
aflc.
)
étoit une fete ou cérémonie de religion,
uíitle chez les Romains • qui confúl:oit
a
fau'e pro–
ccffionnellement le tour de la ville en-dehors. Ce
mot ea compofé du verbe Latin
amhire,
aller autom,
&
urbs
,
vi!le. Scaliger, dans fes notes fur Feftus, a
prétendu que les
amburbia
étoient la meme chofe
que les
ambarvatia;
&
il n'ea pas le feul qui l'ait
prétendu. Les viilimes qu'on menoit
a
cette procef–
úon,
&
(lu'on facrifioit enfuite, s'appelloient du mot
amburbiwll, amburbiales viaimce. Voye{
AMBARVA-
LES.
(G)
.
*
AMDENAGER. un des royaumes de
KUIl
M
kam. ou du grand pays comprisentre le Mogol
&
le
Malabar.
AME, {. f.
Ord. Encyct. Entend.
RffiJ.
Philo/
Ol¿
Scierzce des EJPrits, de Dieu, des Anges
,
de
L'Ame.
On
entend par
ame
un principe doüé de connoiífance
&
de
{entiment.
11
fe préfente ici pluíieurs queaions
a
dif–
cuter:
1°.
quélle efrfon origine :
2°.
quelle
ea
fa na–
hue: 3°. quelle eft fa deffinée: 4°. quels font les
etres en qui elle réíide.
. Il Y
a eu une foule d'opinions fur fon origine
f
&
cette matiere a été extremement agitée dans l'an–
tiquité. , tant payenne que chrétienne.
Il
ne peut
y
aVOlr que deux manieres d'envifager
I'ame
,
ou
c0!l1me une qualité,ou comme une fubftance. Ceux
qlll
penfoient 'Iu'elle n'étoit qu'une
pure
qualité,
AME
cOlfime Epicure, Dicéarchus, Arifroxene, Afclepia–
de
&
Galien , croyoient
&
devoient néceífairement
croire qu'elle étoit anéantie a la mor>. Mais la plus
qrande partie des Philofophes ont penfé que
I'ame
etoit une (ubftance. Tous ceux qui étoient de cette
opiniol1, ont foutenn unanimement qt¡'elle n'étoit
qu'une partie [éparée d'un tout, que Dieu étoir ce
tout ,
&
qtle
I'ame
devoit enfin s'y réunir par voie
de réfuuon. Mais ils différoient entr'eux fur la na–
ture de ce tout; les uns (olltenant qtl'il n'y avoit
dans la nature q'll'une feule fubfl:ance, les alttres
prétendant qu'il
y
en avoit deux. Ceux
qui
[oute–
noient qu'il n'y avoit qu'une feule í\tbftance uni–
verlelle , étoient de vrais athées: leurs fentimens
&
ceux des Spinofúl:es modernes font les memes ;
&
Spinofa fans donte a puifé fes erreurs dans cette
fource corrompue de l'antiquité. Ceux qui [oÍlte–
noient qu'il y avoit dans la
nat1.uedeux iubaances
générales, Dieu
&
la maciere, concllloient en confé–
quence de cet axiome tameux ,
de
riro rien,
que l'une
&
l'autre étoient éternelles : ceux-ci formoient la
claíre des Philofophes Théiaes
&
Déiaes , appro–
chant plus ou moins fuivant leurs différentes 1ubdi–
viíions , de ce qu'on appelle
Le
Spinofrfrne.
Il
faut re–
marquer qtle tous les íentimens des anciens fm la
nat1.lre de Dieu, tenoient beaucoup de ce fyaeme
abfurde. La feule baniere qui foit entr'eux
&
Spi–
nofa.
c'ea
que ce Philofophe ainíi qtle Straton, def–
tituoit
&
p¡;voit de la connoiífance
&
de la raifon
cette force répandue dans le monde, qui felon luí
en vivifioit les parties
&
entretenoit leur liaifon,
au lieu que les Philofophes Théiaes donnoient de la
raifon
&
de l'intelligence a cette
ame
du monde. La
divinité de Spinofa n'étoit qu'une natme aveugle.
qui n'avoit ni vie ni fentirnent,
&
qui néanmoins
avoit produit tous ces beaux ouvrages,
&
~
avoie
mis fans le favoir une fymmétrie
&
une fubordIllation.
qtu paroiífent évidemment l'elret d'une intelligence
, tres-éclairée. qui choifit
&
fes fins
&
[es moyens.
La divinité des Plúlofophes au contraire étoit une
intelligence éclainíe, qui avoit préíidé
11
la forma–
tion de I'universo Ces Philofophes ne diftinguoient
Dieu de la mariere, qtle parce qu'ils ne donnoi ent
le nom de matiere qtl'a ce qtIÍ
ea
fenfible
&
pal–
pable. Ainu Dieu étant dans leur fyaeme une [ub[ ...
tance plus déliée, plus agile. plus pénétrante que
les corps expofés
a
la perception des fens ; ils lui
donnoient le nom
d'eJPrit,
qtlOique dans la rigueul"
il fl"tt matériel.
Voye{ l'articLe
de l'Il\1MATÉRIALJS'"
ME, Ol!
rtous pronvons que les anciens Philofophe9
n'avoient eu aucune teinture de la véritable fpiri–
tualité. Nous y prouverons meme que les idées
des premiers Peres • encore un peu teilites de la.
fageífe humaine , n'avoient pas été nettes
[UT
la fpi–
riülalité : il ea íi commode de raifonner par imita–
tion, íi difficile de ne rien conferver de ce qu'on
a;
chéri long-tems , fi naturel de juftifier fes penfées par
la droiture de l'intention, que fouvent on ea dans le
piége fans I'avoir craint ni foupc;:onné. Ainíi les Peres
imbus
&
pénétrés , s'il efr permis de parler ainfi, des–
principes des Philo[ophes Grecs, les avoient portés·
avec eux dans le Clu·iaiani[me.
Parnú les Théilles , les uns ne reconnoilToienf
qu'une feule perfonne dans la
Divini~é
, les
au~res
deux ou trois : enforte que les premters croyOlent
que
l'ame
étoit une parrie du Dieu fupreme,
&
les
derniers croyoient feulement qll'elle étoit une par'"
tie de la feconde ou de la troiíieme hypofrafe , ainíi
qtl'ils I'appelloient. De meme qu'ils mllltiplierent les
perfonnes de la Divinité, ils multiplierent la na–
ture de l'
ame.
Les uns en donnoient deux achaque
homme ; les autres encore plus libéraux lui en
don~
noient trois:
il
y avoit
l'ame inteLLecbuLLe ,I'amcfen–
Jitiye,
&
l'amr
yégécatiye,
Mais ron
doit obfervell
















