
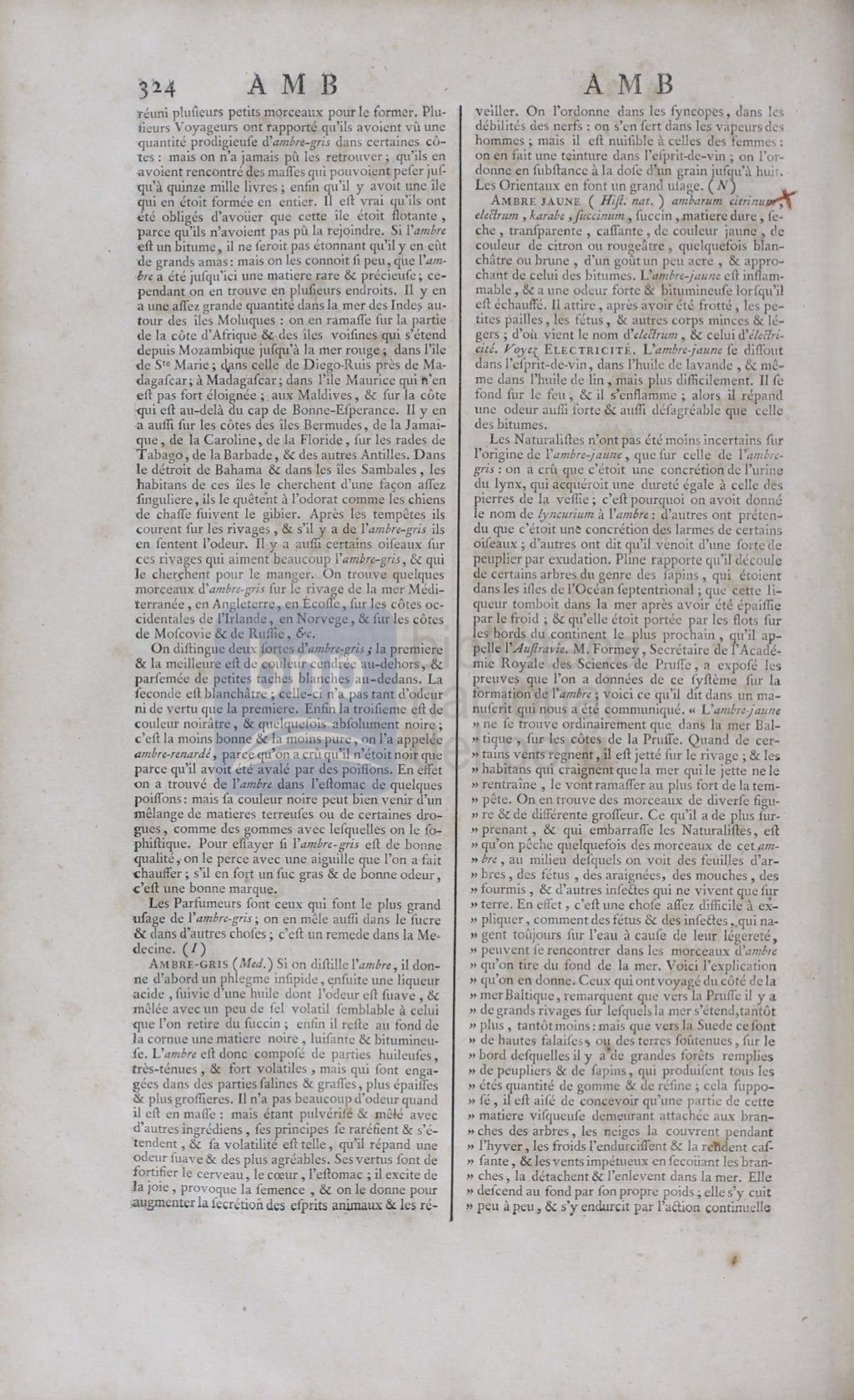
AMB
réuni pluúeurs petits morceaux ponr le former. Pln–
íieurs Voyageurs ont rapporté qu'ils avoient
Vl1
une
quantiré prodigieufe
d'ambre-gris
dans cerraines co–
les: mais on n'a jamais pil les retrouver; qu'ils. en
~voient
rencontre des maífes qui pouvoient pefer ¡uf–
c:¡u:a
qu~m;~
mille ,livres ;
e~l/in
qu'il y a'.'oir
~:ne
¡le
9111 en etolt formee en enner. 11 eft
VTal
qu ils ont
eté obligés d'avoiier que cette Ile étoit flotante,
paree qu'ils n'avoient pas pilla rejoindre. Si
l'ambre
eíl: un bitume, il ne feroit pas étonnant qu'il
y
en ellt
de grands amas: mais on les connoit ft peu, que
l'am-
1m
a été jufqu'ici lme matiere rare
&
précieufe; ce–
pendant on en trouve en plufteurs endroits. Il
y
en
a lme aífez grande quantité dans la mer des Indes au–
tour des ües Moluques : on en ramaífe fur la partie
de la cOte d'Afrique
&
des ües voiíines qui s'étend
depuis Mozambique jufqu'a la mer rouge; dans l'ile
de Sto Marie; clans celle de Diego-Rlús pres de Ma–
dagafcar; a Madagafcar; dans l'ile Maurice qui n'en
eíl: pas fort éloignée ; aux Maldives,
&
[ur la cote
qui eíl: au-dcla dn cap de Bonne-Efperance. Il
y
en
-a auffi íilr les cotes des iles Bermndes, de la
J
ama'i–
C]1le , de la Caroline, de la Floride, fur les rades de
T abago, de la Barbade,
&
des autres Antilles.D ans
le détroit de Bahama
&
dans les ües Sambales, les
habitans de ces ües le cherchent d'une fas:on aífez
fUlguliere , ils le quete'nt a I'odorat comme les chiens
de charre [uivent le gibier.
Apn~s
les tempetes ils
courent [ur les rivages ,
&
s'il
y
a de
l'ambre-gris
ils
en [entent l'odeur. 11 y a auffi certains oifeaux [ur
ces rivages qui aiment beaucoup
l'ambre-gris,
&
qui
le chershent pour le manger. On trouve quelques
morceaux
d'ambre-gris
fur le
riva~e
de la mer Médi–
terranée , en Angleterre , en ÉcofIe, fur les cotes oc–
cidentales de l'Irlande, en Norvege,
&
fur les cotes
de Mofcovie
&
de Ruffie,
&e.
On diíl:ingue deux fortes d'
ambre-gris;
la premiere
&
la meilleure eíl: de couleur cendrée au-dehors,
&
parfemée de petites taches blanches au-dedans. La
{econde eíl: blanchatre ; celle-ci n'a pas tant d'odeur
ni
de vertu que la premiere. Ennn la troilieme eíl: de
coulenr noiratre,
&
C]1lelc¡uefois abfolument noire;
c'eíl: la moins bonne
&
la moins pure, on I'a appelée
ambre-renardé,
paree qu'on a cnl qn'il n'étoit noir C]1le
paree qu'il avoit été avalé par des poiífons. En effet
on a trouvé de
l'ambre
dans l'eíl:omac de ql1elques
poirrons: mais [a couleur noire peut bien venir d'un
melange de matieres terreufes ou de certaines dro–
gues , comme des gommes avee lefquelles on le fo–
phiftique. Pour errayer íi
l'ambre-gris
eíl: de bonne
qnalité, on le perce avec une aiguille qne l'on a fait
'Chauffer; s'il en fort un fue gras
&
de bonne odeur ,
-c'eft une bonne marque.
Les Parfumeurs font ceux qui font le plus grand
l.úage de l'
ambre-gris;
on en
m~le
auffi dans le fuere
&
dans d'autres chofes; c'eíl: un remede dans la Me–
decine.
(1)
AMBRE-GRlS
(Med.) Si
on diíl:ille
I'ambre,
il don–
ne d'abord un phlegme iníipide, enfuite une Iiqueur
acide , flúvie d'une huile dont l'odeur eíl: fuave ,
&
melée avec un peu de fel volatil femblable a celui
C]1le l'on retire du fuccin; en6.n il reíl:e an fond de
la COl"lllle une matiere noire, luifante
&
bitumÍneu–
fe. L'
arnbr¿
eíl: done compofé de parties huileufes,
td:s-ténues ,
&
fort volatiles , mais qui font enga–
gées dans des parties falines
&
graífes, plus épaiífes
&
plus groflieres. 11 n'a pas beaucoup d'odeur quand
il efi en mafie: mais étant pulvérilc
&
mSjé avec
d'autres ingrédiens , fes principes fe rarénent
&
s'é–
tendent ,
&
{a volatilite eíl: telle, qu'il répand une
ode~
fuave
&
des plus agréables. Ses vertus font de
fo~u~er
le cerveau, le coeur , I'eíl:omac ; il excite de
la ¡Ole, provoque la femence ,
&
on le donne pour
augmenter la [eer
rion
des efprits animaux
&
les ré-
A MB
veiller. On l'ordonne dans les fyncopes, dans \es
débilités des nerfs : on s'en [ert dans les vapeurs de'
hommes ; mais il eíl: nuiíible a celles des
femmc~:
on en fait une tcinture dans I'efprit-de-\'in ; on 1'0r–
elonne en fubíl:ance
a
la dofe d'un grain jufqll'a hui .
Les Orientaux en font un granel u{age. (
N )
AMBRE
JAUNE (
Hift. nato
)
ambarum
eitrinu~
eleélrurn
,
karabe ,jilccinum
,
fuccin, matiere dure, fe–
che, tranfparente , caífante, de coulcur jaune , ele
cOluelU de citron ou
rouge~trc,
(JllelC(1.1efois blan–
chatre ou bmne , d'un gOtlt un pcu acre,
&
appro–
chant de celui des biulmes. L'
amhrE-jtl1l71e
eíl: inflam–
mable ,
&
a une odeur forte
&
birumineufc lorfqu'il
eíl: échauffé. II attire , apres ayoir été frotté, les pe–
tites pailles, les féms,
&
autres corps minces
&
lé–
gers; d'oll vient le nom
d'eleélrum,
&
celui
d'¿teélri–
cité.
VoyC{
ELECTRJCITÉ.
L'ambr~-jaune
fe dirrout
dans I'erprit-de-vin, dans I'huile de lavande ,
&
me–
me dans l'huile de !in, mais plus difficilement. Il fe
fond fUf le feu,
&
il s'enf1amme ; alors il répand
une odeur auffi Corte
&
altffi défagléable que celle
des biulmes.
Les NatlU'aliíl:es n'ont pas été moins inccrtains fur
l'originc de
l'ambre-jaune,
que fuI' celle de
I'tlmbr.–
gris:
on a crit que c'étoit une concrétion de I'mine
du lynx, qui acquéroit une dlu'eté égale
a
celle des
pierres de la veffie; c'eíl: pOUTquoi on avoit donné
le nom de
lylleuriwn
a
l'ambre:
d'autres ont préten–
du que c'étoit une concrétion des larmes de celtains
oifeallx; d'auu'es ont dit qu'il venoít d'llne [orte de
pellp!ier par exudation. Pline rapporte C(u'il décOlue
de certains arbres du genre des úlpins, qui étoient
dans les ifles de l'Océan feptentrional ; que cette li–
queur tomboit dans la mer apres avoir été épaiffie
par le froid ;
&
qu'elle étoit portée par les flots fur
les bords du continent le plus prochain , qn'il ap–
pelle
l'AuJlravie.
M. Formey, Secrétaire de l'Acadé–
mie Royale des Sciences de Pmífe, a expofé les
preuves que I'on a données de ce fyfteme [ur la
formation de
I'ambre;
voici ce qu'il da dans un ma–
nufcrit qui nous a été communiqué. "
L'ambrl-jaune
»
ne fe trouve ordinairement que dans la mer Bal–
" tique, fur les cotes de la Pmífe. Quand de cer–
" tains vents regnent, il eft jetté fUI" le rivage ;
&
les
" habitans qui craignent que la mer C]1li le jette ne le
»
rentraine , le vont ramaífer au plus fort de la tem–
" pete.
00
en trouve des morceaux de diver[e /iau–
"re
&
de différente groífeur. Ce C]11'il a de plus lilr–
»
prenant,
&
qui embarraífc les Naturaliíl:es, eíl:
" qu'on p&che quelquefois des morceaux de cet
fllll–
" br¿
,
au milieu defquels on voit des feuilIes d'ar–
»
bres , des fétus , des araignées, des mOllches , des
»
fourmis ,
&
d'aut:res infeél:es C¡lÚ ne vivent que fur
"terre. En eftct, c'eíl: une chofe arrez difficile
a
e~" pliqucr, comment des fétus
&
des in[eél:es ,.qui na–
" gent tOiljOurS fUT l'eau
a
caufe de leur légereté ,
" peuvent fe rencontrer dans les morcealLX
d'amble
"qu'on tire du fond de la mero
Voici
l'explication
»
qu'on en donne, Ceux qtúontvoyagé du coté de la
}) merBaltique, remarqtlent qtle vers
la
Pmífe il ya
" de grands rivages [ur lefqtlelsla mer s'étend,tantot
"plus, tantotmoins: mais qtle vers la Suede ce font
" de hautes falaifes,> ou des terres fOlltenues, fUT le
"bord defquelles il y a'de grandes forcts rcmplies
" de peupliers
&
de fapins, c¡ui produifent tous les
" étés quantité de gomme
&
de réíine ; cela íilppo–
" fé , il eíl: aifé de concevoir qtl'une partie de cette
" matiere vifqueufe demeurant attachée aux bran–
»ches des arbres, les neiges la COUVTent pendant
" l'hyver, les froids l'endurciífent
&
la rcndent caf–
" fante,
&
lesvents impétueux en fecoiiant lesbran-
)) ches, la détachent
&
I'enlevent dans la mero Elle
)) defcend au fond par fon propre poids ; elle s'y cuit
»
peu
a
peu ,
&
s'y endurcit par l'aétion contiml lle
















