
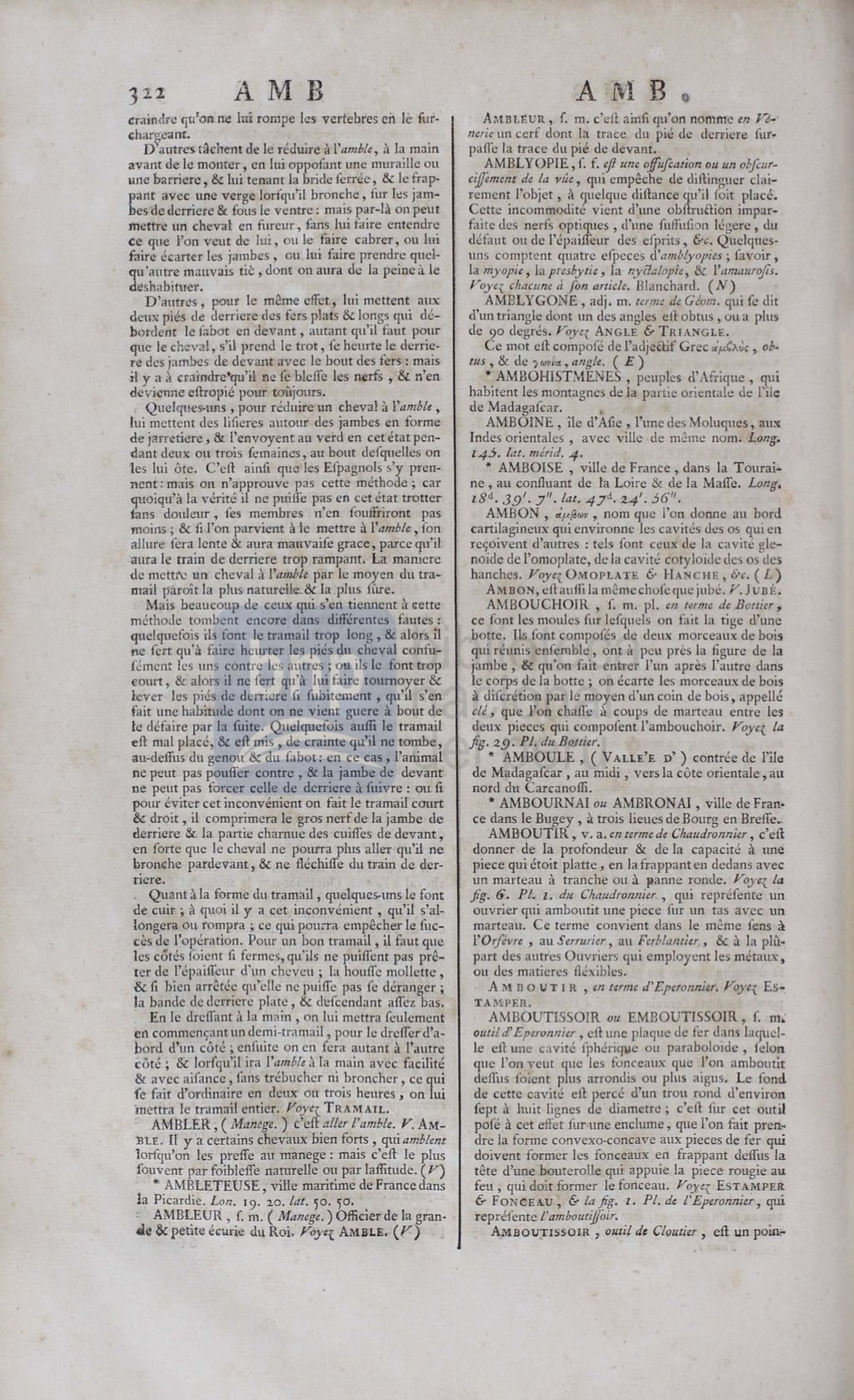
AME
I>raiFlClre
qu'QDtM
h:ci: rompe les vertebres eñ le fur–
I>har~eant.
D
autres tflchent de le réduire 11 l'
amble,
a
la main
avant de le monter , en lui oppo{ant une muraille on
une barriere, &
hú
tenant la bride {emie,
&
le frap–
panr avec une verge lorfqu'il bronche ,
{ur
lt:!s jam–
bes de !lerriere
&
fous le ventre; mais par-la on peut
mettre un cheval en fureUl', fans lui faire entendre
ce que l'on veut de lui, ou le faire cabrer, Oll lui
faire é,aner les jambes,
on
hú faire prendre quel–
qll'antre mauvais
tic,
dont on aura de la peine
a
le
deshabituer.
D'antres, fXlun le
m~me
eff'et, lui mettent amc
deux piés de derriere des fers plats
&
longs qui dé–
bordellt le fabot en devant, autant qu'il faut pour
que le chevaL, s'il prend le trot, fe heurte
le
dcrrie–
re des jambes
de
devant avec le bout des fers ; mais
~l
y a
a
crai'mlre'qu'il lile {e bleífe les nerfs ,
&
n'en
devienne efiropié pour
tm~oms.
Quelques'l1lls , ponr réduire un cheval
a
l'
amble,
lui mettent des lifieres autour des jambes en forme
de jarretiere,
&
l'envoyent au verd en cet état pen–
~ant
deux ou trois femaines, au b0t1t de{queUes on
1es lui ote. C'efi ainii que les Efpagnols s'y pren–
nent: mals on n'approllve pas cette méthode; cal'
quoiqu'a la vérité il ne pl1iífe pas en cet état trotter
kas douleur, {es membres n'en {ouft"riront pas
J11oins;
&
fi 1'on parvient
a
le mettre
a
l'ambLe,
{on
allure {era lente
&
a11ra manvaife grace, parce qu'il.
'aura le train de derriere trop rampant. La maniere
de mettl'c lJIn cheval a
1'amble
par le moyen du tra–
mall párolt la plus natutel!le.& la plus {(¡re.
Mais beaucou¡;> de ceux qui s'en tiennent
a
¡¡ette
méthode tombent encore daos cWférentes fautes
¡
quelquefois
115
font le tramail trop long,
&
alors
il
ne {en qu'a fa.ixe hemter
l~s
piés du cheval confu–
{ément les uns contre les autres ;
OH
ils
le font t!rop
€ourt,
&
alors il ne
{ert
qu'a l\ú faire toumoyer
&
lever les
pi.ésde derriere fi {ubitement, qu'il s'en
fait Une habmlde dont on ne vient guere
a
bout
d~
le
défaire par la fuite. Quelquefois auffi le tramail
efi mal placé,
&
efi mis, de cramte qu'il ne tombe,
au-deífus du genoll
&
du {abot: en ce cas , l'arumal
ne peut pas pouífer contre ,
&
la jambe de devant
oe peut pas forcer celle de derriere 11 {uivre :
OH
fi
pour éviter cet inconvénient on fait
le
tramail conrt
&
droit , il comprimera le gros nerfde la jambe de
dertiere
&
la partie charnue des cuiífes de devant,
en {orte que le cheval ne pourra plus aIler
qu'il
ne
\:>ronche pardevant,
&
ne fléchilfe du train de der–
riere.
, Quant ala forme du tramáil, quelques-tms
h.:
f0nt
de cuir ; a qaoi il
J
a cet inconvénient , qu'il s'al–
longera 0tL rompra ; ce qui pouITa empecher le {uc–
ás
de l'opération. Pour un bon tramail, il faut que
les c6tés {oient
fi
fermes, qu
:i.lsne puiífent pas pre–
ter de l'épaiífeur d'un cheveu; la houífe mollette ,
&
fi bien arretée qu'elle ne puiífe pas {e déranger ;
la bande de dcrriere plate,
&
de{cendant aífez baso
En le dreífant a la mam , on lui mettra {eulement
en commenc;:ant un demi-tramail , pour le dreífer d'a–
bord d'un c(¡té ; en{uite on en fera autant
a
l'atltre
coté:
&
lorfqu'il ira
l'amblt
11 la mam avec facilité
&
aVeC aifance , fans trébucher ni broncher, ce qui
fe fair d'ordinaire en deux ou trois heures, on lui
mettra le tramail encier.
Voye{
TRAMAlL.
AMBLER, (
ManefJC.
)
c'efi
aller l'amble.
r.
AM-
13LIt.
I1 Y a certains chevaux bien forts , qui
amblent
lorfqu'on les preífe an manege; mais c'efi le plus
fouVent par foibleífe namrelle on par l<tffitude.
(V)
.. AMBLETEUSE,
vi.nemaritime de France dans
la Picardie.
Lon.
19,
20.
lato
50.
íD.
. AMBLEUR, {. m. (
Manege.
)
Officier de la gran–
~e
&
petite écurie du Roi.
Yoye{
AMB-LE.
(Y') .
AMBLEUR,
f.
m. c'efi ainfi qu'0n nomme
en
Yi--'
nerie
un
cerf dont la trace dtl pié de derriere firr.
paífe la trace du pié de devant.
AMBLYOPIE, {. f.
efl
une offufcation ou un obfcur–
ciffiment de la
lIrte,
qui empeche de diftmguer clai–
rement l'objet, a 9uelque ilifiance qu'il {oit placé.
Cette incommodite vient d'une obfiruUion impar–
faite des nerfs optiques , d'une {ulfLliion légere, du
défal1t ou de l'épaiífeur des e{prits,
&c.
Quelqnes·
uns comptent ql1atre e{peces
d'amblyopies;
(avoir,
la
myopie,
la
presbytie,
la
nyélalopie,
&
I'amaurqfis.
Yoye{ chacune
ti
Jon anicle.
Blaochard.
(N)
AMBLYGONE, adj.
m.
ter¡m
de G¿om.
qui {e dit
d'un triangle dont un des angles efi obnls ,
OH
a plus
de 90 degrés.
Voye{
ANGLE
&
TRIANGLE.
Ce mot efi comporé de l'adjeaif Grec
'
;P.CA~,
,
ob–
tus,
&
de
'l'wvla.,
angle.
(
E)
.. AMBOHISTMENES, peuples d'Afrique,
'f,1Í
habitent les montagnes de la partie orientale de
111e
de Madaga{ear.
AMBOINE , lle d'Afie, l'une des Moluques, amr
Indes orientales , avec viUe de mame nomo
Long.
z4.5.
lato mérid.
4-
.. AMBOISE , ville de France , dans la Tourai–
ne,
au
confIuant de la Loire
&
de la Maífe.
Long.
z8
d •
39'.
J" .
lato
4Jd.
24' . .56".
AMBON ,
';p'~wv,
nom que I'on donne au bord
cartilagineux qui environne les cavités des os
~lli
en
rec;:oivent d'alltres ; tels (ont ceux de la cavite glc–
noide de l'omoplate, de la cavité cotylo'ide des os des
hanches.
Yoye{
OMOPLATE
6·
HANCHE,
&c.
(L)
AMBON, efiauffiJamemecho{equejubé.
V.
JUBÉ.
AMBOUCHOIR ,
f.
m. pI.
en t.rme d. Boaier,
ce {ont les moules ftlr lefquels on fait la tige d'une
.botte.
Ils
{ont compo{és de deux morceaux de bois
qui réunis en{emble, ont
a
pell pres la figure de la
jambe,
&
qu'on fait entrer l'tm apres 1'autre dans
le corps de la botte; on écarte les morCeatL'C de bois
a
ili{crétion par le moyen d'un coin de bois, appellé
cié,
que 1'on chaífe
a
coups de martean entre les
deux pieces qui compo{ent l'ambouchoir.
Yoye{ la
jig.
29.
Pi.
du BOJtier.
.. AMBOULE, (
V
ALLE'E
D')
contrée de 1'ile
de Madaga{car • au midi , vers la cote orientale, au
nord dtl Carcanoffi.
.. AMBOURNAI
ou
AMBRONAI , ville de Fran.
ce dans le Bugey ,
a
trois lieues de Bourg en Breífe_
AMBOUTIR, V. a.
en terme de Chaudronnier,
c'efi
donner de la profondeur
&
de la capacité a une
piece qui étoit platte, en la frappant en dedans avec
un marteall
a
tranche on a panne ronde.
Voye{ la
fig.
6.
Pi.
1.
du Chaudronnier,
qni repré{ente un
ouvrier qui amboutit une piece
{ur
un tas avec un
marteau. Ce terme convient daos le meme {ens
a
l'Orfévre
,
au
Serrurier,
au
Ferblantier,
&
a
la
pi\¡.
part des autres Ol1vriers qui employent les métallx.
ou des matieres f1éxibles.
A
M B
o
lJ
T 1 R ,
en
terme
d'
Eperonni6r. Yoye{
Es....
TAMPER.
.
AMBOUTlSSOIR
o/t
EMBOUTISSOIR,
f.
ro.'
out;l d'Eperonnier
,
eíl: une plaque de fer dans laquel–
le eft une cavité {phériC¡\le
Ol!
parabolOide, felon
que
1'01'1
vent que les fonceaux que l'on amboutit
delfus {aient plus arrondis ou plus aigus. Le fond.
de cette cavité eft percé d'un trou rond d'environ
fept a huit lignes de iliametre; c'efi fl!! cet omi!
poré
a
cet elfet {ur une enclnme, que l'on fait pren.
dre la fonne convexo-concave aux pieces de fer
'!1ü
doivent former les fonceaux en frappant deífus la
tete d'une bOllterolle qui appuie la piece rougie au
feu , qui doit former le fonceau.
Voye{
ESTAMPER
&
FONCEAU,
&
la jig.
z.
PI.
de l'Eperonnier,
qui
repré{ente
l'amboutijJoir.
AMBOUlISSOI,R ,
outit dt Clout;er,
eft un poin.-
















