
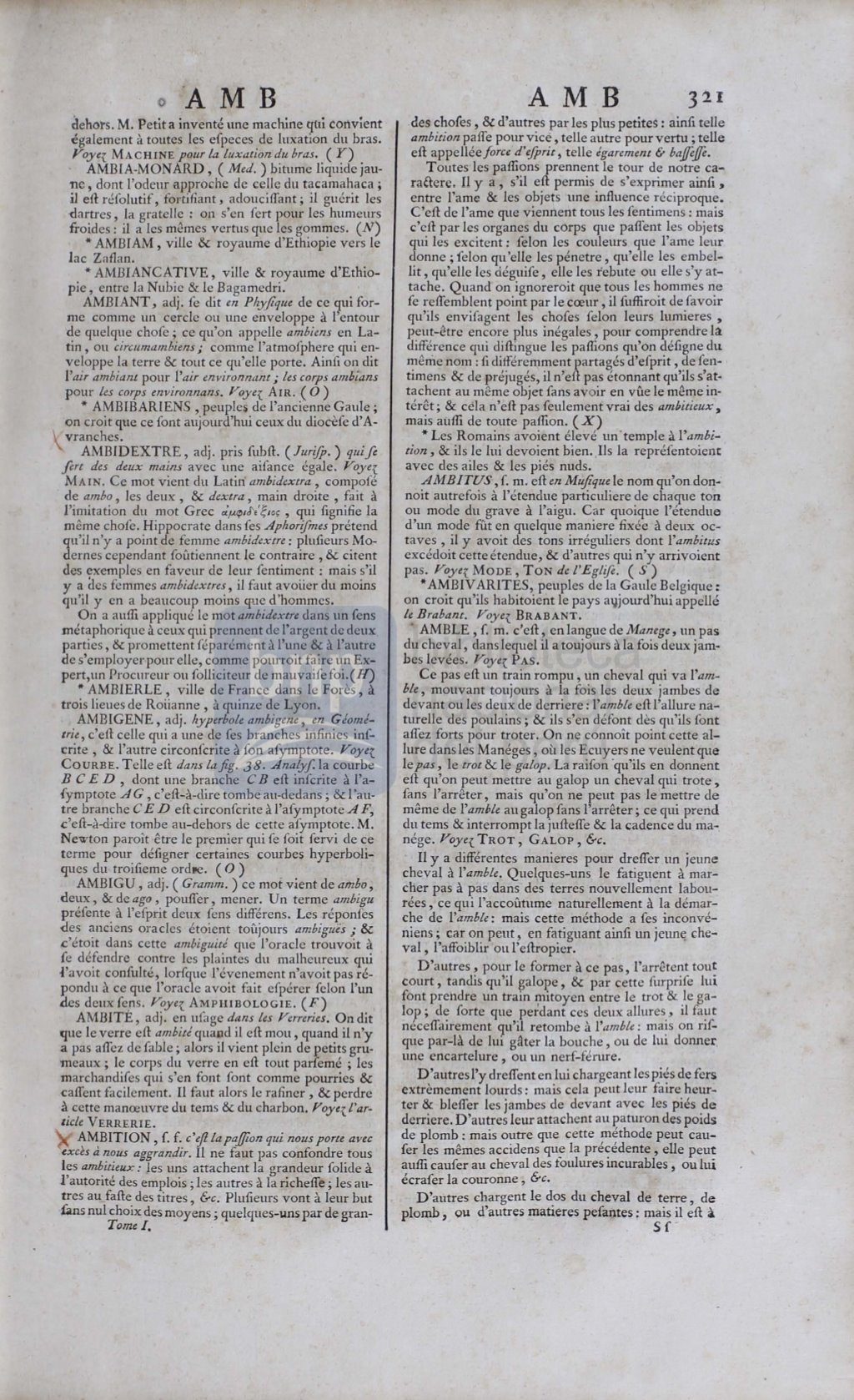
()
dehots. M. Petita inventé une macrune
qtú
coñvient
égalemene
a
toutes les e{peces de luxatíon du bras.
roye{
MACHINE
pour
la
luxation dlt bras. (Y)
AMBIA-MONARD,
(Med.
)
bitume liquide jau–
ne, dont l'odeur approche de celle du tacamahaca ;
i1
eíl: ré{olutíf, fortinant, adouci{fant; il guérit les
dartres, la gratelle : on s'en (ert pour les humeurs
froides : il a les memes vernls que les gommes.
(N)
*
AMBfAM , ville
&
royaume d'Ethiopie vers le
lac Zaflan.
*
AMBfANCATIVE, ville
&
royaume d'Ethio–
pie, entre la Nubie
&
le Bagamedri.
AMBIANT, aelj. (e dit
en
PhyJl'lue
ele ce qui for–
me comme un cercle ou lille enveloppe a l'entour
de quelque cho{e; ce qu'on appelle
ambiens
en La–
tín, ou
circumambiens;
comme l'atmo(phere qui en–
veloppe la terre
&
tout ce qu'elle porte. Ainfi on dit
l'air ambiant
pour
l'air environnant; les corps ambians
pour
les corps environnans. roye{
AIR.
(O)
*
AMBIBARIENS , peuples ele I'anci"enne Gaule ;
on croit que ce {ont aujourd'hui ceux du diocefe d'A–
vranehes.
AMBIDEXTRE, aelj. pris (ubO:.
(luriJP.) 'luije
jert des deux mains
avec une ai{ance égale.
roye{
MAIN. Ce mot vient du Latin
ambidextra,
compo{é
de
ambo,
les deux,
&
dextra,
main droite , faie a
l'imitation du mot Grec
dl-'<pld't'e,O~
,
qui fignine la
meme chofe. Hippocrare dans fes
Aplzorifmes
prétend
qu'il n'y a point de femme
ambidextre
:
plufieurs Mo–
ciernes cependant {outiennent le contraire ,
&
citent
des
~xemples
en faveur de leur {entiment : mais s'il
y a des femmes
ambidextres,
il faut avoiier du moins
qu'il y en a beaucoup moins que eI'hommes.
On a auffi appliqué le mot
ambidextre
dans un {ens
métaphorique a eeme qui prennent de I'argent de deux
parties,
&
promettent (éparément a I'une
&
a l'autre
de s'employel'pourelle, comme pourroit faire un Ex–
pert,un Procureur
011
folliciteur de mauvaifefoi.(H)
*
AMBlERLE, ville de France dans le Fores, a
trois lieues de Roiianne ,
a
quinze de Lyon.
AMBIGENE, adj.
kyperbole ambigene, en Géomé–
trie,
c'eO: celle qui a une de {es branches infinies in{–
erite ,
&
I'alltre circon{crite a ron afymptote.
roye{
COURBE, Telle eO:
dans lajig.
38.
Analyf
la courbe
B
e
E D,
dont une branche
e
B
ell: in{crite a I'a–
{ymptote
A G
,
c'eíl:-a-dire tombe au,dedans ;
&
l'au–
tre branche
e
E D
eíl: circon{criee a l'a{ymptote
A F,
c'eft-a-dire tombe au-dehors de cette a{ymptote. M.
Newton parolt etre le premier qui {e {oit (ervi de ce
terme pour défigner certaines courbes hyperboli–
ques du troifieme ordJOe.
(O)
AMBIGU, adj. (
Gramm.
)
ce mor vlent de
ambo,
deux,
&
deago,
pouífer, mener. Un terme
ambigu
pré{ente
a
l'e{prit deux {ens différens. Les répon{es
<les
~nciens
oracles étoient toujours
ambigues;
&
c'étolt dans cette
ambiguité
que l'oracle trouvoit
a
fe défendre contre les plaintes du malheureux qui
.j'avoit con{ulté, lor{que I'évenement n'avoit pas ré–
pondu
a
ce que I'oracle avoit fait efpérer {elon l'un
des deux (e,ns,
roye{
AMPHIBOLOGIE,
(F)
AMBITE, adj. en u{age
dans les rerreries.
On dit
que le verre ell:
ambit¿
qualild il eft mOti, quand il n'y
a
pas a{fez de {able; alors il vient plein de petits
gro–
meallX; le corps du verre en eíl: tout parfemé ; les
marchandi{es qui s'en font font comme pourries
&
calfent facilement,
II
faut alors le ranner ,
&
perdre
a
cette manreuvre dtl tems
&
du charbon.
Poye{l'ar–
tide
VERRERIE.
AMBITION,
f.
f.
c'eJllapaJlion qui nous porte avec
exces
a
nous acgrandir,
Il
ne faut pas confondre tous
les
ambitie=:
les nns attachent la grandeur {olide
a
l'autorité des emplois ; les alltres
a
la riche{fe; les au–
tres au fafie des titres,
&c.
Plufieurs vont
a
leur but
~
nul choix des moyens ; quelc¡nes-uns par de gran-
TomeI.
AMB
3
21
des chofes ,
&
d'autres par les plus petites : ainfi telle
ambition
paífe pOlIrvicé, telle autre pour vertu ; telle
eft appelléeforce
d'efprit,
telle
lcarement
&
baJ!effe.
Toutes les pallions prennent le tour de notre ca–
raB:ere,
Il
ya, s'il eft
permis
de s'exprimer ainfi ,
entre I'ame
&
les objets une influence réciproque.
C'eil: de I'ame que viennent tous les {entimens : mais
c'eft par les organes dn córps que paífent les objets
qtú
les
excitent: felon les couleurs qtle l'ame leur
donne ; felon c¡u 'elle les pénetre, qu'elle les embel–
lit, qu'elle les áégui{e, elle les rebute ou elle s'y at_
tache. Quand on ignoreroit qtle tous les hommes ne
fe rei'remblent point par le creur , il fuffiroit de {avoir
qu'ils envifagent les chofes {elon leurs lumieres •
peut-etre encore plus inégales, pour comprendre la
différenee qui difringue les pallions qtl'on défigne du
merrie nom : fi différemment partagés d'efprit, de (en–
timens
&
de préjugés, il n'eft pas étonnant qu'ils s'at–
tachent au meme objet fans avoir en vue le meme in–
téret;
&
cela n'eft pas feulement vrai des
ambitieux,
mais auffi de toute paffion.
(X)
*
Les Romains avoient élevé lID'temple
a
l'
ambi–
tion,
&
ils le lui devoient bien. lis la repréfentoient
avec des ailes
&
les piés nuds.
AMBITUS,
f.
m. eft
en Mtifi'luele
nom qtl'on don–
noit autrefois
a
l'étendue particuliere de chaqtle ton
ou moele du grave
a
l'aigu. Car quoique l'étendu6
d'un mode fut en qtlelque maniere fixée
a
deux oc–
taves, il
Y
avoit des tons irréguliers dont
l'ambitus
excédoit cette étendue,
&
d'autres qui n'y arrivoient
paso
Voye{
MODE, TON
de l'Eglife, (S)
*
AMBIVARITES, peuples de la Gaule Belgiqtle:
on croit qu'ils habitoient le pays avjourd'hui appellé
le
Brabant. roye{
BRABANT.
. AMBLE,
f.
m, e'eft, en langue de
Manege,
un pas
du cheval, dans lequel
il
a toujours
a
la fois deux jam–
bes levées.
roye{
PASo
Ce pas eft un train rompu, un cheval qtú va
l'am–
ble,
mouvant toujours
a
la fois les deux jambes de
devant ou les deux de derriere :
l'
amble
eftI'allure na–
turelle des poulains ;
&
ils s'en défont des qu'ils font
aífez forts pour troter. On ne connole point cette al–
lure dans les Manéges , otiles Ecuyers ne veulent qtle
le
pas, le trot
&
le
galopo
La rai{on 'qu'ils en donnent
eft qtl'on peut metn'e au galop un cheval qui trote>
fans I'arreter, mais qu'on ne peut pas le mettre de
meme de l'
amble
au galop fans l'arreter; ce qui prend
du tems
&
interrompt la jufteífe
&
la cadenee du ma-.
nége.
roye{
TROT, GALOP,
&c.
Il
y a différentes manieres pour dre{fer un jeune
cheval
a
l'amble.
Quelqtles-uns le fatiguent
a
mar–
cller pas
a
pas dans des terres nouvellement labou–
rées, ce qui l'act:Outllme nanlrellement
a
la démar–
che de l'
amble:
mais cette méthode a {es inconvé–
niens; car on peut, en fatiguant ainfi un jeun¡; che–
val, l'affoiblir oul'efuopier.
D'autres , pour le former
a
ce pas, I'arretent tout
court, tandis qu'il galope,
&
par cette furpri{e lui
font prendre un train mitoyen entre le trot
&
le ga–
lop; de {orte que perdant ces deux allures, il faut
néce{fairement <;Iu'il retombe
a
l'amble:
mais on ri{–
qtle par-la de
1m
gater la bouche, ou de lui donner.
une encartelure, ou un nerf-férure.
D'autresl'y dre{fenten lui chargeant lespiés de fers
extremement lourds: mais cela peut leur faire heur–
ter
&
ble{fer les jambes ele devant avec les piés de
derriere. D'autres leur attachent au paturon des poids
de plomb : mais outre qtle cette méthode peut cau–
fer les memes accidens
qu~
la
pré~édente
, elle peut
auffi cau{er al! cheval des toulures IDcurables, ou lui
écrafer la couronne,
&c.
D'autres chargent le dos du cneval de terre, de
plomb,
9U
d'autres matieres peCantes; mais il eft
a
Sf
















