
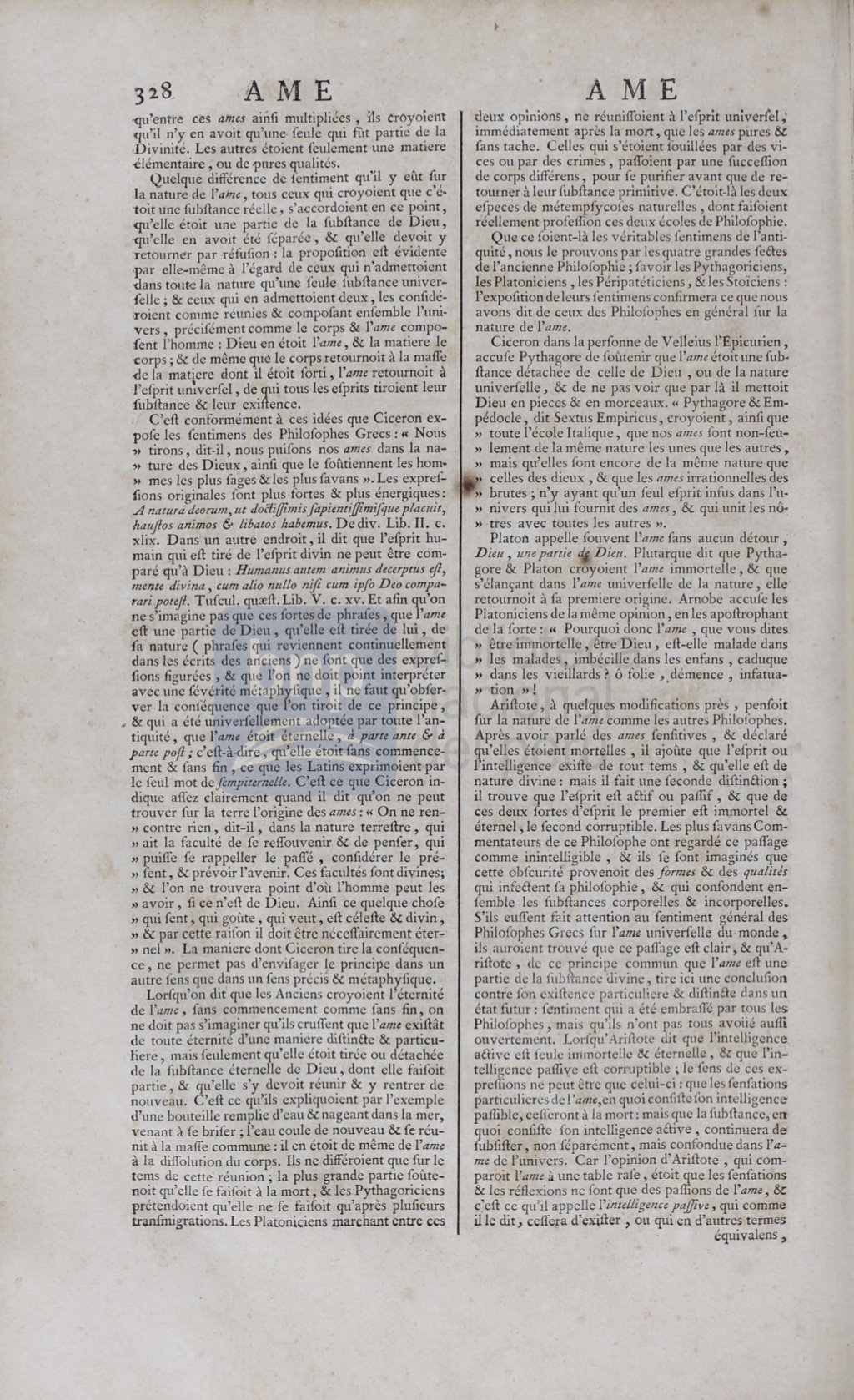
3
18.
AME
'<jll'entre
c~s
ál1les
ainfi multípliées , 11.s croyoient
~'il
n'y en avoit qu'une feule qui nlt parrie de la
,Divinité. Les autres étoient feulement une mauere
-élémentaire, ou depures qualités.
Quelque différence de lentiment qu'il y eut {ur
la nature de l'
ame,
tous ceux 'luí croyoient que c'é–
'toit une fubfiance réelle, s'accordoient en ce point,
~'elle
étoit une partie de la fubfiance de Dieu,
-qu'elle en avoit ét{\ féparéc,
&
qu'elle devoit y
'retournér par -réfu/ion : la propo/iti0n efi évidente
'par elle-meme a l'égard de ceux qui n'admettoient
'¿ans tonte
la
nature qu'une feu!e lilbfiance univer–
{elle;
&
ceux qui en admettoient deux , les confidé–
iroient comme réunies
&
compofilOt enfemble l'uni–
vers, précifémentcomme le corps
&
l'ame
compo–
{ent l'homme : Dieu en étoit
l'ame,
&
la matiere le
'Corps ;
&
de meme que le corps retournoit a la maífe
'¿e la matiere dont il étoit forti,
l'ame
retournoit a
l'e(prit
un~verfel
, de qui tous les efprits tiroient leur
:fubfiance
&
leur exifrence.
C'efi conformément
a
ces idées que Ciceron ex–
pofe les (entimens des Philofophes Grecs:« Nous
~,
tirons, dit-il , nous puifons nos
ames
dans la na–
" ture des Dieux, ainfi que le fOlltie¡lOent les horno
), mes les plus fages
&
les plus favans
».
Les expref–
{¡ons originales font plus fortes
&
plus énergiques ;
A naturadeonlm,
TU
doéli{fimisfapientiffimifque placuít,
Izatiflos animos
&
Matos Izabemus.
De divoLib. 11. c.
xlix.
Dans un autre endroit, il dit que l'efprit hu–
main qui
ell:
tiré de l'efprit divin ne peut etre com–
paré "tu'a Dieu :
HumanrtS aIltem animus dteerptus 11,
mente divina, cum alío nulto nifi cum ipfo Deo compa–
rari pot11-
Tufcul. qua::fr. Lib. V. c. xv. Et alin qu'on
ne s'imagine pas que ces fortes de phrafes, que
l'ame
efr une partie de Dieu, qu'elle efi tirée de luí, de
fa nature ( phra{es qui reviennent continuellement
dans les écrits des anciens ) ne {ont que des expref–
fions figurées ,
&
que l'on ne doit point interpréter
avec une févérité métaphyíique , il ne faut qu'obfer–
ver la conféquence que l'on tiroit de ce principe,
M
&
qui a été univerfeJlement adoptée par toute 1'311-
tiquité, que l'
ame
étoit éternelle,
ti
parte ante
&
ti
parte pofl;
c'efr-a-d.ire, qu'elle étoit fans commence–
ment
&
fans fin , ce que les Latins exprimoient par
le feul mot
defempiternetle.
C'efi ce que Ciceron in–
dique aífez clairement quand il dit qu'on ne peut
trouver fur la terre l'origine des
ames:
((
On ne ren–
»
contre rien, dit-il, dans la nature terrefire, qui
"ait la faculté de {e reífouvenir
&
de penfer, qui
"puiífe fe rappeller le paífé , coníidérer
le
pré–
" fent,
&
prévoir I'avenir. Ces facultés fonr divines;
,,&
l'on ne trouvera point d'OII l'homme peut les
" avoir, fi ce n'ea de Dieu. Ainíi ce quelque chofe
" qui fent , qui gOllte, qui veut,
ea
célefie
&
divin,
" &
par cette raifon il doit etre néceírairement éter–
"nel... La maniere dont Ciceron tire la conféquen–
ce, ne permet pas d'envifager te príncipe dans un
autre fens que dans un fens précis
&
métaphr,fique.
Lor{qu'on dit que les Anciens croyoient
1
éternité
de
l'
ame,
fans commencement comme fans fin, on
ne doit pas
s'irna~iner
qu'ils cruífent que l'
ame
exiliat
de toute éternite d'une maniere dillinéte
&
particu–
nere, mais feulement qu'elle étoit tirée ou détachée
de la {ubfiance éternelle de Dieu , dont elle faifoit
partie,
&
qu'elle s'y devoit réunir
&
y rentrer de
nouveau. C'efr ce qu'ils eJ....pliquoient par I'exemple
d'tme bouteille remplie d'eau
&
nageant dans la mer,
venant a fe brifer ; l'eau coule de nouveau
&
fe réu–
nit
a
la maífe commune : il en étoit de meme de l'
ame
a
la diífolution du corps. lis ne différoient que fur le
tems de cette réunion ; la plus grande partie foute–
noit qu'elle fe faifoit a la mort,
&
les
Pythagoriciens
prétendoient qu'elle ne fe faifoit qu'apres pluíieurs
tranfmigrations. Les Platoniciens marchant entre ces
AME
clet1x opinións, ne réuniífoient
a
l'e(prit univerfel;
immédiatement apres la mon, que les
ames
pures
&
fans tache. Celles qui s'étoient fouillées par des vi–
ces ou par des crimes, paífoient par une fucceffion
de corps dilférens, pour fe purifier avant que de re–
tourner a leurfubil:ance primitive. C'étoit-I¡\ les deux
efpeces de métemp{ycoú:s naturelles , clont faifoient
réellement profeffion ces deux écoles de Philo{ophie.
Que ce foient-la les véritables fentimens de l'anti–
quité, nous le prOll.vons par les quatre grandes {eétes
de I'ancienne Philofophie; {avoir les Pythagoriciens,
les Platoniciens , les Péripatéticiens,
&
les
Stolciens :
l'expoíition deleurs fentimens confirmera ce que nous
avons dit de ceux des Philofophes en général fur la
nature de l'
ame.
Ciceron
dans la perfonne de VelIeius l'Epicurien,
accufe Pythagore de foíitenir aue
I'ame
étoitune fub–
fiance detachée de celle de Dieu , ou de la nature
univerfelle,
&
de ne pas voir que par la
il mettoit
Dieu en pieces
&
en morceaux. " Pythagore
&
Em–
pédocle, dit Sextus Empiricus, croyoient, ainíi que
" toute l'école Italique, que nos
ames
font non-feu–
" lement de la meme nature les unes que les autres ,
»
mais qu'elles font encore de la meme nantre que
»
celles des dieux ,
&
que les
ames
irrationnelles des
11
brutes; n'y ayant qu'un (eul e{prit infus dans l'u–
»
nivers qui lui fournit des
ames,
&
qui unit les nO–
/) tres avec toures les autres
».
PlatO!' appelle {ouvent
I'ame
f.1ns aucun détour,
Dieu,
une
partí. dI Díeu.
Plurarque dit que Pytha–
gore
&
Platon croyoient l'
ame
immortelle,
&
que
s'élan~ant
dans
l'ame
univerfelle de la nature, elle
retournoit a fa premiere origine. Arnobe accufe
les
Platoniciens de la meme opinion, en les apofuophant
de la forte: " Pour'luoi donc
l'ame
,
que vous dites
»
etre immortelle, etre Dieu, efi-elle maJade dans
" les malades, imbécille dans les enfans , caduque
»
dans les vieillards?
o
folie, démence , infatua-
" tion
,,!
.
Ariíl:ote,
a
quelques modifications pres , penfoit
fur la nanrre de
l'
ame
comme les autre Philoíophes.
Apres avoir parlé des
ames
{eníitives ,
&
déclaré
CJll'elles étoient mortelles , il ajoíhe que I'efprit ou
l'intelJigence exifre de tout tems ,
&
qu'elle efi de
nanlre divine: mais il fait lme feconde difiinétion;
il trouve que l'e{prit ea aétif ou paffif,
&
que de
ces deux fortes d'efprit le premier efi immortel
&
éterne! , le fecond corruptible. Les plus favans Com–
mentateurs de ce PhiJofophe ont regardé ce paífage
comme inintelligible ,
&
ils {e font imaginés que
cette obfclll'ité provenoit des
formes
&
des
lJllalités
'lui infeétent fa phiJoíophie,
&
qui confondent en–
femble les fubil:ances corporelles
&
incorporelles.
S'ils euífent fait attention au {entiment généraJ des
Philofophes Grecs fur
l'ame
univerfelJe du monde.
ils auroient trouvé que ce paílage efi dair,
&
qu'A–
rifrote, de ce príncipe commun que
I'ame
efr une
partie de la fub1lance Clivine, tire ici une concluíioll
contre fon exiil:ence particuliere
&
diainéte dans un
état futur: lentiment qui a été embraífé par tous les
PhiJofophes, mais qu'ils n'ont pas tous avoiié auffi
ouvertement. LOl{qu'Ariaote dit que J'inrelligence.
aétive efi feule irnmorrelle
&
étemelle,
&
que l'in–
telligence paffiye eil: corruptible; le fens de ces ex–
preffions ne peut etre que celui-ci : que les fen{ations
particulieres de!'
ame,en
quoi coníiaefon intelligence
paffible, ceíreront a la mort: mais gue la fubfiance, en
'luoi confifie ron intelligence aétive , continuera de
lubíiller, non féparément, mais confondue dans l'
a–
me
de l'univers. Car l'opinion d'Ariíl:ote , qui com–
paroit
l'am~
a
une table rafe, étoit que les (enfátions
&
les réflexions ne font que des paffions de l'
ame,
&
c~ea
ce qu'il appelle
l'intelLígellce pajJive,
qui comme
il
le
d.it) ceífera d'exiil:er , ou qui en d'autres termes
équivalens )
















