
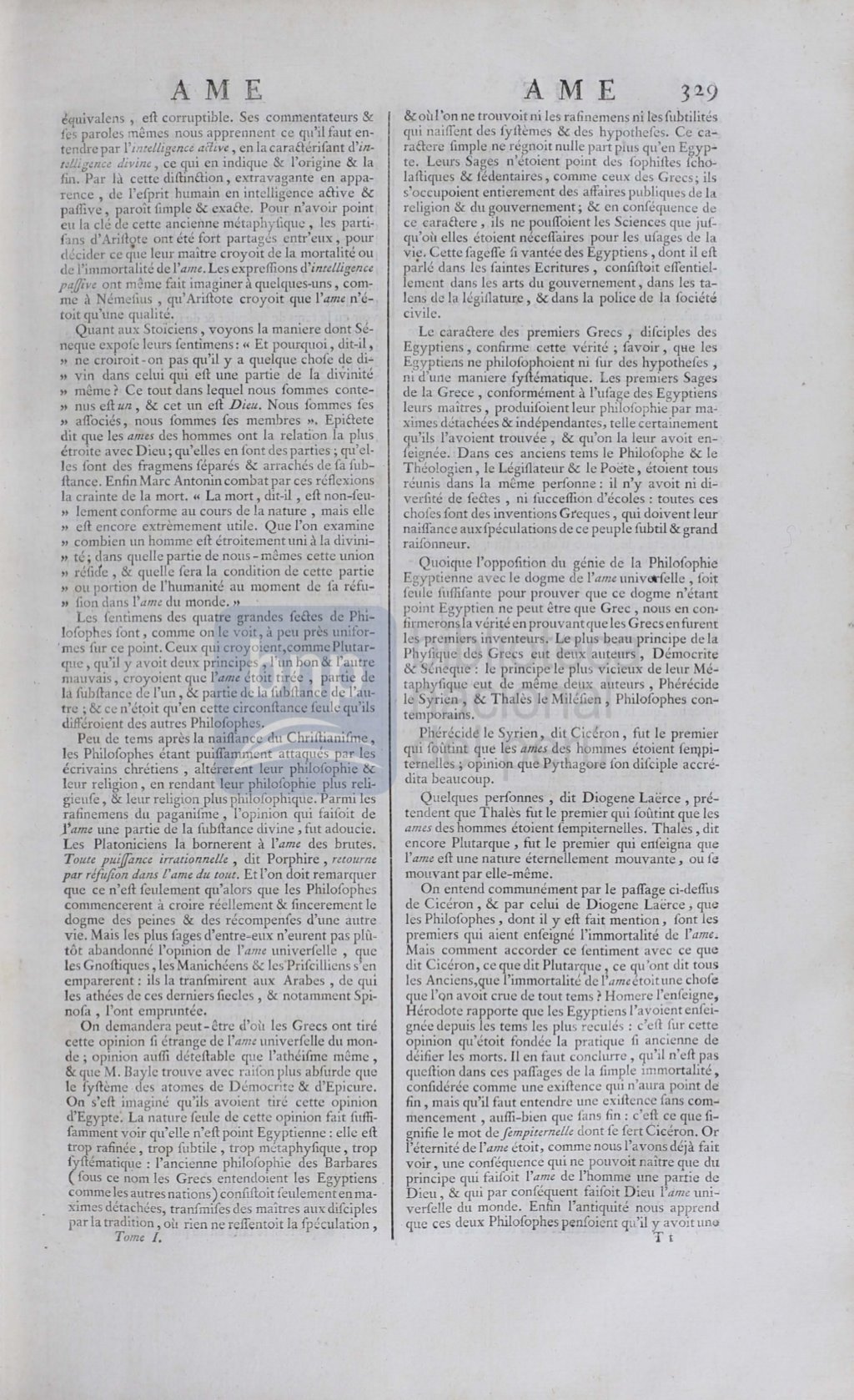
AME
é<illivalens , efr corruptible. Ses commentaCeurs
&
les
paroles memes nous apprennent ce qu'il faut en–
tendrepar
I'lnretligmce aélive,
en la caraaérifant
d'in–
t:lLigmc~
divine,
ce qui en indique
&
I'origine
&
la
fin. Par la cette diilinilion, extravagante en appa–
rence , de l'efprit humain en intelligence aaive &
paffive, parolt fimple & exaae. Ponr n'avoir point
eula cié de certe ancienne métaphyúque , les parti–
fans d'Ariliote ont été fort partages entr'eux, pour
décider ce qOlle leur maitre croyoit de la mortalité ou
de l'immorralité de
l'ame.
Les expreffions
d'intelligence
pf1:(jive
ont meme fait imaginer a quelques-uns, com–
me
a
Némelius , qu'Arifrote croyoit que
l'ame
n'é–
toit
qu'une qualité.
Quant aux Stolciens , voyons la maruere dont Sé–
neque expofe leurs fentimens; " Et pourquoí, dit-il,
" ne croiroit-on pas qu'il y a quelque chofe
~e
di–
" vin dans ce\ui qui efr une partie de la divinité
" meme? Ce tout dans lequel nous fommes conte–
" nus efr
un
,
& cet un efr
Dieu.
Nous fommes fes
" aífociés, nous fommes fes membres
>l.
Epiaete
dit que les
ames
des hommes ont la relation la plus
étroite avec Dieu; qu'elles en font des parties; qu'el–
les iont des fragmens féparés
&
arrachés ele fa fub–
ftance. Enfin Marc Antorun combat par ces réflexions
la crainte de la morro " La mort, dit-il , efr non-feu–
" lement conforme au cours de la narure , mais elle
" efr encore cxtremement utile. Que l'on examine
" combien un homme efr étroitement uni a la divini–
" té; dans c¡ueHe panie de nous - memes cette union
" réúde ,
&
c¡uelle fera la condition de cette partie
" on portion de I'humaruté au moment de fa réfu-
" fion dans l'
ame
du monde.
>1
•
Les fentimens des quatre grandes feaes de Ph1-
lofophes font, comme on le voit,
a
peu pres unifor–
'mes fur ce point. Ceux qui croyoient,comme Plutar–
que, qu'il y avoit deux principes , I'un bon
&
I'autre
mauvais, croyoient que
I'ame
étoit rirée , partie de
la fubfrance de I'un , & partie de la fubfrance de l'au–
tre ;
&
ce n'étpit qu'en cette circonftance feuJe qu'ils
di1féroient des autres Philofophes.
Peu de tems apres la naiírance du Chrifriarufme,
les Philofophes étant puiframment attac¡ués par les
écrivains chrétiens , altérerent leur phIlofophie &
lem religion, en rendant leur philofophie plus reli·
gieufe,
&
leur religion plus philofophique:Parmi les
rafinemens du paganifme, l'opinion qui faifoit de
J'ame
une partie de la fuhftance divine ,fut adoucle.
Les Platoruciens la bornerent
a
l'ame
des bnltes.
Toute puiffance i"ationnelle
,
dit Porphire,
retoume
par rifujion dans l'ame du tOltt.
Et l'on doit remarquer
que ce n'efr feulement qll'alors que les Philofophes
commeneerent
a
croire réeHement
&
fincerement le
dogme des peines
&
des récompenfes d'une autre
vie. Mais les plus fages d'entre-eux n'eurent pas pll¡–
tot abandonné l'opinion de
l'ame
univerfelle , que
les Gnofriques , les Manichéens & les Pri(cilliens s'en
emparerent; ils la trarumirent aux Arabes , de 'luí
les athées de ces derruers lieeles ,
&
notamment Spi–
nofa , l'ont empnmtée.
On demandera peut- etre a'Ol¡ les Grecs ont tiré
cette opinion
Ii
étrange de
I'ame
uruverfelle du mon–
de; opinion auffi détefrable que l'athéifme meme ,
&
que M. Bayle trouve avec r:titon plus abfurde que
le fyfreme des aromes de Démocritc
&
d'Epicure.
On s'efr imaginé qu'ils avoient tiré cette opinion
d'Egypte. La namre feule de cette opiruon fait fuffi–
famment voir qu'elle n'efr point Egyptienne: elle eíl:
trop rafinée, trop fubtile , trop mctaphylique, trop
Jjfrématic¡ue ; l'ancienne philofophie des Barbares
( fous ce nom les Grecs entendoient les Egyptiens
comme les amres nations) eonliftoit feulement en ma–
ximes
dét~ehées,
trallfmifes des maitres aux difciples
par la tradltlon ,ol! rien ne refrentoit la fpéculation ,
Tome
I.
AME
&ol¡l'Ollne trollvoit ni les rafinemens ni
I~sli¡btilités
qui naifrcnt des
fy~em~s
&
des hypothefes. Ce ca–
raaere limpie ne
r~pll~)J(
null
7
part plUS qu'en
E~yp
te..Leurs
Sa~es
n
~tOlCnt
pomt des fophifres {chó–
lafrlques & tédentalres, comme cellX des Grees; ils
s'occupoient entieremellt des affuires publiques de la
religion
&
du gouvernemellt; & en eonféC¡llence de
ce earaaere, ils ne poufroient les Sciences que juf–
CfU'Ol¡ elles étoient nécefraires pour les ufages de la
Yi~.
Cette fagefre
{i
vantée des Egyptiens , dont il efr
parlé dans les faintes Ecrintres, eonlifroit effentiel–
lement dans les arts du gouvernement, dans les ta–
lens de la légiflanue, & dans la police de la fociété
civile.
Le earaaere des premiers Grecs , difciples des
Egyptiens, confirme cette vérité ; favoir, c¡tle les
Egyptiens ne philofophoient ni fur des hypothefes ,
ni d'une maniere fyfrématique. Les premiers Sages
de la Grece , conformément
a
l'ufage des Egyptiens
leurs maitres, produifoicnt leur prulofophie par ma–
xinles détachées
&
indépendantes, telle certainement
qu'ils l'avoient trouvée,
&
qu'on la leur avoit en–
feignée. Dans ces anciens tems le Philofophe & le
T héo!ogien, le Légiflatem & le Poet1:!, étoient tOU9
réunis dans la meme perfonne: il n'y avoit ni di–
verfité de feaes , ni fucceffion d'écoles : toutes ces
chofes font des inventions Gt'eques, qui doivent leur
naiífance auxfpéculations de ce peuple fubtil
&
grand
raifonneur.
Quoique l'oppofition du gérue de la Philofophie
Egyptienne avec le dogme de
l'ame
lllúvt*-{elle , foif
feule fuflifante pour prouver que ce dogme n'étant
point Egyptien ne peut etre que Gree , nous en eon–
firmerons la véritéen prouvantque les Grecs enfurent
les premiers inventeurs. Le plus beau principe de la
Phylique des Grees eut deux auteurs, Démocrite
& Séneque: le principe le plus vicieux de leur Mé–
taphyfique eut de meme deux auteurs , Phérécide
le Syrien, & Thales le Milélien, Philofophes con–
temporains.
Phérécide le Syrien, dit Cic 'ron , n¡t le premier
qui foittint que les
ames
des hommes étoient feI11pi–
ternelles; opirtion que Pythagore fon difciple aceré·
dita beaucoup.
Quelques perfonnes , dit Diogene Laerce , pré–
tendent que Thales fut le premier qui fOlaint que les
ames
des hommes étoient fempiternelles. Thales, dit
encore Plutarque , fut le premier qui enfeigna qne
l'ame
eft une nau¡re éternellement motlvante, ou fe
mouvant par elle-meme.
On entend commlmément par le pafra<7e ei-defrus
de Cicéron ,
&
par celui de Diogene
L~erce,
que
les Philofophes, dont il y efr fait mention, font les
premiers qui aient enfeigné l'immortalité de
l'ame.
Mais eomment accorder ee fentiment avec ce que
dit Cicéron, ce que dit Plutarque ce
~u
'ont dit touS
les Anciens,que l'immorralité de 11 ameetoitllne chofe
que I'on avoit eme de tout tems ?Homere l'enfeigne,
Hé,odote rapporte que les Egyptiens l'avoient enfei–
gnée depuis les tems les plus reculés ; c'eíl: fur cette
opinion qu'étoit fondée la pratique fi ancienne de
déifier les morts.
Il
en faut conelurre, qu'il n'efr pas
quefrion dans ces pafrages de la limpie immortalité,
confidérée comme une exifrence qui n'aura point de
fin,
mais qu'il faut entendre une exifrence fans com–
mencement , auffi-bien que fans fin; c'efr ce que
fi–
gnifie le mot de
fempiternelle
dont fe fert Cicéron. Or
I'éternité de
I'ame
étoit, comme nous l'avons déja fait
voir, une conféquence qui ne pouvoit naltre que du
principe qtú faifoit
l'ame
de l'homme une pauie de
Dieu,
&
qlli par conféquent faifoit D ieu
l'ame
uni–
verfelle du monde. Enfin l'antiqtúté nous apprend
qne ces deux Philofophes
p~nfoient
qn'il y avoir un6
Te
















