
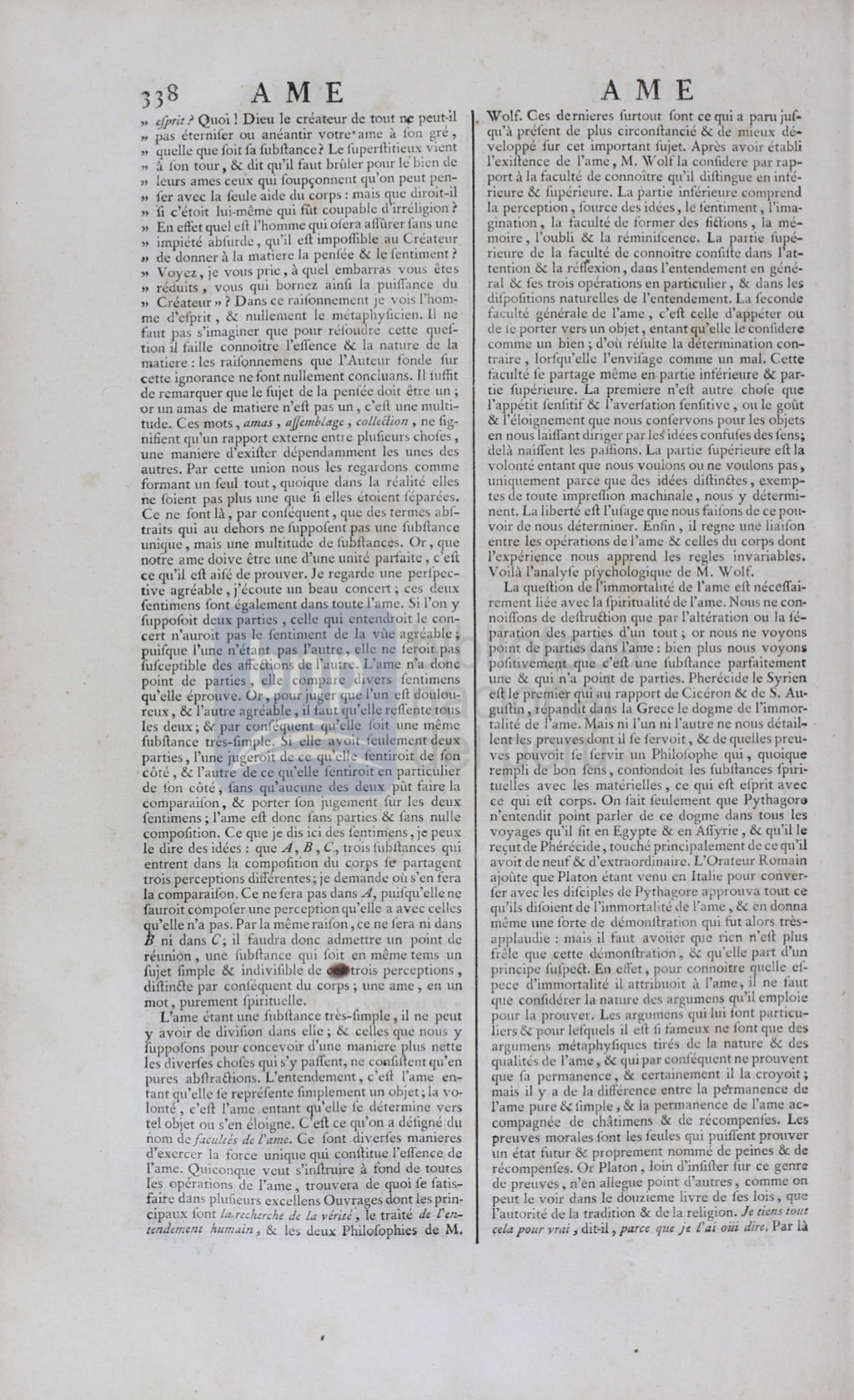
33 8
A M E
"
ifprit?
QUOl
!
Dieu le créateur de tout
~
peut-il
., pas éternifer Otl anéantir votre' ame
a
[on gré,
" quelle que [oit [a [lIbíl:ancet Le [upedlitieux. vient
" ti.
[on tour, & cüt qu'il faut briller pour le bien de
}) leurs ames ceux quí [oups:onnent
q~l'on pel~t I~en." {er avec la feule aide du corps : mals que dlrolHl
" Ii.
c'étoit lui-meme qui fllt coupable d'irréligion?
»
En efFet quel eíl: l'homme qui ofera a/fllrer fans une
" impiété ab[urde, <J:1'il ell:
imp~ilible
au Créateur
., de donner a la manere la penfee
&
le [eneunent
?
»
Voyez, je vous prie , a queJ .embarras .vous etes
»
réduits, vous qui bornez amíi la plll/fance du
" Créateur,,? D ans ce rai[onnemene je vois I'hom–
me a 'efprit, & nllllement le métaphyíicien. Il ne
faut pas s'imaginer que pour réloudre cette qllef–
tion
il
faille connoltre I'e/fence & la nature de la
matiere: les raifonnemens que l'Allteur fonde
[ur
cette ignorance ne fone nullement conclllans.
Il
luf!it
de remarquer que le fujet de la penfée doit erre un ;
or un amas de matiere n'ell: pas un , c'ell: une multi–
tude. Ces mots ,
amas, a.ffemblttge,
colleaioll ,
ne íig–
nifient qll'un rapport externe enere pluíieurs chofes ,
une maniere d'exiíl:er dépendamment les unes des
autres. Par cette union nous les regardons comme
formant un feul tout, quoique dans la réalité elles
ne foient pas plus une que fi elles étoient féparées.
Ce ne [ont la , par con(équent , que des termes ab[–
traits qui au dehors ne fuppofent pas une fubll:ance
uni,9ue, mais une multitllde de (ubftances. Or, que
notre ame doive etre une d'une uniré parfaite, c'ell:
ce qu'iI ell: aifé de prouver. le regarde une perfpec–
tive agréable, j'écome un beau concert; ces deux
fentimens font également dans toute I'ame. Si l'on y
[uppofoit deux parties , ceHe c¡ui entenuroit le con–
cert n'auroit pas le fentiment de la vlle agréable ;
puifque l'une n'étant pas l'autre, elle ne feroit pas
{ufceptible des afFeél:ions de l'autre. L'ame n'a donc
point de parties, elle compare cüvers (entimens
qu'eLle éprollve. Or, pOUl' juger que l'un ell: doulou–
reux, & l'auu'e agréable, iI faut qu'elle re/fente tOllS
les deux;
&
par con(équent qu'elle loit une meme
{ubíl:ance tres-Gmple. Si elle avoit (eulement deux
parties, l'une jugeroit de ce qu'elle fentiroit de [on
coté,
&
I'autre de ce qu'elle fentiroit en particulier
de lon coté , fans qu'aucune des deux Pltt faire la
comparaifon,
&
porter (on jugement fm les deux
{entimens; l'ame eíl: done fans parties & fans nulle
compoíition. Ce que je dis ici des !fmtimens , je peux
le dire des idées : que
A, B
,
e,
trois fubfiances clui
entrene dans la compofition du corps fe parcagent
trois perceptions cüfferentes; je demande 011 s'en fera
la
eomparaifon.Cene fera pas dans
A,
puifqn'elle ne
{amoit compofer une perception qu'elle a avec celles
qu'elle n'a paso Par la meme raifon, ce ne (era ni dans
B
ni dans
C;
il faudra done admettre un point de
réunion, une fubll:ance qni {oit en meme tems un
{ujet íimple & incüviíible de
trois perceptions ,
dill:inél:e par conlequent du corps; une ame, en un
mot, purement fpirituelle.
L'ame étant une fubll:ance tres-íunple , il ne peut
y
avoir de divifion dans e1ie; & celles que nous y
[uppo{ons pour concevoir d'une maniere plus nene
les divenes chofes qui s'y paJfene, ne coníiftentqu'en
pures abíl:raél:ions. L'entendement, c'eíl: I'ame en–
tant qn'elle
fe
repréfente fimplement un objet; la vo–
tonté , c'eíl: l'ame eneant qu'eLle (e détermine vers
~el
objet ou s en éloigne. C'eíl: ce qu'on a déGgné du
nom
defoculds
d~
l'ame.
Ce font diver{es manieres
d'exerccr la force uni'lue 'lui eoníl:itue l'eirence de
l'ame. Quiconque veut s'iníl:ruire
a
fond de
tOUtes
les opérations de l'ame trouvera de quoi fe fatis–
f~ire
dan pluGeurs exceitens Ouvraaes done les prin–
clpaux [ont
la.rulurche de la vlrité,
le traité
de l'en–
lendm ent
humain,
&
les cleux Philo{oprues de
M.
AME
. Wolf. Ces dernieres furtout font ce quí a pam jll{–
qu'a préfent de plus eireoníl:aneié & de mieux dé–
veloppé [ur cet important (ujet. Apres avoir établi
I'exiíl:ence de I'ame , M. \Yolf la confidere par rap–
port a la faculté de connoltre qu'il dillingue en infé–
rieure & fupérieure. La partie inférieure comprend
la perception , fource des idées, le ientiment, l'ima–
gination , la faculté de former des fiétions, la mé–
moire, I'oubli
&
la réminifcence. La partie fupé–
rieure de la faculté de eonnoltre coníiite dans I'at–
teneion
&
la réfÍexion, dans l'entendement en géné–
ral & {es troís opérations en particulier,
&
dans les
dirpofitions natureUes de l'entendernent. La [econde
faculté générale de I'ame, c'eíl: celle d'appéter ou
de le porter vers un objet, entant qu'elle le confidere
comme un bien; d'ol! réfulte la détern1ination con–
traire, 10nqu'eUe I'envifage comme un mal. Cette
faculté fe partage meme en partie inférieure
&
par–
tie fupérieure. La premiere n'eíl: autre chofe que
l'appétit (enGtif & l'averfation {eníitive , on le gout
&
I'éloígnement que nous eonfervons pOIlr les objets
en nous laiJfant diriger par les idées eonfu(esdes (ens;
deJa naiJfent les paílions. La partie fupérieure eíl: la
volonté entant qne nous vOltlons ou ne vOlllons pas,
uni'luement parce qne aes idées diíl:inél:es, exemp–
tes de tome impreffion macrunale , nOU5 y détermi–
nent. La liberté eíl: l'ufage que nons faifons de ce pon–
voir de nous détermíner. Enfin , il regne une liaifon
entre les opérations de l'ame
&
celles du corps dont
l'expérience nous apprend les
regle~
invariables.
VoiJ¡\ I'analyfe pfychologique de
M.
\Volf.
La queíl:ion de I'immortalité de rame ell: néceJfai–
rement liée avee la [piritualité de l'ame. Nous ne con–
noiJfons de defiruél:ion que par I'altération ou la fé–
paration des parties d'un tout; or nous ne voyons
point de parties dans I'ame : bien plns nous voyons;
poíitivemet;lt que c'eíl: une fubíl:anee parfaitement
une
&
qui n'a point de parcies. Pherécide le Syrien
eíl: le premier qui au rapport de Cicéron
&
de S. Au·
guíl:in , répandit dans la Grece le dogme de l'immor–
talité de l'ame. Mais ni l'un ni I'autre ne nous détail–
lene les preuves dont il fe fervoit, & de queUes preu–
ves pouvoit
fe
fervir un Philorophe quí, quoique
rempli de bon fens, confondoit les fubíl:ances {piri–
nlelles avee les matérielles, ce qui eíl: efprit avee
ce qui eíl: corps. On fait feulement que
Pythagon~
n'entendit point parler de ce dogme dans tollS les
voyages qu'il {it en Egypte
&
en A/fJ1;e , & qn'ille
res:ut de Phéréciele , touché principalement de ce qn'iI
avoit de neuf& d'extraofclinaire. L'Orateur Romain
ajoltte que Platon étant venn en ltalie pOllr conver–
fer avec les difciples de Pythagore approuva tout ce
qu'ils difoíent de I'immortalité ele l'ame , & en donna
meme une Corte ele démonUration qui fut alors tres–
applaudie : mais il fallt avoiier c¡ue rien n'ell: plus
frele que cette elémoníl:ration,
&
qn'elle part d'un
prineipe (u(peél:. En efFet, pOllr connoltre quelle ef–
pece d'immortalité il attribuoit
a
l'ame, il ne faut
que confidérer la nahlre des argumens '{u'il emploie
pour la prollver. Les argumens qui lui iont particu–
liers
&
}>our lefquels il eíl: fi fameux ne font que des
argumens métaphyfiques tirés de la nature
&
des
qualit 's de l'ame,
&
qui par eonféquent ne prouvent
CJ1le fa petmanence,
&
certainement illa croyoit ;
mais il y a de la cüfFérenee enere la pe'rmanence de
l'ame pure &Gmple,
&
la permanence de l'ame ae–
compagnée de chatimens
&
de récompenfes. Les
preuves morales font les feules qui puiJfent prouver
un état funlr & propremene nonuné de peines
&
de
récompenfes. Or Piaron, loin d'infill:er
íi.1T
ce genra
de preuves, n'en allegue point d'autres, commc on
peut le voj¡' dans le douzieme livre de fes lois, que
l'autorité ele la traelition
&
de la religion.
Je tiens
10m
cela pour vmí ,
dit-il,
paree que je l'ai oía dire.
Par
la
















