
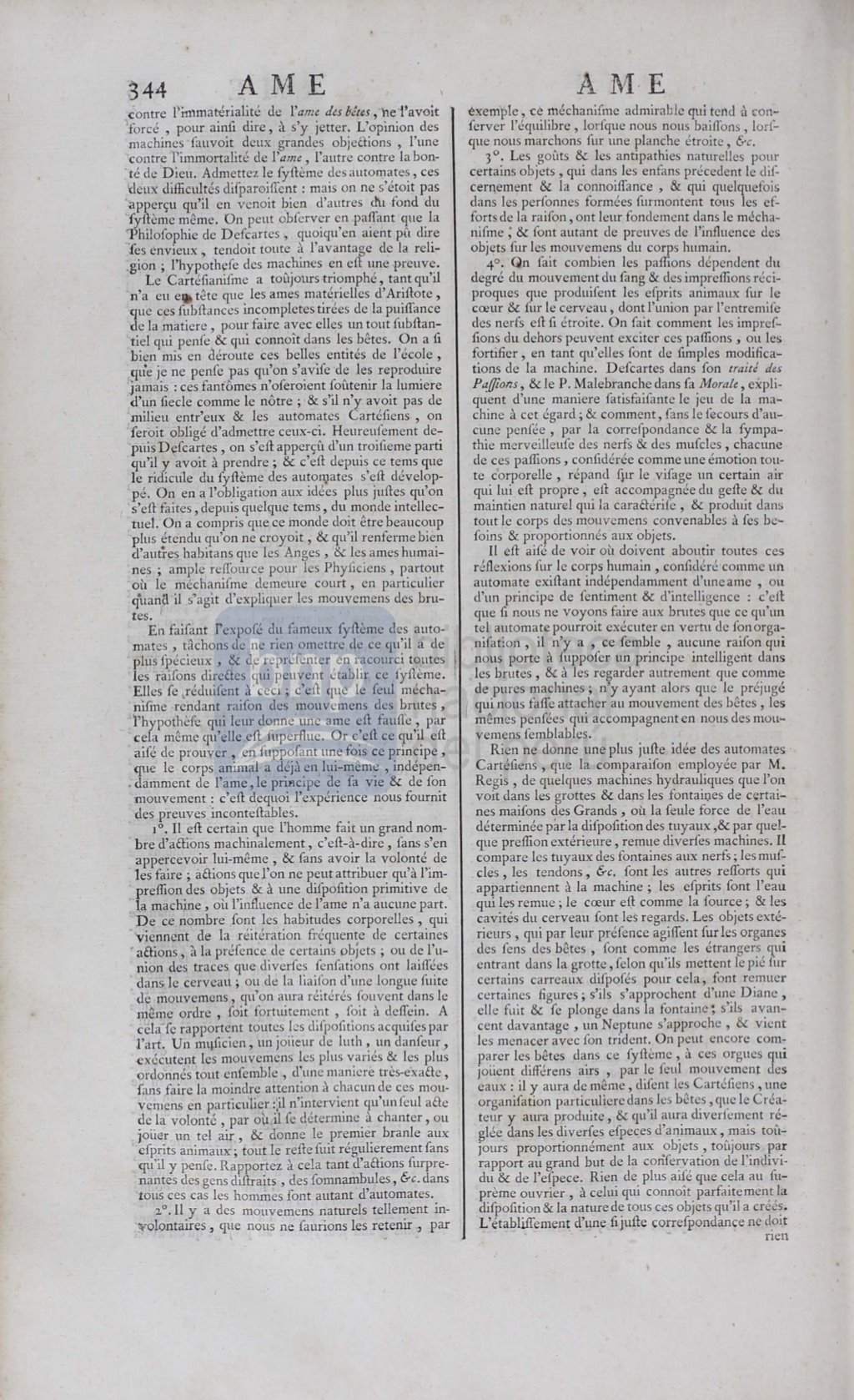
S44
AME
contre l'i111marerialité de
I'ame des bltes,
nei'avoit
'forcé, pour ainíi dire, a s'y jetter. L'opinion des
machines {auvoit deux grandes objeétions , I'une
contre °1' inmlOrtalité de l'
ame,
I'atltre contre la bon-
-té de Dieu. Admettez le {yfibne des automates , ces
'denx difficnltés difparoiírent : mais on ne s'étoit pas
':appers:u qu'il en venoit bien d'autres ch.1 fond du
-fyfteme meme. On pent ob{erver en paírant que la
'Philo{ophie de De{cartes, quoiqu'en aient pll dire
fes envieux, tendoit toute
a
l'avantage de la reli–
_gion ; I'hypothe{e des machines en eíl: une .¡xeuve.
Le Cartéíiani{me a to1ljOltrS -triomphé, tant qu'ü
n'a en e tete que les ames matérielles d'Arifiote,
que ces {ubfiances incompletes tirées de la puiírance
de la matiere , pour faire avec elles tm tout {ubfian–
tiel quí peme
&
qui connoit dans les betes. On a íi
bien mis en aéroute ces belles entités de I'école,
qu'e je ne penfe pas c¡u'on s'avife de les reproduire
}amais : ces fant<>mes n'o{eroient {olttenir la lumiere
d'un íiecle comme le notre ;
&
s'i1 n'y avoit pas de
milieu entr'eux
&
les automates Cartéíiens, on
feroit obligé d'admettre ceux-ci. Heureu{ement de–
-puisD It{cartes , on s'eíl: apperS:ll d'un troiíieme parti
qu'il
y
avoit a prendre ;
&
c'eíl: depuis ce tems que
le ridicule du fyfieme des autoIt}ates s'efi dévelop–
pé. On en a I'obligation aux idées plus jufies qu'on
s'efi faites, depuis quelque tems, du monde intellec–
ttlel. On a compris que ce monde doit etre beaucoup
plus étendu qu'on ne croyoit ,
&
qu'il renferme bien
d'autres habitans que 1es Anaes ,
&
les ames humai–
nes ; ample reílource pour les Phyficiens , partout
-011 le méchani{me demettre cmm, en particulier
q·uan$l il s'agit d'expliquer les mouvemens des bru–
tes.
En fai{ant Pexpo{é du fameux fyfieme des auto–
mates , dkhons de ne rien omettre de ce qu'il a de
plus fpécieux,
&
~e
repré{enter en racouró toutes
les rai{ons direétes (ltú peuvent établir ce fyíl:eme.
Elles fe .rédui{ent a' ceci ; c'ea que le feul mécha–
nlfme rendant rai{on des mou vemens des brutes,
í'hypothHe qui lem donne une ame eíl: fauíre, par
cela meme qu'elle eíl: {llperflue. Or c'eíl: ce qu'i1 efi
airé de prouver , en fuppofant une fois ce principe,
que le corps animal a déja en lui-meme , indépen-
-damment de I'ame, le pmcipe de fa vie
&
de ron
mouvement _: c'efi dequoi l'expérience nous fomnit
des preuves incontefiables.
JO.
11
eíl: certain que I'homme fait un grand nom–
bre d'ailions rnachinalement, c'efi-a-dire , fans s'en
appercevoir lui-meme ,
&
fans avoir la volonté de
les faire ; aétions queI'on ne peut attribuer qu'a I'im–
preffion des objets
&
a une di{pofition primitive de
Ola machine, olll'influence de I'ame n'a aucune parto
De ce nombre font les habinldes corporelles, qui
-viennent de la réitération fréquente de certaines
, aétions,
a
la pré{ence de certains obiets ; ou de I'u–
níon des traces que diver{es {en{ations ont laiírées
dans le cerveau ; ou de la liaifon d'une longue {uite
dé mouvemens, qll'on altra réitérés {ouvent dans le
meme ordre , foit forttútement , {oit
a
deírein.
A
célaJfe rapportent toutes les (Ii{pofitions acquifes par
l'arf.
Un ml¡ficien, un joiieur de luth, un dameur
I
-exécutent les mouvemens les plus variés
&
les plus
ordonnés tout enfemble , d'une maniere tres-exaéte,
fans faire la rnoindre attention a chacun de ces mou–
vemens én particu1ier ::i1 n'intervient qu'un{eul aéte
de la volonté , par ou. ü fe détermine
a
chanter, ou
joiier un tel
air,
&
donne le premier branle aux
e{prits animaux; tout le reíl:e fttit régulierement fans
qu'i1 y perneo Rapportez
a
cela tant d'aétions {ttrpre–
nantes des gens dillraits , des fomnanlbules ,
&c.
dans
tous ces cas les honunes font autant d'automates.
2°.11
y a des mouvemens nantrels tellement in–
;vólontaires, que nous ne faurions les retenir , par
A M·E
exemple,
{:e
méchaniíme admirable qui tend ,\ (011-
ferver I'équilibre, lorfque nous nous baiírons , lorf.–
que nous marchons {m une planche étroite ,
&c.
3
o.
Les gouts
&
les
antipathies nanlrelles pOUf
certains objets , qui dans les enfans précedent le dif–
cernement
&
la connoiírance ,
&
qui quelquefois
dans les perfonnes formées furmontent tous les ef–
forts de la raifon, ont lem fondement dans le mécha–
nirme ;
&
font alltant de preuves de I'influence des
objets fur les mouvemens du corps humain.
4°.
Qn fait combien les paffions dépendent du
degré du mouvement du {ang
&
des impreffionsréci–
proques que prodlú{ent les e{prits animaux fur le
creur
&
fur le cerveau , dont I'union par I'entremi{e
des nerfs eíl: ft étroite. On {ait comment les
impre{~
fions du dehors peuvent exciter ces paffions , ou les
fortifier, en tant qu'elles {ont de {unples
modifica~
tions de la machine. De{cartes dans ron
traité
des
PaJliOlls,
&
le P. Malebranche dans {a
Moralt,
expli–
quent d'une maniere fatisfaifante le jell de la
ma~
chine
a
cet égard ;
&
comment, fans le {ecours d'au–
cune pen{ée, par la corre{pondance
&
la fympa–
thie merveilleu{e des nerfs
&
des mu{cles , chacune
de ces paffions, confidérée comme une émotion tou–
te corporelle, répand fltr le vi{age un certain air
qui lui efi propre, eíl: accompagnée du gefie
&
dll
maintien nanu-el qui la caraétérife ,
&
prochút dans
tout le corps des mouvemens convenables
a
fes
be~
{oins
&
proportionnés aux objets.
11
eíl: aifé de voir 011doivent aboutir toutes ces
réflexions fttr le corps humain , confidéré comme un
automate exiíl:ant indépendamment d'uneame , on
d'un principe de fentiment
&
d'intelligence : c'eíl:
que fi nous ne voyons faire aux bnttes que ce qu'un
tel automate pourroit exécuter en vernl de {onorga–
nifation, ü n'y a , ce femble , aucune raifon qui
nous porte a {uppofer un principe intelligent dans
les bnttes,
&
a
les regarder autrement que comme
de pures machines; n'yayant alors que le préjugé
qui nOllS faire attacher au mouvement des betes , les
memes pen{ées qui accompagnent en nous des
mou~
vemens {emblables.
Rien ne donne une plus jufie idée des automates
Cartéfiens , que la comparai{on employée par
M.
Regis , de quelques machines hydrauliques que I'on
voit dans les grottes
&
dafls les fontaioes de certai–
nes maifons des Grands , Ol! la {eule force de I'eau
déterminée par la difpofition des ttlyaux
,&
par que!–
que preffion extérieure , remue diverfes machines.
Il
compare les ttlyaux des fontaines alOe nerfs; les muf–
cles ,les tendons,
&c.
{ont les autres reírorts qui
appartiennent a la machine; les efprits font I'ean
qui les remue ; le creur efi comme la fource;
&
les
cavités du cerveau {ont les regards. Les objets exté–
rieurs , qui par leur pré{ence agiírent {ur les organes
des {ens des betes , font comme les étrangers qui
entrant dans la grotte ,{elon qu'i1s mettent le pié fur
certains carreaux difpo{és ponr cela, font remuer
certaines figures ; s'ils s'approchent d'une D iane ,
elle fuit
&
{e plonge dans la fontaine; s'ils avan–
cent davantage , un Neptune s'approche ,
&
vient
les
menacer avec ron trident. On peut encore com–
parer les betes dans ce fyfieme,
a
ces orgues qlÜ
joiient différens airs , par le {eul
mouvemen~
des
eaux : il y aura de meme , di{ent les Cartéftens , une
organifation particnlieredans les betes ,que le Créa–
teur y aura produite,
&
qu'il aura diver{ement ré–
glée dans les diverfes e{peces d'animaux , mais t011-
jours proportionnément aux objets, tOlljours par
rapport au grand but de la cori{ervation de Cindivi–
du
&
de I'e{pece. Rien de plus airé que cela au {u–
preme ouvrier , a celui qui connolt parfaitement la
di{pofttion
&
la nature de tous ces objets qu'il a créés_
L'établiifement el'une fi jufie corre{ponelance ne doit
-
rien
















