
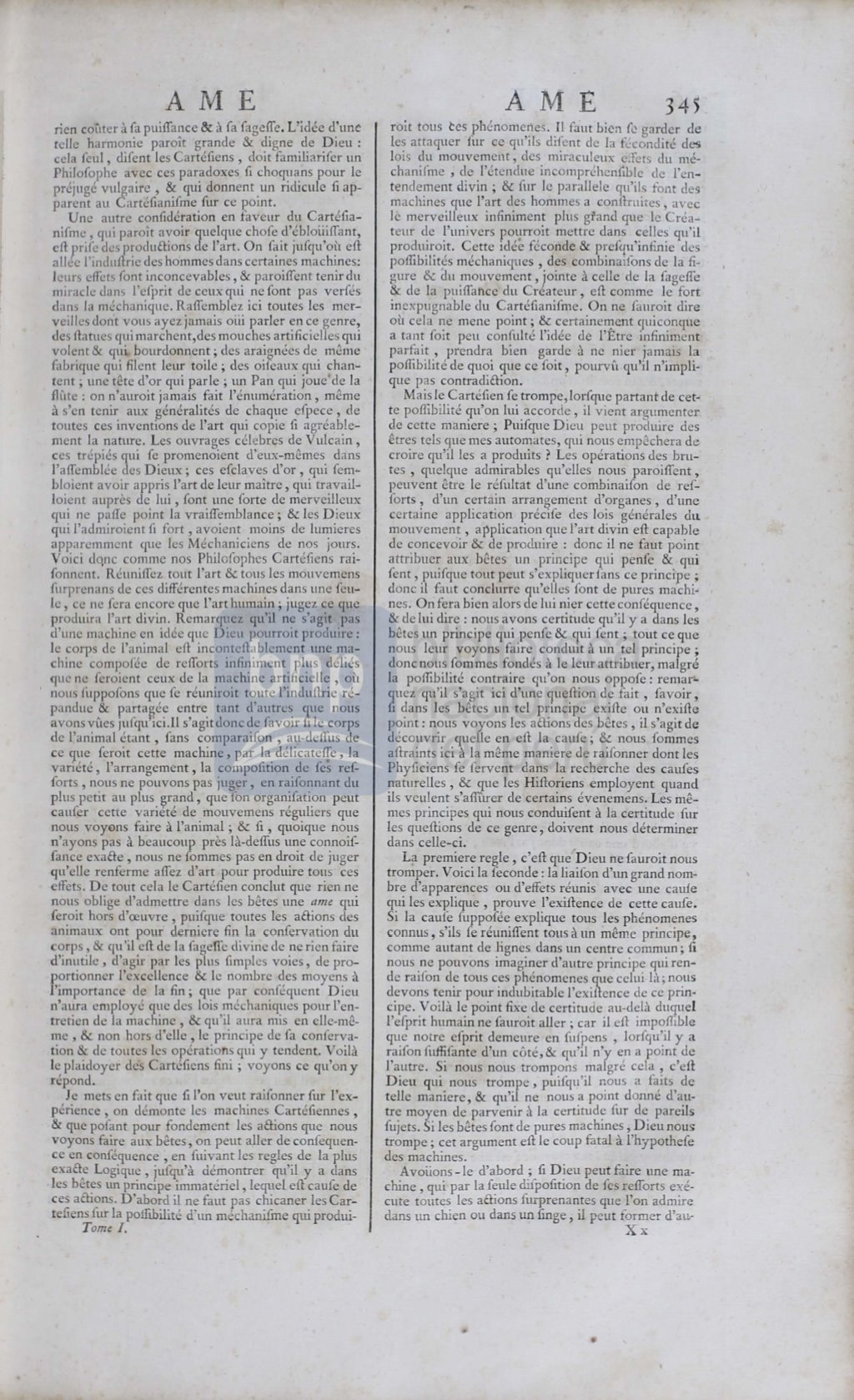
AME
rien cotlter
a
fa pniífance
&
a fa fageífe. L'idée d'une
telle
harmonie paroJt grande
&
digne de D ieu :
cela feul, difent les Cartéíiens, doit familiarifer un
PhiJofophe avec ces paradoxes
fi
choqllans pour le
préjugé vulgaire ,
&
qui donnent un ridicnle fi ap–
parent au Cartéfianifme fur ce point.
Une autre coníidéracion en favenr du Cartéfia–
nifme, qui paroJt avou- quelque chofe d'ébloiiiífant,
ea
prife des produélions de l'art. On fait jufqu'oll ea
allee l'induarie des hommes dans certaines machines:
leurs effets font inconcevables ,
&
paroiífent tenir du
nmaele dans J'efprit de cem: qui ne font pas venés
dans la méchanique. Raífemblez ici toutes les mer–
veillcs dont vous ayez jumais Olli parler en ce genre,
des aatues quimarchent,des mouches artificieUes qui
volent
&
qui bourdonnent; des araianées de m&me
f.1brique qui filem leur toile; des oifeaux qui
chan~
tem; une t&re d'or qui parle; un Pan qui joue'de la
fIllte : on n'auroit jamais fait l'énllméracion, m&me
a
s'en tenir aux généralités de chaque efpece, de
toutes ces inventions de l'art qui copie fi agréable–
mem la nature. Les ouvrages célebres de Vulcain,
ces trépiés qui fe promenoient d'eux-memes dans
I'aífemblée des DietL"(; ces efelaves d'or, qui
fem~
bloient avoir appris l'art de leur maltre , qui travail–
loient aupres de hu, font une forte de merveilleux
qui ne paffe point la vraiífemblance;
&
les D ieux
qui l'admiroient [1 fort, avoient moins de lumieres
apparcmment que les Méchaniciens de nos jours.
Voici
do.nccomme nos Philo[ophes Cartéfiens rai–
{onnent. Réunilfez tout I'art
&
tous les mouvemens
{urprenans de ces différentes machines dans une [eu–
le, ce ne [era encore que l'art humain ; jugez ce que
produira I'art divinoRemarquez qll'il ne s'agit pas
d'une machine en ielée que Dieu pOUIToit produire:
le corps de I'animal ea inconteaablemcnt une ma–
chinc compolee ele reífons infiniment plus eléliés
que nc (eroient ceux de la machine artificielle , on
nous (uppo[ons que (e réuniroit toute l'indufuie ré–
pandue
&
partagée entre tam d'autres que nous
avonsvlles jllfqu
'ici.Ils'agitdoncde favoir fi le corps
dc l'animal étant , (ans comparaifon, au-deífus de
ce 91;le (eroit cene machine, par la délicateífc, la
vanété, l'arrangement, la compofition de fes ref–
{ores, nous ne pouvons pas juger, en raifonnant du
plus pctIt au plus
~rand,
que Ion organifation peut
caufer cene varieté de mouvemens réguliers que
nous voyons fau-e 11 l'animal ;
&
fi , quoique nOllS
n'ayon pas 11 beaucoup pres la-deífus une connoif–
{ance exaae , nous ne fommes pas en Moit de juger
qu'elle renferme aífez d'are pour prodttire tous ces
ctfets. De tout cela le Careéíien conclut que rien ne
nous oblige d'admettre dans les b&res une
ame
qui
{eroir hors d'reuvre, puifque tOutes les aaions des
animaux ont pour derniere 6n la confervation du
orps,
&
qu'il ea de la fagerre divine de ne rien faire
d'inuwe, d'agir par les plus funples voies, de pro-
f,
0rcionner I'excellence
&
le nombre des moyens
a
'Lmportance de la fin; que par conCéquem D ieu
n'aura employé que des lois méchaniques pour l'en–
trerien de la machine ,
&
qu'il aura
mis
en elle-me–
me,
&
non hors d'eUe , le príncipe de fa conferva–
tion
&
de toutes le opérationsqlli y tendent. Voila
le plaidoyer des Cartéfiens 6ni ; voyons ce qu'on y
répond.
Je mets en fait que íi l'on veut raifonner (ur l'ex–
périence , on démonre les machines Cartéfiennes ,
&
que pofam pour fondemenr les aétions que nous
voyons faire aux betes, on pem alier de confequen–
e en conféquence , en ftu ant les regles de la plus
exaéle Logique ,julqu'a démontrer qu'il y a dans
les b&tes un princlpe immarériel, lequel
ea
caufe de
ces alli?ns. D'abord il ne fam pas chicaner les Car–
t
fi
ns fur la pollibilit ' d'un m .chanifine qlU prodtu-
Tome l.
AME
345
roit tous t es phénomenes. II fallt bien f0 garder de
les attaquer fur ce qu'ils di[cm de la fecondité des
lois du mouvemcnt, des miraculeux eJets du mé–
chanilTne , de I'étendne incompréheníible de I'en–
tendement ruvin ;
&
fur le parallele qu'ils fom des
machines que I'art des hommes a confuuites, avec
le merveiUellx in6niment plus grand que le Créa–
teur de l'univers pOUIToit mettre dans celles qll'il
produu-oit. Cette idée féconde
&
prefqu'infinie des
poffibilités méchaniques , des combinaijons de la 6-
gure
&
du mouvement, jointe
a
celle de la fagelfe
&
de la plliífance du Créateur ,
ea
comme le fort
inexpugnable du Cartéfianifme. On ne [amoit dire
Ol!
cela ne mene point;
&
cereainement quiconclue
a tant foir peu confuIté l'idée de l'Eo'c in6niment
parfait, prendra bien garde
a
ne nier jal1lats la
poffibilité de quoi que ce foir, pourvl1qu'il n'impli–
que pas contradiél:ion.
Mais le Careéfien {e trompe,100{que pareant de cet–
te poRibilité qu'on lui accorde, il vient argumenter
de cette manicre; Puifque D ieu peut produire des
etres tels que mes automates, qlli nous emp@chera de
crou-e qu'illes a produits
?
Les opérations des
bru–
tes, quelque admirables qu'elles nous paroiífent,
peuvent etre Ic réfultat d'une combinaifon de ref–
(ons , d'un certain arrangement d'organes, d'une
cereaine applicacion précife des lois générales dtt
mouvement, application que l'aH divin
ea
capable
de concevou-
&
de produire : donc il ne faut poim
attribuer aux betes un principe qui penfe
&
qui
fem, puifque tout peut s'expliqllerlillls ce principe ;
done il fam conclurre qu'elles font de pures machi–
nes. On fera bien alors de ltu nier cette conféquence,
&
tle luí dire : nous avons cercitude qu'il y a dans les
betes un principe qui penfe
&
quí fem ; tout ce que
nous lem voyons faire conduit
a
un tel pli ncipe;
doncnolls fommes fondés
a
le leurattribuer, malgré
la poffibilité contraire qu'on nous oppo[e: remar–
quez qu'il s'agit ici d'une c¡ueaion de fait, favoir,
íi dans les betes un tel pnncipe exiae ou n'exilte
point: nOllS voyons les ailions des betes , il s'agit de
découvrir quelle en
ea
la catúe;
&
nous (ommes
afuaints ici a la meme maniere de raifonner dont les
Phyíiciens fe [ervent dans la recherche des catúes
naturelles ,
&
que les Hiftoriens employent quand
ils veulent s'affi'trer de certains évenemens. Les me–
mes principes qui nous conduífent
a
la certitude fur
les queilions de ce genre, doivent nous déterminer
dans celle-ci.
La premiere
re~le
,
c'ea
que Dieu ne {auroit nous
tromper. Voici la feconde : la liaifon d'un grand nom–
bre d'apparences on d'etfets réunis avec une catúe
qui les explique, prouve l'exillence de cette caufe.
Si la caufe fuppofée explique tous les phénomenes
conm15 , s'ils fe rénniífent tous
a
un meme principe,
comme aurant de lignes dans un centre commun;
íi
nous ne pouvons imaginer d'autre principe qui ren–
de raifon de tous ces phénomenes que celui la; nous
devons tenLr pour indubitable l'exiftence de ce prin–
cipe. Voila le point 6xe de certitude au-dela duquel
l'efprit htunain ne fauroit aller; cal' il
ea
impolIíble
que notre efprit demeure en fufpens , lor{qn'il y a
raifon [uffifame d'un coté,
&
qu'il n'y en a point de
I'autre. Si nous nous trompons malgré cela,
c'ea
Dien qui nous trompe, puifqu'il nous a faits de
telle maniere,
&
qu'il ne nous a point donné d'au–
tre moyen de parvenu- a la
certinld~
fur
d~
pareils
{ujers. Si les betes font de pures machines, D leu nous
trompe; cer argurncnr
ea
le coup fatal a l'hypomefe
des machines.
Avoiions-Ie d'abord ; fi D ieu peut fau-e une ma–
chine , quí par la [eule diípoficion de fes relfores
exé–
cute tolltes les aél:ions furprenames que I'on admire
dans un chien ou dans un finge,
il
peut former d'atlr
Xx
















