
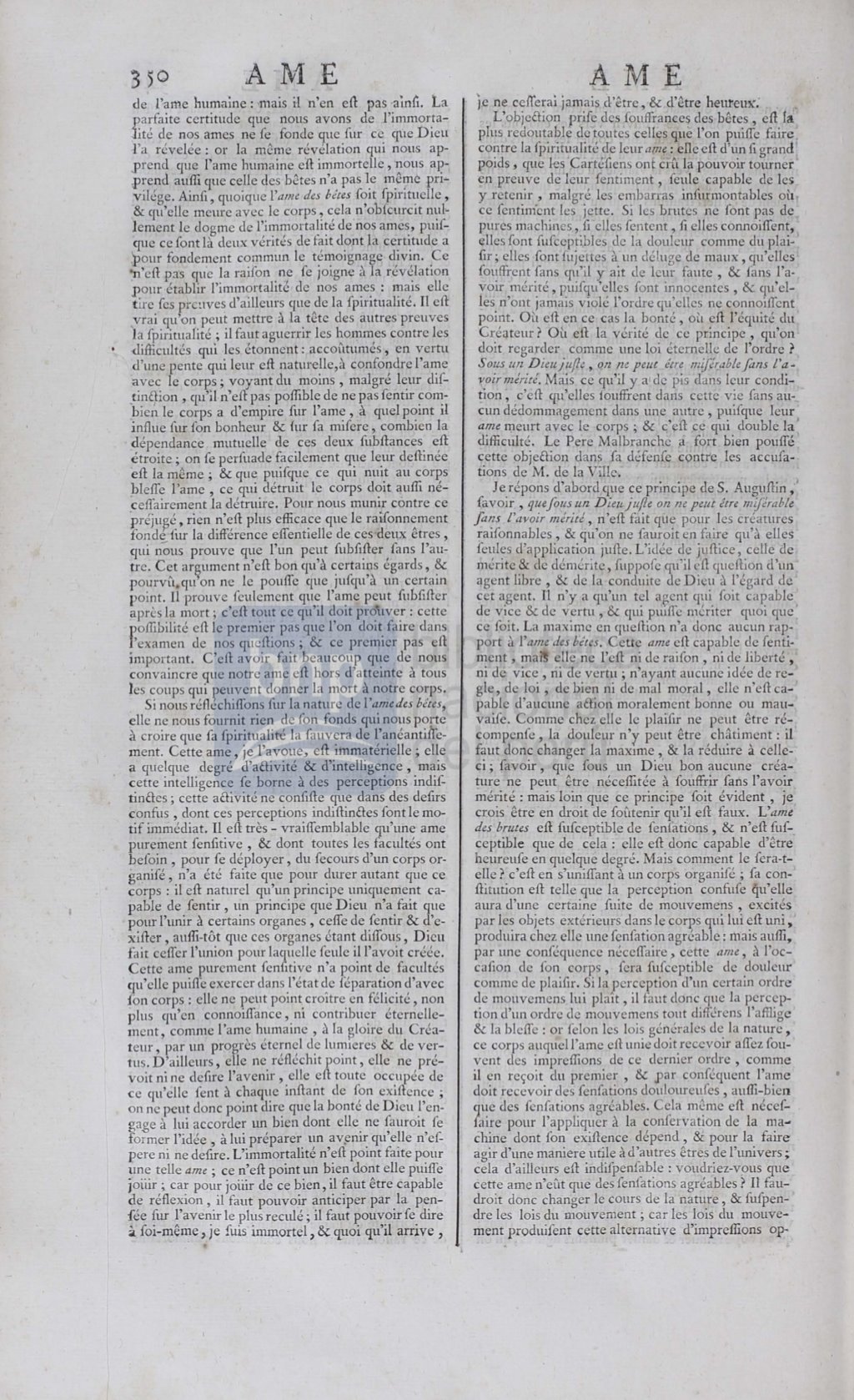
A
Id
E
de l'ame humaine: mais il n'en
ea
pas -ainll.
La
parfaite certitude que nous avons de l'immorta- ,
Jité de nos ames ne [e fondc
~ue
[ur ce c¡ueDieu
1'a réve!ée: or la m&me révelation 'luí nOU5 ap–
prend que ['ame humaine eíl: immortelle, nous ap–
prend auffi que celle des betes n'a pas le meme pri–
vilége. Ainíi, quoique
['ame des
Mm
[~it
fpirit:lclle,
&
qu'elle meure avec le corps, cela n obfcurclt nul"
lement le dogme de I'immortalité de nos ames, pui[–
que ce font la deux vérités de fait dont la certitude a
'pour fondement commun le témoignage divino Ce
'n'efi pas que la rai[on ne [e joigne a la
rév~lation
pour établir l'immortalité dc nos ames : malS elle
tire [cs prelves d'ailleurs que de la [piritualité.
n
eíl:
vrai qu'on peut mettre a la tete des autres preuves
h
[pirituafité ; il faut aguerrir les hommes contre les
clifficultés qUl les étonnent : accofttumés, en verttl
d'une pente qui lem
efl:
naturelle,a confondre l'ame
avec le corps; voyant du moins, malgré leur di[–
.tinéhon, c¡u'll.n'eíl:pas poffible de ne pas fentir com–
bie~
le corps a d'empire [ur l'ame, aquel point il
influe
[lIT
ron bonheur & {ur [a mi[erc, combien la
dépendance mutuelle de ces deux [ubfiances eíl:
étroite; on [e perfuade facilement que leur defunée
efi la meme; & que puí[C
¡l.Iece qui nuit au corps
bleífe l'ame , ce qui détruit le corps doit auffi né–
ceífaircment la détruire. Pour nous munir contre ce
préjupé, rien n'eíl: plus efficace que le raifonnemcnt
fonde
(lIT
la dífférence eífentielle de ces deux etres ,
'luí nous prouve que I'un peut [ubfú1:er fans I'au–
treo Cet argument n'eíl: bon qu'a certains égards, &
pourvll,qu'on ne le pouífe que jufc¡u'a un certain
point.
n
prouve (eulement que l'ame pellt (ub(líl:er
apres la mort; c'efi tout ce qu'il doit prollver : cette
poffibilité eíl: le premier pas qlle l'on doit faire dans
l'examen de nos queíl:ions; & ce premier pas eíl:
important. C'eíl: avoir fait beaucoup que de nous
convaincre que notre ame efi hors d'atteinte
a
tous
les coups qui peuvent donner la mort a notre corps.
Si nousréflechilfons [ur la natme de
l'amedes beces,
elle ne nous fournit rien de ron fonds qui nous porte
a
croire que [a [piritualité la (auvera de l'anéantiire–
mento Cette ame, je l'avoue, eíl: immatérielle; elle
a quelque degré d'aél:ivité & d'intelligence, mais
cette intelligence (e borne
a
des perceptions indif–
tinél:es; cette aél:ivité ne coníifie que dans des deíirs
connls , dont ces perceptions indiíl:inél:es [ont le mo–
tif immédiat. Il eíl: tres - vraiífemblable qu'une ame
purement [eníitive , & dont toutes les facultés ont
be[oin , pour (e déployer, du (ecours d'un corps or–
ganifé, n'a été faite que pour durer autant que ce
corps : il eíl: natme! qll'un principe uniquement ca–
pable de [entir, un principe que Dieu n'a fait que
pour I'unir a certains organes , ceífe de (entir & d'e–
xiíl:er, auffi-tot que ces organes étant diífous, Dicll
[ait ceífer l'union pour laquelle [ellle ill'avoit créée.
Cette ame purement [eníitive n'a point de facultés
CJu'clle puiile exercer dans I'état de íeparation d'avec
ion corps : elle ne peut point croltre en félicité, non
plus qu'en connoiífance, ni contribuer éternelle–
ment, comme I'ame humaine , a la gloire du Cré3-
teur, par 111l progres
éte~n~1
d.e
lu~ieres
& de
ve~·tus. D'ailleurs, elle ne reflechlt pomt, elle ne pre–
voit ni ne de(ue l'avenir , elle eíl: toute occupée de
ce qu'elle [ent achaque inflant de fon exiíl:ence ;
on ne pent donc point dire que la bonté de Dieu I'en–
ga,ge
a
lui accorder un bien dont elle ne [auroit (e
formcr l'idée , a lui préparer un
av~nir
qu'elle n'ef–
pere ni ne deíire. L'immortalité n'efi point faite pour
une telle
ame;
ce n'eíl: point un bien dont elle puilfe
joiiir ; car pour joiiir de ce bien, il faut etre capable
de réflexion, il faut pouvoir anticiper par la pen–
fée fur l'avenir le plus reculé; il faut pouvoir fe dire
a
[oi-meme, je fuis immortel, & quoi qll'il arrive ,
AME
Je ne ceíferai jamais el'etre, & .d'etre heUl'eux;
L'objcél:ion prife des foulfranccs des betcs , ea
t<l
plus redoutable dc toutes celles que I'on puiífe faire
contre la (piritualité efe leur
a(T1e:
elle eíl: d'un íi arand
poids, que les Cartéíiens onf crtt la pouvoir
tO~lrner
en preuve de lcur [entiment, (eule capable de les
y retenir , malgré les embarras inúlrmontables 011,
ce fentim·cnt les jette. Si les brutes ne (om pas de
pures machines , fi elles [entent , Ji elles connoiífent,
elles [ont fufceptibles de la douleur comme du plai–
fir; elles [ont fujettes a un déluge de maux, qu'elles
(ouflTcnt fans qu'ü y ait de 1 ur faute , & (ans l'a–
voir mérité, pui(qu'elles (ont innocentes , & qu'el–
les n'om jamais violé l'ordre qu'ellcs ne connoiífent
point. 011 eíl: en ce cas la bonté, 011 efi l'équité du
Créateur?
Oh
eíl: la vérité de ce principe , qu'on
doit regarder comme une loi éternelle de I'ordre ?
SOlts UlL
Dieujuftc, on
¡ze
pera éere mifirable fons L'a–
yoir méricé,
Mais ce qu'il y a' de pis dans leur condi–
~ion,
e'
O:
qu'elles 10uflTent dans cettc vie fans au–
cun dédommagement dans une autrc, pui[que leur
ame
meurt avec le corps ; & c'eíl: ce qui double la
difficulté. Le Pere Malbranche
,él
fort bien poufré
cette objeél:ion dans fa défen[e contre les accu[a–
tions de M. de la Vi/le.
Je répons d'abord que ce principe de S. Augufiin,
favoir,
'luefous un Dielt jufle on
m
peltt étre
TIlij~mb!e
fons l'avoir mérieé,
n'efi fitit 'lile pour les créamres
rai(onnables,
&
qu'on ne [auroit en faire qu'a elles
(eules d'application juíl:e. L'iclée de jl/íl:ice, celle de
mérite
&
de démérite, [uppo(e qu'il efi quefuon d
'Ull
agenr libre, & de la conduite de Dieu a I'égard de
cet agent.
11
n'y a <¡u'un tel agent qui (oit capable
de vice
&
de verttl ,
&
'lui pU1ífe mériter quoi que '
ce foit. La maxime en queíl:ion n'a done aucun rap–
port ill'ame
des béus.
Cette
ame
eíl: capable de [enti–
ment, mai elle ne l'efi ni de rai(on , ni de liberté,
ni de vice, ni de verhl ; n'ayant aucune idée de re–
gle, de loi , de bien ni de mal moral, elle n'efi ca–
pable d'aucune aél:ion moralement bonne 011 mall–
valle. Comme chez elle le plai(u ne peut etre ré–
compen(e, la dOllleur n'y peut etre chiltiment:
ü
faut donc changer la maXlme ,
&
la réduire
a
celle–
ci; [avoir, que [ous un Dicu bon aucune créa–
ture ne peut etre néceffirée a [ouflTir fans I'avoir
mérité : mais loin que ce principe [oit évident , je
crois erre en droit de [olltenir qu'il efi faux.
L'ame
des bruces
eíl: [ufceptible de [en{ations, & n'efi [u[–
ceptible que de cela: elle eíl: donc capable
d'~tre
heureufe en quelque degré. Mais comment le fera-t–
elle? c'efi en s'uniífant
a
un corps organiCé ; fa con–
flihltion eíl: telle que la perception confu[e <'iu'elle
aura d'une certaine [uite de mouvemens , excités
par lcs objets extérieurs dans le corps qui lui eíl: uni,
produira chez elle 11Ile [enfation agréable: mais auffi,
par une conféquence néccífaire, cette
ame,
a
1'0c–
cafion de ron corps, [era [ufceptible de douleur
comme de plaifir. Si la perceprion d'un certain ordre
de mouvemens lui plalt, il faut donc que la percep–
tion d'un ordre de mouvemens tout différens I'a/llige
& la bleífe : or felon les lois générales de la nature ,
ce corps auque!l'ame eíl: unie doit reccvoir a([ez (ou–
vent des impreffions de ce dernier ordre , comme
ü
en res-oit du premier , & par conféquent l'ame
doit recevoir des [enfations doulolueu[es , auffi-bien
que des (en(ations agréables. Cela meme eíl: néce[–
faire pom l'appliquer a la cOlúervarion de la ma–
cbine dont ron exifience dépend,
&
pour la faire
agir d'une maniere utile
a
d 'autres erres de 1'1lnÍvers;
cela d'aillcurs eíl: indi[pen[able : vOlldriez-vpus que
cette ame n'eí'tt que des (enlations agréables ? Il fau–
droit donc changer le cours de la nature,
&
[u[pen–
dre les lois du mouvement ; car les lois du mouve–
ment produifent cette alternative d'impreffions op'
















