
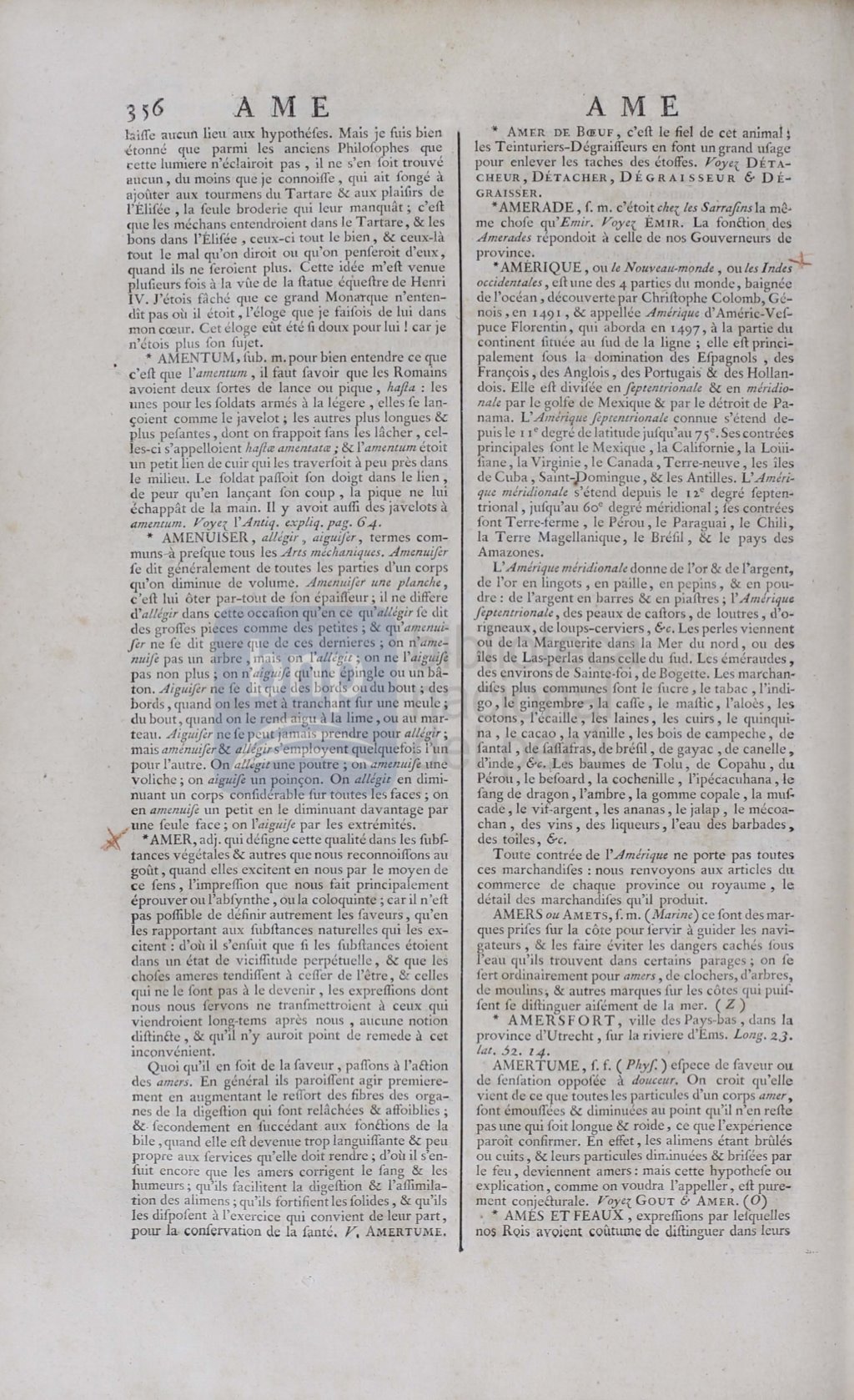
hilfe aueun lien ame hypothéfes. Mais je fi.lis bien
étonné cfue parmi les aneiens Philofophes que
eette lumiere n'éclairoit pas , il ne s'en foit trouvé
!!ucun, du moins que je connoilfe, qui ait
~ongé
a
ajoúter aux tourmens du Tartare
&
aux plalÍirs de
l'Éüfée , la feule broderie qui leur manquat; c'efi
que les méchans entendroient dans le Tartare,
&
les
bons dans l'Élifée, ceux-ci tout le bien,
&
eellx-la
tout le mal qu'on diroit ou qu'on penferoit d'eux,
quand ils ne
feroie~t
plus. Cette
~d~e
m'efi
venu~
plufieurs fois
a
la vue de la fianle equefue de Henn
IV. J'étois filché que ce grand Monarque n'enten–
rut pas Oll il étoit, l'éloge que je fai{ois de lui dans
mon ereur. Cet
élo~e
eih été íi doux pour lui
!
car je
n'étois plus ron fUJet.
*
AMENTUM, fub. m. pom bien entendre ce que
c'efi que
l'amentum,
il faut favoir que les Romains
avoient deux fortes de lance OH pique,
hafia
:
les
unes pour les foldats armés
a
la légere , elles fe lan–
~oient
comme le javelot ; les mmes plus longues
&
plus pefantes , dont on frappoit fans les lacher , cel–
les-ci s'appelloient
/zafire amentatre;
&
l'
amentum
étoit
un petit líen de cuir qui les travenoit
a
peu pres dans
le milieu. Le foldat paífoit fon doigt dans le líen,
de peur Cfu'en lanc;:ant fon coup , la pique ne lui
échappat de la main. Il y avoit auffi des javelots
a
amenmm. Voye{ l'Antiq. expliq. pago 64.
*
AMENUISER,
atllgir> aiguijer,
termes com–
muns-a prefque tous les
Arts méclzaniques. Amcnuifer
fe dit généralement de toutes les parties d'un corps
qu'on diminue de volumé.
Altlenuifer une planche,
c'efi lui oter par-tout de fon épaif'feur; il ne cliffere
d'aLlégir
dans cette occaíion qu'en ce
qu'aLUgir
fe dit
des grolfes pieces eomme des petites ;
&
qu'
ameTtui–
fer
l1e fe dit guere que de ces clernieres ;
011
n'
ame–
nuijé
pas un arbre, mais on
¡'alUgie;
on ne
l'aiguife
pas non plus;
011
n'
aiguife
qll'une épingle ou un ba–
ton.
Aiguifer
ne fe dit que des botds ou du bOllt ; des
hords , qual1d on les met
a
tranchant fur une meule ;
du bout, qlland on le renel aigu
a
la lime, ou au mar–
teau.
Aiguifer
ne fe peut jamais prendre pour
aLLégir;
mais
amémtifer& alLégirs'employent
quelCfuefo:sl'un
pour l'autre. On
aLlégÍlune
poutre; on
amenuijé
Une
voliche ; on
aiguijé
un poinc;:on. On
allégit
en dimi–
nuant
UI1
corps confidérable {ur tóutes les faces; on
en
amenuife
un petit en le diminuant davantage par
une {eule face; on
l'aiguije
par les extrémités.
)i
r"
*
AMER, adj. qui déíigne ,ette quilité dans les fubf–
tances végétales
&
autres que nous reconnoiífons au
goút, quand elles excitent en nous par le moyen de
ce fens, l'impreffion que n011S fait principalement
éprouver ou l'abfynthe ,ou la coloquinte ; car il n 'efi
pas poíIible de définir autrement les faveurs , qu'en
les rapportant aux fubílances naturelles qui les ex–
citent : d'Oll il s'enfuit que íi les fubfiances étoient
dans un état de viciffitude perpétueLle,
&
que les
cho{es ameres tendiífent
a
celfer de l'etre,
&
eelles
c¡ui
ne le {ont pas
a
le devenir, les expreffions dont
notls nOllS fervons ne tran{mettroient
a
ceux 'lui
viendroient long-tems apres nous , aueune notion
difiinél:e ,
&
Cju'il n'y auroit point de remede
a
cet
inconvénient.
Quoi qu'il en foit de la {aveur , palfons
a
l'aél:ion
des
amers.
En général ils paroilfent agir premiere–
ment en augmentant le reífort des fibres des orga–
nes de la di<Yefiion qui font reHlchées
&
affoiblies ;
& .
{econde¡{;'ent en fuccédant aux fonilions de la
bile ,quand elle efi devenue trop languilfante
&
peu
1Jropre aux fervices Cjll'elle doit rendre; d'oII il s'en–
{uit encore Cjlle les amers corrigent le fang
&
les
humeurs ; qu'ils facilitent la dicreilion
&
l'aíJimila–
tion des alimens ; qu'ils fortifie:r: les {olides,
&
Cjll'ils
les dUpofent
a
l'exercice Cjlli convient de leur part,
pour la confervation de la fanté.
V.
AMERTUME.
'A M
E
'" AMER DE BO>:UF, c'efi le fiel de cet animal;
les Teinturiers-Dégrailfeurs en font un grand ufage
pour enlever les taches des étoffes.
Voye{
D ÉTA–
CHEUR,DÉTACHER,DÉGRAISSEUR
&
D É~
GRAISSER.
*
AMERADE,
f.
m. c'étoi.t
chef., les Sarrajins
la me·
me chofe
crl'Emir. Voye{
EMIR. La fonél:ion des
Amerades
repondoit
a
celle de nos Gouvernetrrs de
provinc~.
-.."l.
*
AMERIQUE, onle
Nouveau-monde
,
ou
les Indes
occidentales,
eíl une des 4 parties du monde, baignée
de l'océan, découverte par Chrlílophe Colomb, Gé–
nois,en 1491,
&
appellée
Amérique
d'Améric-Ve{~
puce Florentin, CjllÍ aborda en 1497,
a
la partie du
continent íituée au fud de la ligne ; elle eíl prinei–
palement fous la domination des Efpagnols , des
Franc;:ois,
des Anglois, des Portugaii
&
des Hollan–
dois. Elle eíl divifée en
feptentrionale
&
en
méridio–
nale
par le golfe ele Mexique
&
par le détroit de Pa–
nama.
L'Amériqueflptentrionale
connue s'étend de–
puisle
1 l e
elegré de latitude jllfqu'au75e. Sescontrées
principales font le Mexic¡ue , la Californie, la Loiü–
fiane, la
Vir~inie
, le Canada , Terre-m,uve , les iles
de Cuba, Samt-pomingue,
&
les Antilles. L'
Améri–
que méridionale
s'étencl depuis le
lloe
degré {epten–
trional, ju{c¡u'au
60·
degré méridional ; {es contrées
font Terre-ferme, le Pérou, le Paraguai, le
Chili~
la T ene Magellani'lue, le Bréfú,
&
le pays des
Amazones.
L'
Am¿riqlle méridionale
donne de 1'or
&
de 1'argent,
de l'or en Lingots , en paille, en pepins,
&
en
'p0u–
dre: de l'argent en balTes
&
en piaílres; l'
Amerique
flptentrionale,
des peaux de caílors , de loutres, d'o–
rigneaux, de loups-cerviers ,
&c.
Les perles viennent
ou de la Marguerite dans la Mer du nord, ou des
iles de Las-perlas dans celle du nld. Les éméraudes ,
des environs de Sainte-foi, de Bogette. Les marchan–
difes plus communes (ont le fuere, le tabac ,l'indi–
go, le gin!7embre
>
la calfe, le mafiic, l'aloes, les
cotons, l'ecaille, les laines, les cuirs, le quinqui–
na , le cacao, la vánille , les bois de campeche, de
fantal , de falfafras, de bré{ú , ele gayac , de canelle ,
d'inde,
&c.
,Les baumes de Tolu, de Copahu, du
Pérou, le befoard, la cochenille, l'ipécacuhana, le
fang de dracron, l'ambre, la gomme copale , la muf.
cade, le vif-argent, les ¡manas, le jalap, le mécoa–
chan, des vins, des liqueurs, l'eau des barbades .
des toiles,
&c.
T oute contrée de
l'
Amérique
ne porte pas toutes
ces marchandi{es : nous renvoyons aux articles du
commerce de chaCjlle province ou royaume, le
détail des marchandifes Cjll'il produit.
AMERS
ou
AMETS,
f.
m.
(Marine)
ce font des mar–
Cjlles prifes fur la cote pour fervir
a
guider les
navi~
gateurs ,
&
les faire éviter les dangers cachés
iaus
l'eau qu'ils trollvent dans certains parages; on fe
fert ordinairement pour
amers,
de c1ochers, d'arbres.
ele moulins,
&
autres marCjlles nlr les cotes
c¡ui
puif–
fent fe diilinguer aifément de la mer.
(Z)
*
AMER S F O R T , ville des Pays-bas , dans la
provinee d'Utrecht, fuI' la riviere cl'Ems.
Long.
23.
Lat.
..
52. z4-
AMERTUME, f.
f. (
Phyf
)
e{pece de faveur
Ol!
de fen{ation oppo{ée
a
dOllceur.
On croit Cjll'elle
vient de ce que toutes les particules d'un corps
amer,
font émoulfées
&
diminuées au point c¡u'il n'en reíle
pas une qui {oit longue
&
roide, ce Cjlle l'expérience
parolt confirmer. En effet, les alimens étant brttlés
ou cuits ,
&
leurs particules dirr.muées
&
brifées par
le feu, deviennent amers : mais cette hyporhefe
Ol!
explication, comme on voudra l'appeller, eíl pure–
ment copjeél:urale.
Voye{
GOUT
{,>
AMER.
(O)
*
AMÉS ET FEAUX, expreffions par leiCjllelles
nos RQis aVQient COlltume de diítinguer dans leurs
















