
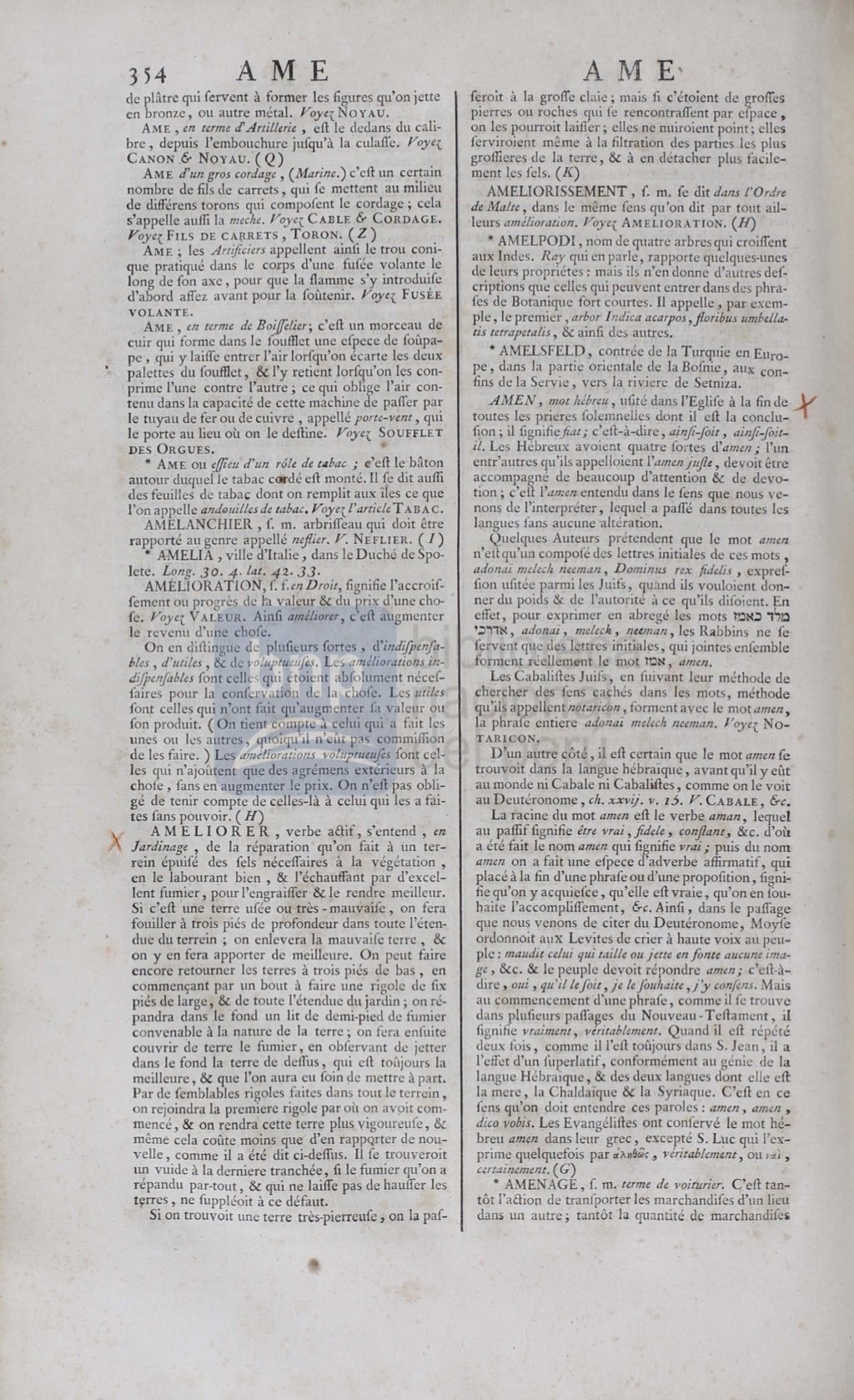
354
A M E
de platTe qui fervent a former les figures qu'on jette
en bronze, ou autre métal.
Yoye{
NoyAU.
AME,
en Nrme
ti'
Artillerie,
eílle c1edans du cali–
bre, deptús
l'embOt~chure
jtúqu'a la
culaife. Yoye{
CANON .& NOYAU.
e
Q )
AME
d'un gros cordage
,
e
Marine.)
c'eíl un certain
nombre de fils ele carrets, qui [e mettent au müieu
de différens torons qui compo[ent le cordage; cela
s'appelle auffi la
mecltt. Yoye{
CABLE & CORDAGE.
Yoye{
FILS DE CAllRETS , TORON.
e
z)
AME; les
Artijiciers
appellent ainíi le trOLl coni–
que pratiqué dans le corps d'une fufée volante le
long de fon axe, pour que la flarnme s'y introduife
d'abord aKez avant pour la fOlltenir.
Yoye{
FUsÉE
VOLANTE.
AME,
en ttrme de Boiffilier;
c'eíl un morceau de
cuír qui forme dans 1 fouffiet une efpece de foupa–
pe, ,'luí y laii[e entrer l'air lorfqu'on écarte les deux
palettes du fouffiet, & I'y retient lorfqu'on les con–
prime l'une contre l'autre; ce qui oblige l'air con–
tenu dans la capacité de cette machine de paífer par
le tuyau de fer ou de cuivre , appellé
porte-vent
,
qui
le porte au lieu oll on le deiline.
Yoye{
SOUFFLET
DES ORGUES.
*
AME ou
dJieu ¿'un role de tllbac
;
c'eílle baton
autour duquelle tabac cordé eíl monté. Il fe dit auffi
des fetúlles de taba, dont on remplit aux ¡les ce que
l'on appelle
andouiltesde tabaco Yoye{ l'articleTABAC.
AMELANCHIER ,
f.
m. arbríifeau qui doit etre
rapporté au genre appellé
neJlier. Y.
NEFLIER.
e
I)
*
AMELIA, ville d'Italie, dans le Duché de Spo-
lete.
Long.
30.
4-
lal.
42.33.
.
AMÉLIORATION, [.
f.enDroit,
/ignifie l'accroif–
fement ou progres de la valeur & du prix d'tme cho- '
[e.
Yoye{
VALEUR. Ainíi
améliorer,
c'eíl augmenter
le revenu d'une chofe.
On en diílingue de pluíiturs [ortes,
d'indifpenfa–
bies , d'utiles
,
& de
voLupllIeufes.
Les
améliorations in–
difpenfables
[ont celles qui étoient abfolument nécef–
faires pour la confervation de la chofe. Les
llliüs
font celles qui n'ont fait qu'augmenter fa valeur ou
fon produit.
e
On tient compte a celui qui a fait les
unes ou Il!s autres, quoíqu'ü n'ellt pas commiffion
de les faire. ) Les
amélioralÍons voluptueufis
font cel–
les qui n'ajoí'ttent que des agrémens extérieurs a la
chofe, fans en augmenter le prix. On n'eíl pas obli–
gé de tenir compte de eeHes-la a celui qui les a fai–
tes fans pouvoir.
e
H)
A M E L I
o
R E R , verbe aél:if, s'entend ,
en
Jardinage
,
de la réparation qu'on fait a un ter–
rein élJtwé des fels néceífaires a la végétation ,
en le labourant bien, & l'éehauffant par d'excel–
lent fumier, pour l'engraiífer & le rendre meüleur.
Si c'eíl une terre túée ou tres - mauvaife, on fera
fOtúller
a
trois piés de profondeur dans toute l'éten–
due du terrein ; on enlevera la mauvaife terre, &
on y en fera apporter de meilleure. On peut faire
encore retourner les terres
a
n'ois piés de bas, en
commenc;:ant par un bout a faire une rigole de íix
piés de large, & de toute l'étendue du jardin ; on ré–
pandra dans le fond un lit de demi-pied de fumier
convenable a la nattue de la terre; on fera enfuite
eouvrir de terre le ñlmier, en obfervant de jetter
dans le fond la terre de deífus, qui eíl tOlljours la
meiHeure, & que l'on aura eu foin de mettre a parto
Par de femblables rigoles faites dans tout le terrein,
on rejoindra la premiere rigole par oll on avoit eom–
meneé, & on rendra cette terre plus vigoureufe, &
meme eela cOllte moins que d'en rapPQrter de nou–
velle, comme ü a été dit ci-deífus. Il fe trouveroit
un vuide a la derniere tranchée, fi le fumier c¡u'on a
répandu par-tout, & qui ne laiífe pas de hauifer les
trrres, ne ftlppléoit a ce défaut.
Si on trouvoit une terre tres-pierrel1fe, on la paf-
A
M E'
feroit a la groífe claie; mais fi c'étoient de groífes
pierres ou roches qlÚ fe rencontraífent par efpace ,
on
l~s
I?Oltrl'oi! laurer; elles ne nl1iroient point; elles
fervlrolent meme a la filtration des parties les plus
groffieres de la teITe, & a en détacher plus facile–
ment Les fels.
e [()
AMELIORISSEMENT,
f.
m. fe dit
dans tGrdre
de Malte,
dans le meme fens qu'on dit par tout ail–
lettrs
am¿liorauoll. Yoye{
AMELIORATION.
eH)
*
AMELPODI, 110m de quatre arbresqui croiifent
aux Indes.
Ray
qtú en parle, rapporte quelques-unes
de leurs propriétes: mais ils n'en donne d'autres def–
criptions que celles qui peuvent entrer dans des phra–
fes de Botaniqtle fort courtes. Il appelle , par exem–
pIe, le premier ,
arbor Indica acarpos ,jloribus umbella–
tis tetrapetalis,
&
ainfi des autres.
*
AMELSFELD, contrée de la TurqtlÍe en Euro–
pe , dans la parrie orientale de la Bo[nie, aux con–
ñns de la Servie, vers la riviere de Setniza.
AMEN, mOllzébreu ,
u{¡té dans l'Eglife a la fin de
V
toutes les prieres folemnelles dont il eíl la conclu-
'1
fion; il íignifiefiat; c'eíl-a-dire,
ainfl-foit, ainfl-foit-
il.
Les Hébreux avoient quatre fortes d'
amen;
I'un
entr'autres qtl'ils appelloient
l'amenjufle,
devoit en-e
accompagné de beaucoup d'attention & de devo–
tion; c'eH
I'amen
entendu dans le fens que nous ve–
nons de l'interpréter, lequel a pa([é dans toutes les
langues fans aucune altération.
Quelques Auteltrs prétendent qtle le mot
amen
n'ell:qu'un compofé des lettres initiales de ces mots ,
adonai
n~eLecl, ne~man,
pominus
r~x
fidelis
,
expref–
fion u/itee parrm les ltllfs, quand ils vouloient don–
ner dll poids
&
de l'autorité a ce qtl'ils difoient. En
effet, pour exprimer en abregé les mots
lON;'
,So
';''''N,
adona'i, meleck, neeman,
les Rabbins ne fe
fervent que des lettres initiales, '-[ui jointes enfemble
forment réellement le mot
lON,
amen.
Les Cabaliíles Juifs , en fuivant leur méthode de
chercher des fens cachés dans les mots, méthode
qtl'ils
appellentnotaricon,
forment avec le mot
amen
la phrafe entiere
adona'i melech neeman. l'oye{
No~
TARICON.
D'tUl autre coté, il eíl certain que le mot
amen
fe
trouvoit
da~s
la
lan~le hébr~i'que,
avant qt¡'jl
y
eltt
al! monde
nI
Cabale
nI
Cabal}il:es, comme on le voit
au Deutéronome,
cit. xrvij. v. zj. V.
CABALE,
&c.
La racine du mot
amen
eíl le verbe
aman,
leque!
au paffif fignifie
étre
vrai, fidele, conflant,
&c. d'olt
a été fait le nom
amen
qtli fignifie
vrai;
puis du nom
amen
on a fait une efpece d'adverbe affirmatif, qui
placé a la fin d'une phrafe ou d'une propofirion, fiO'ni–
fie qu'on
y
acquiefce, qu'elle eíl vraie, qtl'on en füu–
haite l'accompliírement,
&c.
Ainfi, dans le paífage
qtle nous venons de citer du Deutéronome, Moyfe
ordonnoit aux Levites de crier
a
haute voix au peu–
pIe:
maudit eellli 'lui taille ou jelle en flnte aUcune ima–
ge,
&c. & le peuple devoit répondre
amen;
c'eíl:-a–
dire,
ouí, 'llt'il lefoit, je
le
fouhaite
,j'y
confons.
Mais
au commencement d'une phrafe, comme
il
fe trouve
dans plufieurs paílapes du Nouveau-Teílament, iI
fignifie
vraiment, veritablemem.
Quand il eíl répété
deltx fois, comme ill'eíl toujOltrS dans S. Jean, ü a
I'efiet d'un fuperlatif, conformément au génie de la
langue Hébrai'que, & des deux langues dont elle eíl:
la mere, la Chaldalqtle & la Syriaqtle. C'eíl en ce
fens qu'on doit entendre ces paroles :
amen, amen,
dieo vobis.
Les Evangélilles ont confervé le mot hé–
breu
amen
dans lem grec, excepté S. Luc qui I'ex–
prime quelc¡uefois par
';A"B¡;~,
véritablement,
OH
.<tl ,
certainemenl.
e
G)
*
AMENACE,
f.
m.
mme dt voiturier.
qeíl tan–
tot l'aél:ion de tran(porter les marchandifes d'un ljeu
dans un autre ; tantot la qtmntité de marchandifei
















