
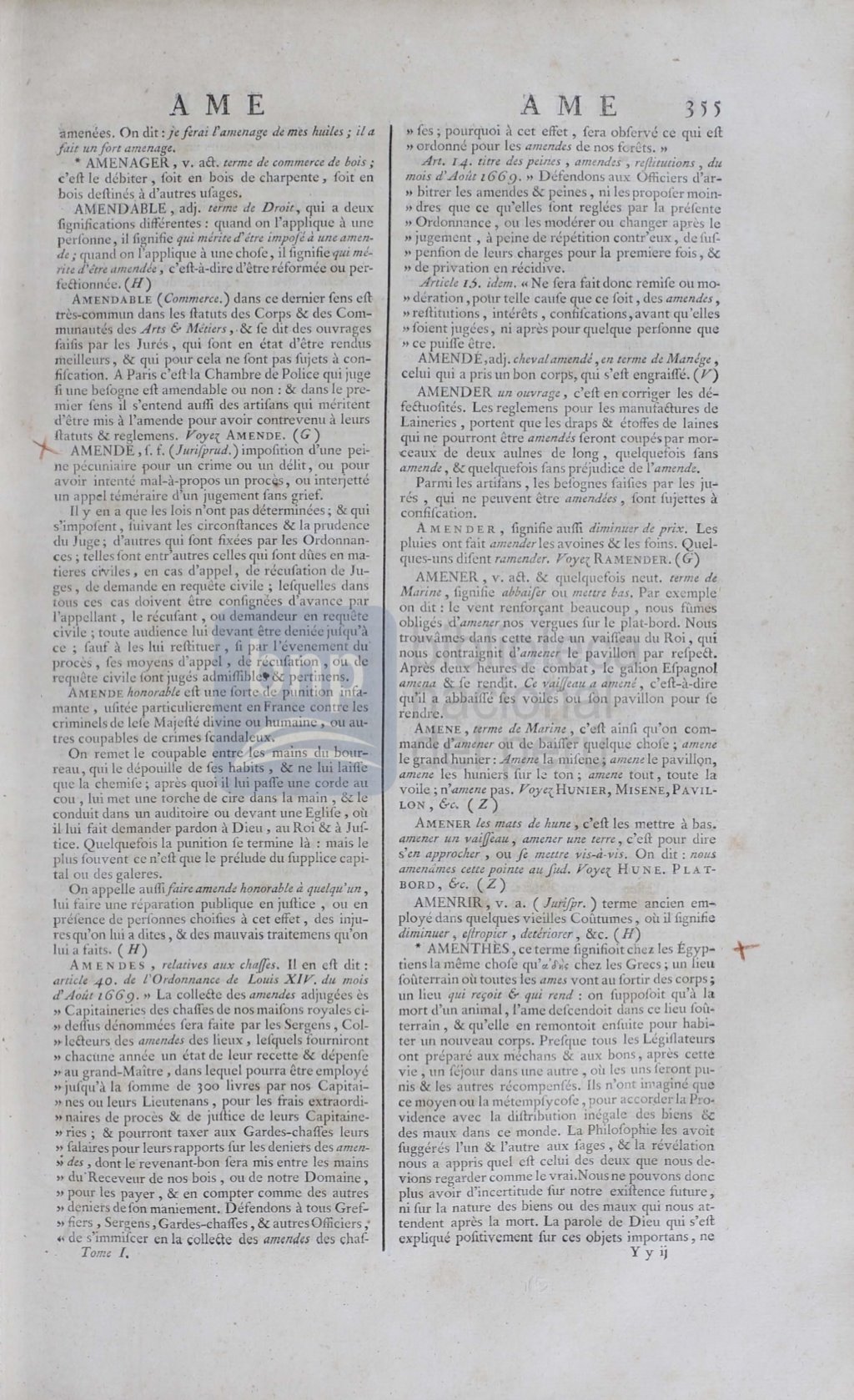
A_
M E
amenées. On dit :
je ferai l'amenage de mes Imiles; ila
foit un.Ion amenage.
*
AMENAGER, v. aél-.
terme
d~
commerce
d~
hois;
c'eft le débiter, foit en bois de charpente, foit en
bois deftinés a d'autres ufages.
AMENDABLE, adj.
mme de Droit,
qni a deux
fignifications dilféFentes: quand on l'applique
a
une
perronne, il fignifie
qui mérúed'étre impof;a une amen–
de;
cfl~and
on
I'a'ppli~'ue ~ l~e c\~ore,
i}
figni~e'1ui
mé–
nte
d'erre llmendee,
c eft-a-dlIe d etre reformee ou per–
feél-ionnél::.
(H)
AMENDABLE
(Commerce.)
dans ce dernier fens eft
tres-commun dans les ftatuts des Corps
&
des Com–
munautés des
Arts
&
Meíiers, .
&
fe dit des ouvrages
(aifis par les Jurés, qui font en état d'etre rendus
meillems,
&
qui pour cela ne font pas liljets
a
con–
Mcation. A Paris c'eft·la Chambre de Police qui juge
fi
une befogne eft amendable on non:
&
dans le pre–
mier Ú;!ns il s'entend auili des artirans qui méritent
d'etre mis a l'amende pour avoir contrevenu a leurs
fiatuts
&
reglemens.
Voye{
AMENDE.
(G)
AMENDE,
r.
f.
(Juri(prud.)
impofition d'une pei–
ne pécuniaire pOll!' un crime ou un délit, OU pour
avoir imenté mal-a-propos un proces, ou interjetté
un appel
t~méraire
d'un jugement fans grief.
Il y en a que les lois n'ont pas déterminées;
&
qui
s'impoienr, íüivant les circonaances
&
la prudence
au ]uge; d'autres qui font fixées par les Ordonnan–
ces; telles ront entr'autres ceHes qni (ont dí'tes en ma–
tieres civiles, en cas d'appe!, de récufation de Ju–
ges, de demande en requete civile ; lefquelles dans
tous ces cas doivent etre confignees d'avance par
l'appellant, le récufant , on demandeur en requete
civile ; toute audience lui devant etre deniée julqu'a
ce ; (anf a les lui reilinler, fi par l'évenement du
proces, (es moyens d'appel, de récuCation , ou de
recfllete civile font jugés
admiilible~
&
pertinens.
AMENDE
honorahLe
eft une forte de punition infa–
mante, ufitée particulierement en France contre les
criminels de lefe Majefté divine ou humaine, ou au–
tres coupables de crimes fcandaleux.
On remet le coupable entre les mains du bour–
reau, cflli le dépouille de fes habits ,
&
ne lui lailfe
que la chemire; apres quoi il lui palfe une corde au
cou , lui met une torche de cire dans la main ,
&
le
conduit dans un auditoire ou devant une Eglife , Oll
illui fait demander pardon ¡'¡ Dieu, au Roi
&
a Juf–
tice. Quelquefois la punition fe termine la : mais le
plus fouvent ce n'ea que le prélude du fupplice capi–
tal ou des galeres.
On appelle
auilifaire amende honorahle a quelqu'lln,
lui faire une réparation publique en juftice , ou en
pré(ence de pe¡{onnes choifies a eet elfet, des inju–
res qu'on lui a dites,
&
des mauvais traitemens qu'on
lui a faits.
(H)
A
M
ENDE
S ,
relatives aux chaiJes.
Il en eft dit :
anicie
40.
de l'Ordonnance de Louis
XIV,
du mois
d'Aoút
z669.»
La cQlleél-e des
amendes
adjugées es
»
Capitaineries des chaíres de nos maifons royales ei–
.»
delfus dénommées [era faite par les Sergens , Col–
»
lcél-eurs des
alllendes
des lienx, lefcIuels fourniront
" chacune année un état de leur recette
&
dépenfe
"au grand-Maltre , dans lequel pourra etre employé
" jufqu'¡'¡ la (omme de
300
livres par nos Capitai–
,/ nes ou leurs Lieutenans , pour les rrais extraordi–
»
naires de proces
&
de juíl:ice de leurs Capitaine–
»
ries;
&
PQllrront taxer aux Gardes-chalfes leurs
" (alaires pour leursrapports fur les deniers des
amen–
,;
des,
dont le revenant-bon (era mis entre les mains
" du"Reeeveur de nos bois, ou de notre Domaine,
»
pour les payer,
&
en compter comme des antres
" deniers de Con maniement. D éfendons a tous Gref–
"fiers, Sergens, Gardes-chaifes,
&
autres Offieiers,
f<
de s'immifcer en la colIeUe des
amendes
des chaC-
Tome l.
AME
355
" fes; pourquoi
a
cet elfet, fera obfervé ce qui eíl:
»
ordonné pour les
amendes
de nos f"rets.
»
Art.
14.
litre
des peines
,
amendes ,reftittttions d,t
mois d'Aoltt
z669.»
Défendons aux Officiers
d~ar" bitrer les amendes
&
peines, ni lesprepofer moin–
>J
dres que ce qu'elles (ont reglées par la préfente
" Ordonnance , ou les modérer ou changer apres le
»
jllgement , a peine de répétition contr'ellx, de fuf–
" peníion de lellrs charges pour la premiere fois ,
&
»
de privation en récidive.
Anide
[05.
idem.
"Ne fera faitdonc remife ou mo–
)1
dér?tio~l
, pOI:r
t~II;
caufe q,ue
c~
foit, des
a71le~des
,
"reftJtlltlOns, mterets , confifcatlons, avant qu elles
»
foient jugées, ni apres pour quelque perfonne que
»
ce puilfe etre.
AMENDÉ,adj.
c1uvalamend; ,en terme de Manége
,
celui qui a pris un bon
corp~,
c¡ui 'eft engrailfé.
(V)
AMENDER
un ouvrage,
e'eíl: en corriaer les dé–
feél-uofités" Les reglemens pour les
manu~aél-mes
de
Laineries , portent 'lIle les draps
&
étolfes de laines
qui ne pourront etre
amendés
feront coupés par mor–
'Ceaux de deux auInes de long, quelquefois fans
amende,
&
quelcfllefois fans préjudice de l'
amende.
Parmi les
art¡¡~lJ1s
, les belognes faifies par les
ju~
rés , qui ne peuvent etre
amendées,
font fujettes
a
confi(cation.
A MENDER , fignifie auffi
diminuer de prix.
Les
pluies om fait
amender
les avoines
&
les foins. Que!–
qucs-uns di(ent
ramender. Voye{
RAMENDER.
(G)
AMENER,
V.
aél-.
&
quelquefois neut.
terme de
Marine ,
fignifie
ahhaifer
on
mmre has.
Par exemple
on dit : le vent
renfor~ant
beaucoup , nous fllmes
obligés
'(]'amener
nos yergues fm le pIat-bord. NOl1s
trouvames dans cette rade un vaifTeau du Roi, c¡ui
nous contraignit
d'amener
le pavillon par refpeél-.
Apres dellx heures de combat, le galion Efpagnol
amena
&
fe rendit.
Ce vaij/eau a amené ,
c'eft-a-dire
qu'il a abbailfé fes voiles ou ron pavillon pour fe
remIre.
AMENE,
terme de Marine,
c'eft ainíi qu'on eom–
mande
d'amener
ou de bailfer quelque chofe;
amene
le grand hunier:
Amene
la mifene;
amene
le pavillQn,
ament
les huniers fur
Le
ton;
amene
tout, toute la
voile;
n'amene
¡>as. P'oye{HUNIER, MISENE, PAVIL–
LON,
&c.
(Z)
AMENER
les mats de hune>
c'eft les mettre abas.
amener un vaifJeau, amener U/le terre,
c'eft pour dire
s'en approc1ler,
OU
fe
mettre vis-a-vis.
On dit :
nOllS
amenames ceue poime au
frul.
Voye{
H
U N E.
P
L A T–
BORD,
&c.
(Z)
AMENRIR, v. a.
(lllriJPr.
)
terme ancien em–
ployé dans quelc¡ues vieilles COlltumes, Oll il iignifie
diminuer,
ellrop~er
,
detériorer,
&c.
(H)
*
AMENTHES, ce terme fignifioit chez les Égyp–
tiens la meme chofe
C[lI',';J'~~
chez les Grecs; un Iiell
[ollterrain Olt toutes les
ames
vont au forrir des corps;
un líeu
qui re90it
&
<¡Ul
rend
:
on fuppofoit qll'a la
mort d'un animal, l'ame defeendoit dans ce lieu fOll–
terrain,
&
c¡u'elle en remontoit enfuite pour
habj~
ter un
~lOu,:eall
co;-ps. Prefc¡ue tous les Légiflateurs
ont prepare al1X mechans
&
aux bons,
al~res
cette
vie, un féjollr dans Illle auU'e ,oil les
lI~S
íer?n,t
PII–
nis
&
les alltres récompenfés. Ils n'ont ll1'agll1e que
ee moyen OH la métemp(ycore , pour
accor.de~·
la P!'o–
vidence avec la difiribution inégale des blens
&
des maux dans ce monde. La Philofophie les avoit
fuggérés ['un
&
l'autre
au~
fages,
&
la révélation
nous a appris quel eft cclUl. des dew{ que nous de–
vions regarder comme le vral.Nous ne pOllvons done
plus avoir d'incertitu?e fur notre exiíl:enc.e future,
ni fLu la nanlre des bleJIS ou des mallX qm nous at–
tendent apres la mort. La parole de Dieu C¡lÚ s'dl:
expliqué pofltivcment fur ces objets importans, ne
Yyij
















