
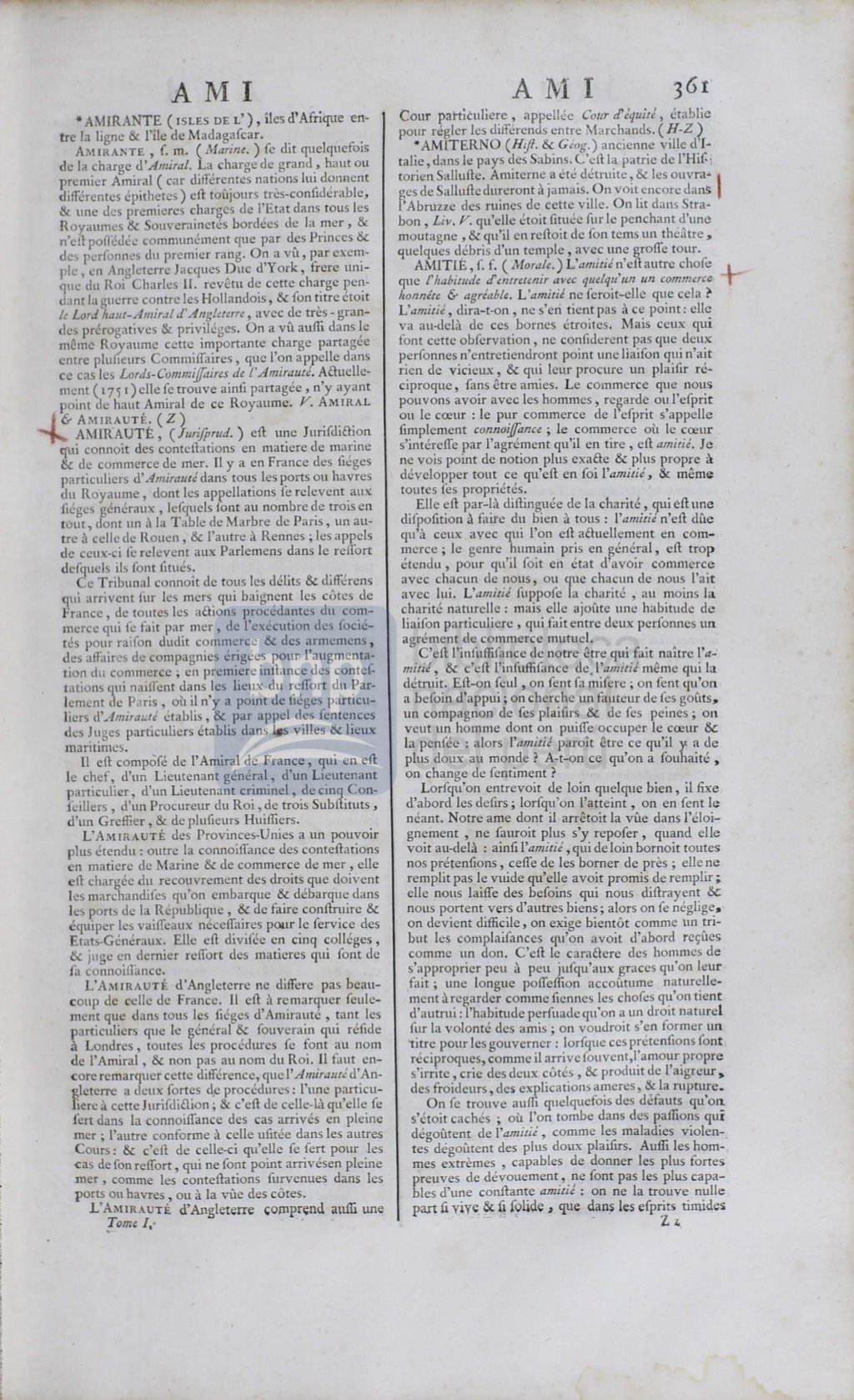
A M 1
• AMIRANTE (ISLES DE L') , ues d'Afrique en–
tre la ligne
&
rile de Madagafcar.
AMIRANTE ,
f.
m.
(Marine.)
fe dit quelquefois
de la charge
d'Amiral.
La charge de grand, haut ou
premier Amiral ( car dilférentes nations IUl donoent
¿ifférentes épithetes) eft toiljours tres-confidérable,
&
une des premieres charqes de I'Etat dans tous les
Royaumes
&
Souverainetes bordées de la mer,
&
n'cíl poficdéc communement que par des Princes
&
des pcrfonncs du prem.ier rango On a Vil, par exem–
pIe, en Angleterrc Jacques Duc d'York, frere uni–
que du Roi Charles 11. revetu de cette charge pen–
dant la guerre cono'e les Hollandois,
&
[on titre etoit
le
Lord haut-Amiral d'Angüterre,
avec de tres - gran–
de prérogatives
&
priviléges. On a Vil auffi dans le
m~me
Royaume cette importante charge partagee
entre plulieurs Commj[[aires, que l'on appelle dans
ce cas les
Lords-Commij[aires de L'Amirauté.
A&lelle–
ment (1751) elle fe trouve ainfi partagée, n'y ayant
point de haut Amiral de ce Royaume.
Y.
AMIRAL
. &
AMIRAUTÉ.
(Z)
AMIRAUTÉ,
(Jurifprud.)
eft une Jurifdiilion
qui connOlt des conteO:ations en matiere de marine
&
de commerce de mero Il y a en France des fiéges
particuliers d'
Amirauté
dans tous les ports Ol! havres
du Royaume, dont les appellations fe relevent aux
fiéges genéraux , lefql.1els lont au nombre de trois en
tout, dont un
¡\
la Table de Marbre de Paris , un au–
!re a celle de Rouen,
&
l'autre
a
Reones ; les appcls
de ceux-ci fe relevent aux Parlemeos dans le re[[ort
defquels ils (ont linlés.
e Tribunal connolt de tous les déüts
&
diIFérens
qui arrivent fur les mers qui baignent les cotes de
France, de toute les aélions procédantes du com–
merce qtú fe fait par mer, de l'execution des focié–
tés pour raifon dudit commerce
&
des armemens,
des aIFaires de compagnies érigées pour l'augmenta–
tion du commerce ; en premiere irtílance des cootef–
t,ltions c¡ui nailTent dans les lieux du re[[ort du Par–
lement de Paris, ou il n'y a point de fiége particu–
liers
d'Amirauté
établis,
&
par appe! des [entences
des Juges particuliers établis dans lMs villes
&
lieux
maricimes.
Il eO: compofe de l'Am.iral de France, qui en eíl
le chef, d'un Lieutenant géneral, d'un Lieutel ant
particulicr, d'un Lieutenant criminel, de cinq Con–
{'illers , d'un Procureur du Roi , de trois Subftituts ,
d'un Greffier,
&
de plulieur Huiffiers.
L'AMIRAUTÉ des Provinces-Unies a un pouvoir
plus étendll : outre la connoilrance des conteílalÍons
en matiere de Marine
&
de commerce de mer , elle
eO: chargée du recouvrement des droits que doivent
les marchandifes qtl'on embarque
&
débarque dans
les ports de la Républiql1e,
&
de faire confunire
&
éc¡uiper les vaiífeaux néce{faires pour
le
[ervice des
Erat -Généraux. EUe eO: divifée en cinq colléges,
&
juge en dernier re[[ort des macieres qtú
[00[
de
fa connoiflance.
L'AMIRAUTÉ d'Angleterre ne diIFere pas bean–
conp de celle de France. Il eft
a
remarquer feule–
ment que dans !Ous les íiéges d'Amiramé , tant les
particuliers qtle le genéral
&
[ouverain qtú réfide
a Londres, toutes les procédures [e fOn! au nom
de l'Amiral ,
&
non pas au nom du Roi. 11 faut en–
core remarquer cette différence, qtle l'
Arnirauté
d'An–
oleterre a deux fortes de procédures: l'une particu–
y!ere
a
cene Jllrifdillion ;
&
c'eO: de celle-Jaqu'elle fe
len dans la connoi1Tance des cas arrivés en pleine
mer ; I'autre conforme a ceUe ulitée dans les autres
ours:
&
c' íl de c lle-ci qu'elle [e fert pour les
cas de fon re[[ort , qtú ne font point arrivésen pleine
mer , comme les conteílations [urvenues dans les
ports ou havres, ou a la vue des cotes.
L'Ai\llRAUTÉ d'Angleterre <;omprend auili une
TomeI.
A IvI 1
Cour particuliere, appell'e
Coltr d'é'lui¡J,
érablie
pour régler les dilférends entre Marchands. (
H-Z )
*
AMITER O
(Hifl.
&
Geog.)
ancienne viLle d'I–
taüe, dans le pays des Sabins. C'eíl: la patrie de
I'Hif-;
torien Salluíl:e. Am.iterne a été détruite,
&
les ouvra. ,
ges de SaUl1íledmeront a jamais. On voit encore danS
l'
Abrtlzze des ruines de cette ville. On lit dans Stra–
bon ,
Liv.
Y.
qu'eLle étoit fimée fur le penchant d'uné
moutagne ,
&
qtl'il en reíloit de fon tems 1m thélltre:>
quelques débris d'un temple, avec une gro[[e tour.
AMITIÉ, f. f.
(MoraLe.) L'a",itié
n'eíl:autre chofe
qtle
l'habimde d'lIuretenir avec quelqll'un un commerct
honnéte
&
agriabLe. L'amitié
ne feroit-elle qtle cela?
L'
amitié,
dira-t-on , ne s'en tient pas a ce point: elle
va au-dela de ces bornes é!roites. Mais ceux qui
font cette ob[ervation, ne conliderent pas qtle dellx
perfonnes n'entretiendront point une liaifon qui n'ait
rien de vicieux,
&
qllÍ leur procure un plaiflf re–
ciproqtle, fans eO'e amies. Le commerce que nous
pouvons avoir avec les hommes , regarde oul'e[prit
ou le Cce1lf : le pur commerce de I'e[prit s'appelle
limplement
connoiffance;
le commerce oll le cceur
s'intere[[e par l'agrément c¡u'il en tire, eft
ami/ii.
Je
ne vois point de nocion plus exaéle
&
plus propre
a
déyclopper tout ce qt1'eft en [oi
l'amitié,
&
memc:
tomes
fl~s
propriétés.
. Elle
~ft
par-!a diíl:ing:uee de la charité ,
<F.
éft une
difJ)oliuon
a
falre du bien a tous :
l'a",iti.
n'eft due
qu'a ceux ayec qtli I'on eíl: aél-uellement en com–
merce ; le genre humain pris en genéral, eíl trop
étendll, pour qu'il [oit en état d'avoir commerce
ayec chacun de nous, ou qtle chacun de nous l'ait
avec lui.
L'amitié
fuppo[e la charité , au moins la
charité naturelle : mais elle ajoute une habinlde de
liaifon particuliere, qui fait entre deux per[onnes 1m
agrément de conunerce munlel.
C'eO: l'infuffifance de notre etre qtli fait naitre l'
a~'
mitié,
&
c'eíl: l'in[ufl'ifance
de.l'amiti¡
meme
qui
la
détruit. Eíl-on [eul , on (ent fa mifere ; on [ent (Iu'on
a befoin d'appui; on cherche un fauteur de [es gOlltS,
un compagnon de [es plailirs
&
de fes peines; on
veut un homme dont on pui{fe occuper le cceur
&
la penfée- : alors
J'amitié
parolt erre ce qu'il )' a de
plus doux au monde? A-t-on ce qu'on a [ollhaité
on change de [enciment ?
•
Lorfqtl'on entreyoit de loin qtlelque bien, il fixe
d'abord les defirs; lorfqtl'on l'atteint, on en fent le
néant. Notre ame dont
il
arretoit la vue dans l'éloi–
gnement , ne [auroit plus s'y repofer, qtland elle
yoit au-dela : ainíi
l'amiti¡ ,
CjlÚ deloin bornoit toutes
nos prétenlions, ce[[e de les borner de pres; elle ne
remplit pas le Vlúde qu'elle avoit
prom.isde remplir;
elle nous lai[[e des befoins
qui
nous difuayent
&
nous portent vers d'autres biens; alors on [e néglige.
on
devient
difficile, on exige bientot comme un tri–
bm les complaifances qtl'on avoit d'abord res:ues
comme un don. C'eft le caraélere des hommes de
s'approprier peu
a
peu jufqtl'aux graces q1l'on leur
fait; une longue po{feffion accolltume naturelle–
ment
a
regarder comme liennes les chofes qu'on tient
d'autrui: l'habitude perfuadeqtl'on a un droit nanlfel
[ur la volonté des amis; on voudroit s'en former un
'titre pour les gouverner : lorfque ces préteníions [ont
réciproqtles, comme
il
arrive[ouvent,I'amour propre
s'irrite, crie des deux cotés ,
&
produit de l'aigreur
~
des froideurs, des explications ameres,
&
la mpnlfe.
On fe trouve auffi qtlelquefois des defauts qtl'on
s'étoit cachés ; Oll l'on tombe dans des paffions
qu.i
déaoutent de l'
amitié,
comme les maladies violen–
te~
dégoutent des plus dom{ plaiflfs. Auffi les hom–
mes extremes, capables de donner les plus fortes
preuves de dévouement, oe font pas les plus capa–
bIes d'une conílante
amitié:
on ne la trouve nulle
pan
ú
vire
&
(¡
folide , que dans les efprits timides
Z7,
















