
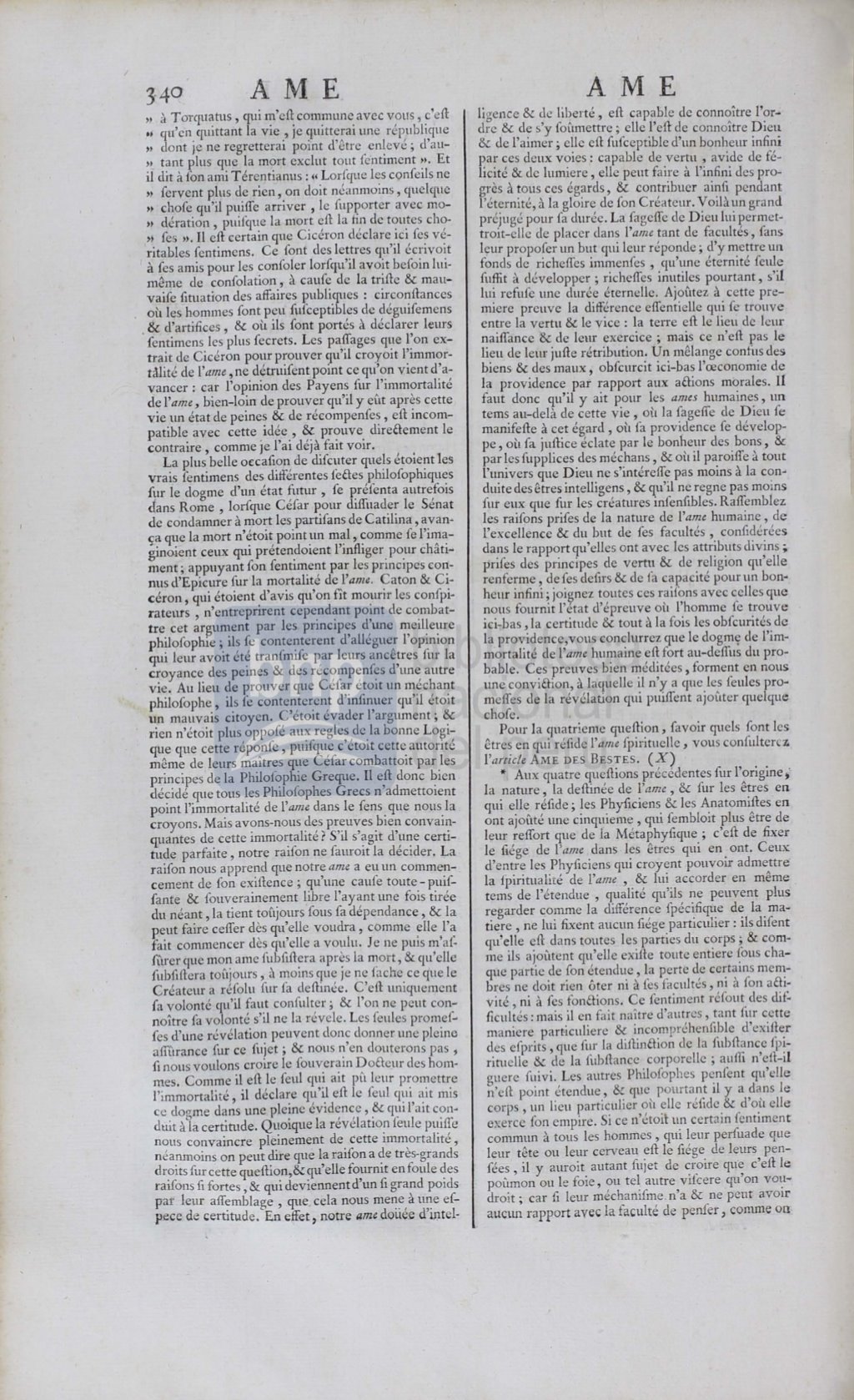
AME
" a
Torquatus , qui m'eft commune avec vous, c'eft
.. qu'en quinant la vie , je quitterai une républiqlle
" dont je ne regretterai point d'&tre cnlevé; d'au–
" tant plus que la mort exclut tout (entiment
>l.
Et
il
dit
a
(on ami Térentianus :"Lorfque les confeils ne
" (ervent plus de rien, on doit néanmoins, c¡uelque
" choCe C¡ll'il puifi'e arriver , le (upI,J0rter avec mo–
" dération , plúfcjUe la mort efr la fin de toutes cho–
H
Ces ". Il efr certún que Cicél'on déelare ici
Ces
vé–
ritabIes (entimens. Ce (ont des lettres c¡u'il écrivoit
a
fes amis pour les conColer 10rCqu'il avoit befoin lui–
meme de conColation, a cauCe de la trille & mau–
vaife fituation des affaires publiques: circoníl:ances
Ol! les hommes
Cont
peu Cufceptibles de dégui(emens
.&
d'artifices, & Ol! ils Cont portés a déclal'er leurs
fentimens les plus Cecrets. Les pafi'ages que l'on ex–
trait de Cicéron pour prouver qu'il croyoit l'immor–
talité de l'
ame,
ne détruiCent point ce qu'on vient d'a–
vancer : car l'opinion des Payens Cur l'immortalité
de l'
ame,
bien-Ioin de prouver qu'il y ellt apres cene
vie un état de peines & de récompenfes , eft incom–
patible avec cette idée ,
&
prouve direél:ement le
contraire, comme je I'ai déja fait voir.
La plus belle occafion de difcuter quels étoient les
vrais [entimens des ditfél'entes teél:es philofophiques
fur le dogme d'un état funlr, fe préfenta autrefois
dans Rome , lorfque Céfar pour difi'uader le Sénat
de condamner a mort les partifans de Catilina , avan–
.,a que la mort n'étoit point un mal, comme fe I'ima–
ginoient ceux
qui
prétendoient l'infliger pour
cha.ti~
ment; appuyant fon fentÍment par les principes con–
nus d'Epicure fur la mortalité de
l'
ame.
Caton
&
Cí–
céron, qui étoient d'avis qu'on fit mourir les confpi–
ratenrs , n'entreprirent cependant point de combat–
tre cet argument par les principes d'une meilleure
philofophie; ils fe comenterent d'alléguer l'opinion
qui leur avoit été tran[mife par leurs ancetres fur la
croyance des peines
&
des récompenfes d'une autre
vie. Au lien de pronver que Céfar étoit un méchant
philofophe, ils fe contemerent d'infinuer qu'il étoit
un mauvais citoyen. C'étoit évader I'argument ; &
rien n'étoit plus oppofé alLY regles de la bonne Logi–
que que cette rciponfe , puifque c'étoit cette autorité
meme de leurs maltres que Céfarcombattoit par les
principes de la Philofophie Greque. II eft donc bien
décidé que tous les Philofophes Grecs n'admettoient
point l'immortalité de l'
ame
dans le fens que nous la
croyons. Mais avons-nous des preuves bien convain–
quantes de cette immortalité? S'il s'agit d'une certÍ–
nlde parfaite, notre rai[on ne [auroit la décider. La
raifon nous apprend que notre
ame
a eu un commen–
cement de fon exiíl:ence ; c¡u'une caufe toute - puif–
[ante & [ouverainement libre l'ayant une fois tirée
du néant , la tient tOlljOurS [ous fa dépendance , & la
peut faire ce{[er des qu'elle voudra, comme elle l'a
fait commencer des qll'elle a voulu. Je ne puis m'af–
furer c¡ue mon ame fubftíl:era apres la mon,
&
qu'elle
fubfiíl:era tOlljOurs,
a
moins que je ne fache ce que le
Créateur a ré[olu [ur [a deíl:inée. C'eíl: llniql.lement
fa volonté qu'il faut conCulter; & I'on ne peut con–
nOltre [a volonté s'il ne la révele. Les (eules promef–
fes d'une révélation peuvent donc donner une pleine
affi'lrance [ur ce [ujet; & nous n'en douterons pas ,
fi nous voulons croire le [ouverain Doél:eur des hom–
mes. Comme il eft le Cenl qui ait pll leur promettre
I'immortalité,
il
déclare qu'il eft le Ceul qui ait mis
ce doO'me dans une pleine évidencc , & qlli l'ait con–
duit ala certimde. Quoique la révélation feule plú{[e
nous convaincre plcinement de éette immortalité ,
néanmoins on pellt dire que la raifon a de tres-grands
droitsfurcette queftion,&cjU'elle fournit en foule des
raifons
ti
fortes ,
&
qui deviennentd'un fi grand poids
pa!' leur a{[emblage , C]1le cela nous mene a une eC–
pece de certitude. En effet ) notre
ame
doüée d'¡mel-
AME
ligence & de liberté, efr capable de connoltre l'or–
dre & de s'y fOllmettre; elle I'eft de connoltre Diell
& de l'aimer ; elle eft ClIfceptible d'un bonheur innlú
par ces deux voies : capable de verm , avide de fé–
licité
&
de 11Imiere, elle peut faire a I'innni des pro–
gres
a
tous ces égards, & comribuer ainfi pendant
l'étemité,
a
la gloire de [on Créateur. Voila un grand
préjugé pour Ca durée. La [agefi'e de Dieului permet–
troit-elle de placer dans l'
ame
tam de facultés, Cans
l"ur propofer un but qui leur réponde; d'y mettre un
fonds de riche{[es immenCes , qu'une éternité feule
Cuffit
a
développer ; richefi'es inutiles pourtant, s'il
lui refuCe une durée érernelle. Ajolltez a cette pre–
miere preuve la différence e{[entielle qui fe trouve
entre la vertu & le vice: la terre efr le lieu de leuT
naifi'ance
&
de lem exercice ; mais ce n'eíl: pas le
líeu de lem juíl:e rétribution. Un melange confus des
biens & des maux, obCcmcit ici-bas I'reconomie de
la providence par rapport aux afuons morales. Il
fallt donc c¡u'il y ait pour les
ames
hllmaines, un
tems au-dela de cette vie , 0\1la (ageÍle de Dieu [e
manifeíl:e a cet égard , 0\1fa providence fe dévelop–
pe, 011 Ca juilice éclate par le bonheur des bons,
&
par les fupplices des méchans, & 0\1 il paroiife
a
tout
l'univers que Dieu ne s'intére{[c pas moins a la con"
duitedesetres intelligens, & qu'il ne regne pas moins
Cur ellX que
[liT
les créatlrres in
(enftbles.Ra{[emblez
les rai[ons prifes de la nature de
I'ame
humaine , de
l'excellence & du but de [es facultés, coniidérécs
dans le rapport C]11'elles ont avec les attributs divins ;
pri(es des principes de vertll & de religion qu'elle
renferme, de (es defirs & de fa capacité pour un bono
heur innni; joi
9
nez toutes ces rauons avec celles C]1le
nous fournit l'etat d'épreuve 011 l'hornme Ce trouve
ici-bas> la certitude & tout a la fois les ob[curités de
la providence,vous conclurrez C]1le le dogmc;: de I'im–
mortalité de
I'ame
humaine eíHort au-defi'us du pro–
bable. Ces preuves bien méditées , forment en nous
une convifuon, a laquelle il n'y a que
les
[eules pro–
mefi'es de la révélation qui puiífent ajouter quelC]1le
chofe.
Pour la quatrieme queilion, [avoir C]1lels [ont les
etres en C]1li réfide l'
ame
fpirituelle , vousconCulterc:¡¡
l'article
AME DES BESTES.
(X)
*
Aux c¡uatrc quefiions précédentes fur l'origine;
la nanrre, la deíl:inée de
l'ame,
&
(ur les etres en
qlli elle réfide; les Phyficiens & les Anatomilles en
ont ajollté une cinquieme , C]1ú fembloit plus etre de
lem refi'ort que de la Métaphyfique; c'eft de fixer
le fiége de
l'ame
dans les etres qui en ont. CelLX
d'entre les Phyficiens qlli croyent pouvoir admettre
la (piritualité de
l'am~
,
& lui accorder en meme
tems de l'étendue , qualité C]11'ils ne pellvent plus
regarder cornme la différence [pécinqlle de la ma–
tiere, ne lui fixent aucun úége particulier : ils diCent
C]11'elle eft dans toutes les parties dll corps ;
&
com–
me ils ajolltent ql1'elle exiíte toute entiere fous cha–
C]1le partie de Con étendue , la perte de certains mem–
bres ne doit rien oter ni
a
[es facllltés , ni
a
[on aél:i–
viré, ni a fes fonilions. Ce Centimem réCout des dif·
ncultés: mais il en fait naitre d'autres , tant (m cette
maniere parr:iculiere & incompréhenfible d'exifter
des eCprits , que (lrr la diílinél:ion de la Cltbíl:ance (pi–
rimelle & de la [ubfrance corporelle; allffi n'eíl:-iI
guere (uivi. Les autres PhiloCophes penCent C]11'elle
n'eíl: point étendue,
&
que pOl1rtant il y a dans le
corps , un lieu particulier 011elle réfide
&
d'oll elle
exerce
Con
empire. Si ce n'étoit un certain [entiment
commun
a
tous les hommes , qlli lem perCuade que
leur tete ou leur cerveau eft le fiége de letrrs pen–
Cées
,
il
Y
auroit amant Cujet de croire c¡u'e c'eíl: le
pOllmon oule foie, ou te! autre vi{cere C]11'on vou–
droit; car fi leur méchaniCme.n'a & ne pel1t avoir
aUClUl r¡¡pport ¡¡vec la faculté de penfer) comme on
















