
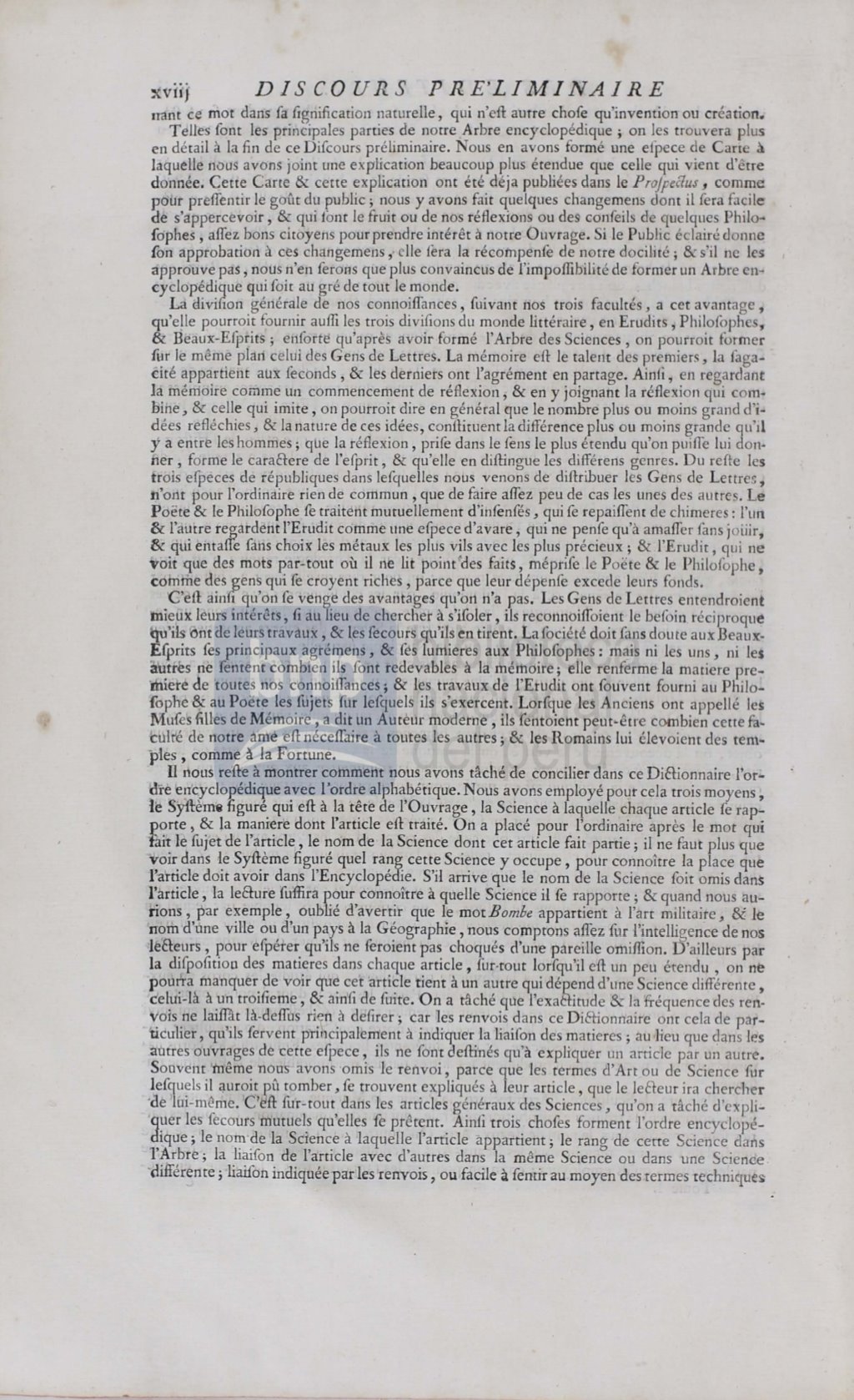
xviij
D 1
S
eo
u
R
S
P R E' L 1
M
1 N A 1 R E
nant ce mor dans fa fignification narurelle, qui n'efl: autre chofe qu invention ou création.
Telles font les principales parties de notre Arbre encydopédique ; on le rrou era plus
en dérail
a
la fin de ce Difcours préliminaire. Nous en avons formé une elpece de Can
a
laquelle nouS avons joim une explicarion beaucoup plus érendue que celle qui iem d'erre
donnée. Cene Carte
&
cene explicarion om éré deja publiées dans le
Projpeaus ,
comme
pour preífentir le gour du public; nous y avons fair quelques changemens dont il íera facile
de s'appercevoir,
&
qui font le fruit ou de nos réflexions ou des coníeils de quelques
Philo~
fophes , affez bons ciroyens pour prendre inreret
a
notre Ouvrage. i le Public éclairé donne
fon approbacion a ces changemens,. elle fera la récompenfe de notre dociliré ;
&
s'il ne les
approuve pas, nol1s n'en (eroAs que plus convaincus de l'impoffibiliré de former un Arbre
en~
cydopédique qui (oir au gré de tout le monde.
La
divifion
générale de nos connoiffances, fuivant nos trois faculrés
J
a cet avantage ,
qu'elle pourroit fournir auffi les rroi diviíion du monde lirtéraire, en Erudits ,Pbilofophe ,
&
Beaux-Eíprits; en(orft:: qu'apres avoir formé l'Arbre des Sciences , on pourroit former
{ur le meme plan celui des Gens de Lertres. La mémoire efl: le talent des premiers, la (aga–
cité appartient aUx (econds ,
&
les derniers om l'agrément en parrage. Ainfi, en regardaot
la mémoire comme un commencement de réflexion,
&
en y joignam la réflexion qui com–
bine,
&
celle qui imite, on pourroit dire en général que le nombre plus ou moins grand d'i–
dées refléchies
J
&
la natUre de ces idées, conlliruent la différence plus ou moins grande qtl'Il
ya entre les hommes; que la réflexion, prife dans le (ens le plus étendu qu'on puifre lui don–
ner, forme le caraaere de l'eíprir,
&
qu'elle en difl:ingue les différens genres. Du rene les
frois erpeces de républiques dans leíquelles nous venons de difl:ribuer les Gens de
Lertre~,
ll'ont pour I'ordinaire rien de commun , que de faire affez peu de cas les unes des autre . Le
Poete
&
le Philofophe (e traitent muruellemenr d'in(en(es, qui (e repaiffent de chimeres: I'un
&
l'aUtre regardent I'Erudit comme une efpece d'avare, qui ne pen(e qu'a ama{fer (ans joüir,
&
qui emaffe (ans choi)( les métaux les plus vils avec les plus précieux ;
&
l'Erudit, qui ne
voit que des mots par-tout
OU
il
ne lit poine'des faits, méprife le Poete
&
le PhiloCophe,
cornme des gens qui (e croyent riches , parce que lem dépen(e excede leurs fonds.
C'ea ainÍl qu'on íe venge des avantages qu'on n'a pas. Les Gens de Lettres entendroient
mieux Jeurs intérets,
{j
au lieu de chercher a s'rtoler, ils reconnoi{foient le be(oin réciproque
t¡u'ils
Ont de leurs traváux ,
&
les (ecours c¡'u'ils en tirent. La (ociété dojt (ans doure aux Beaux–
Efprits (es principaux agrémens,
&
(es lurr1Íeres aux Philofophes: mais ni les uns, ni les
autres ne (entent combien ils font redevables
a
la mérnoire; elle renferme la matiere
pre~
·mien~
de toures nos connoiffances;
&
les travaux de l'Erudit ont (ouvent fourni au
Pbilo~
{ophe
&
au Poete les (ujets (m le(quels ils s'exercent. Lor(que les Anciens om appellé les
MuCes filles de Mémoire, a dit un Auréur moderne , ils fentoiem peut-etre combien ceue
fa~
culré de notre ame ea néce{[aire
a
mutes les autres;
&
les Romains lui élevoiem des tem·
ples, comme
a
la Fortune.
n
nous relle a montrer comment nous avons taché de concilier dans ce Diaionnail'e l'or–
die encyclopédique avee l'ordre alphabétique. Nous avons employé pour cela trois moyells,
l~
Sy1.tem1i figuré qui ea
a
la tete de l'Ouvrage, la Science a laquelle chaque artide (e rap–
porte,
&
la maniere dont l'article efl: trairé. On aplacé pour l'ordinaire apres le mot qui
fait le (ujet de l'anide, le nom de la Science dOllt cet artide fait panie; illle faut plus que
voir dans le Syfl:eme figuré que! rang cene Science y occupe , pour connoltre la place que
l'a'rticle dojt avoir dans l'Encydopédie. S'il arrive que le nom de la Science (oir omis dans
l'article, la leaure (uffira pour connoltre
a
quelle Science
ii
fe rappone;
&
quand nous au–
nons, par exemple, oublié d'avertir que le mot
Bombe
appartient a l'art militaire,
&
le
nom d'une ville ou d'un pays
a
la Géographie, nous comprons a{[ez fur I'intelligence de nos
léaeurs , pom e(pérer qu'ils ne (eroient pas choqués ¿'une pareille omiffion. D'ailleurs par
la diCpoíitiou des matieres daos chaque artide, fur·tour lor(qu'il efl: un
peu
étendu , on
re
pou~a
manquer. de voir
qu~
cet
arti~le
tient a un
a~tre q~i dép~nd
d'une Science différente ,
celul-la
a
un trOlfieme,
&
alnfi de (U1te. On a tache que I exaaltude
&
la fréquence des ren–
Vo1s
ne lai.ffi.t la-Cleffus
ri~n
a deíirer; car les renvois dans ce Diétionnaire one cela de par·
'ticulier, qu'ils (ervent p'rilJcipalement a indiquer la liaiíon des matieres ; au I-ieu que dans les
atlrTes ouvrages de t:ette eípece, ils ne (om defl:inés qu'il expliquer un arcicIe par un autrc.
Soovene 'tneme nous avons omis le renvoi, parce que les termes d'Art ou de Science fur
lefqu~ls
il
é!uroi~
pu tomber
J
(e trouvent expliqués a leur anide, que le leaeur ira cbercher
-de 100-meme.
C'E!ft
fur-tout dans les artides généraux des Sciences, qu'on a taché d'cxpli–
quer les íecours mutUels qu'elles fe pretem. Ainíi trois cho(es formem l'ordre encydopé–
dique; le nom de la Sdence a laquelle I'artide appartient; le rang de cerre Science dal'ls
l'Arbre; la ¡iairon de I'artide avec d'autres daos la meme Science ou dans une Science
di1férente; lianon indiquée par les renvois, ou facile
a
femjr au moyen des termes techniques
















