
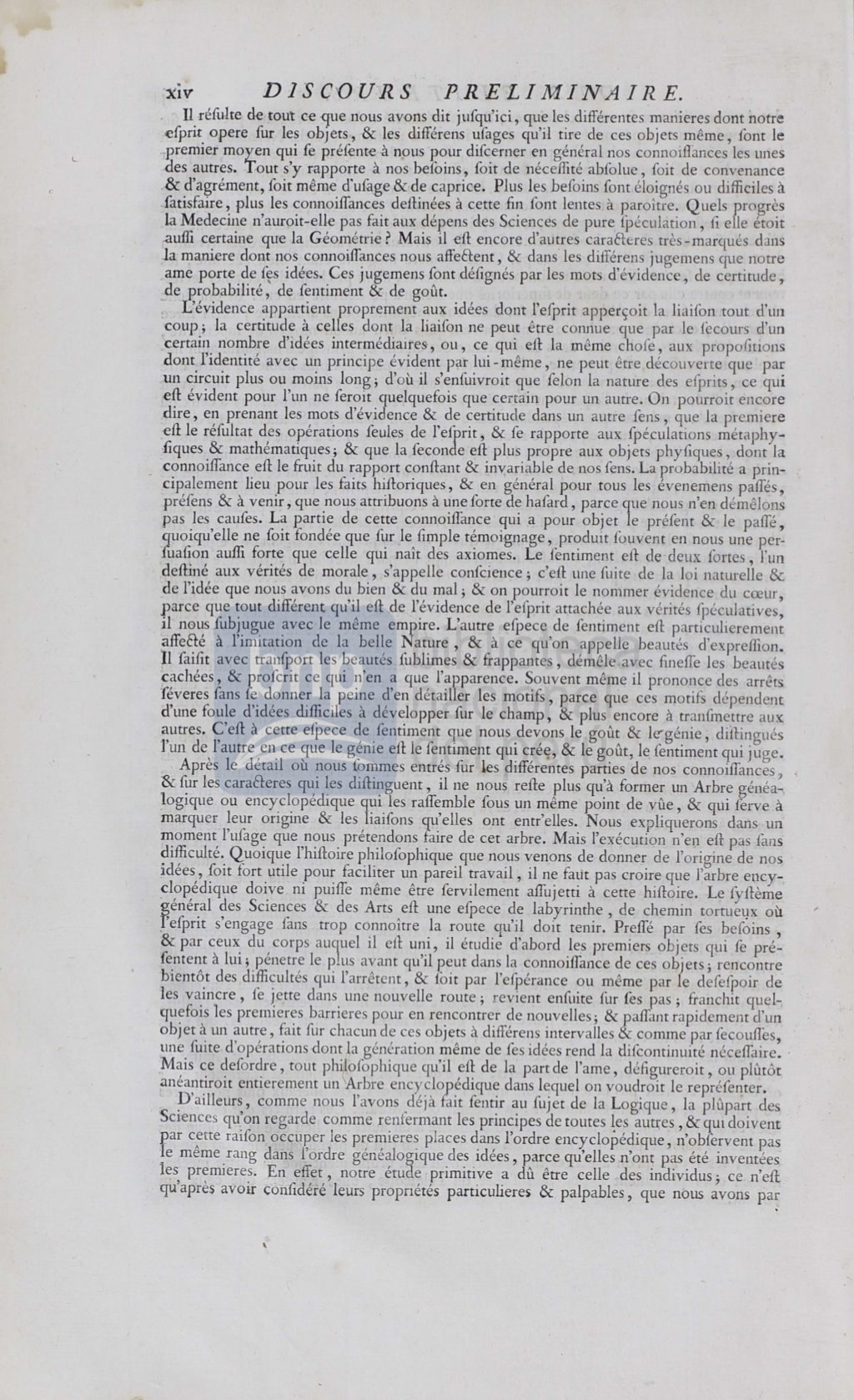
xiv
D 1 S CO U R S
P R E L 1
M
1 N
A 1 R
E.
TI -ré[ulte
de
{Out c-e -que nous avons dit jl1fqu'ici, que les différentes manieres dont notre
,efprit opere [ur les obJets,
&
les différens ufages qu'i[ tire de ces objets meme, {ont le
..premier moyen qui [e pré[eme
.a
nous pour difcerner en général nos connoIÍfances les unes
des aurres. Tout s'y rapporte a nos befoins, foit de néceffité abfolue, foit de convenance
&
d'agrément, foit meme d'ufage
&
de caprice. Plus les befoins font éloignés ou difficiles a
-fatisfaire, plus les connoiífances deftinées a cette fin [ont lentes a paroitre. Quels progres
la
Medecine n'auroit-elle pas fait aux dépens des Sciences de pure fpéculation, íi elle étoit
.auffi certaine que la Géométrie? Mais il eft encore d'autres caraéteres treS-marqués dans
la maniere dont nos connoiífances nous affeétent,
&
dans les différens jugemens que notre
ame porte de
[~
idées. Ces jugemens fom déíignés par les mots d'évidence, de certirude,
de probabilité, de fentiment
&
de gout.
L'évidence appartiem proprement aux idées dont l'e{prit
apper~oit
la liaifon tout d'un
coup; la certitude
a
celles dont la liai[on ne pem etre connue que par le ü!coms d'un
certain nombre d'idées intermédia¡res-, ou, ce qui eft la meme chofe, aux propoGtlons
dom l'identiré avec un principe évident par lui - meme, ne peut etre découverte que par
un circuit plus ou moins long; d'oa
il
s'enfuivroit que {elon
la
nature des efprits, ce qui
eft évident pour l'un ne feroit quelquefois que certain pour un autre. On pourroit encore
dire , en prenant les mots d'évidence
&
de certitude dans un autre fens, que la premiere
·eft le réfultat des opérations [eules de l'efprit,
&
fe rapporte aux {péculations métaphy–
-fiques
&
mathématiques;
&
que la feconde eft plus propre aux objers phyíigues, dom la
connoilfance eft le fruit du rapport conftam
&
inv;ariable de nos fens. La probabilité a prin–
cipalemem lieu pour les faits hiftoriques,
&
en général pour tous les évenemens paífés,
préfens
&
a venir, que nous attribuons a une {orte (le haÍéll-d , parce que nous n'en démelons
pas
les
cauCes. La partie de cette connoiífance qui a pour objet le préú!nt
&
le paífé,
quoiqu'elle ne foir fondée que fur le fimple témoignage, produit fouvent en nous une per–
[uaGon auffi forte que celle qui nalt des axiomes. Le fentiment eft de -deux fortes, l'un
deftiné aux vérités de morale, s'appelle confcience; c'eíl: une fuite de la loi naturelle
&
de l'idée que nous avons du bien
&
du mal;
&
on pourroit le nommer évidence du cceur,
parce que tout différent qu'jl eft de l'évidence de l'efprit attachée aux vérités {péculatives,
il n0US [ubjugue avec le meme empire. L'autre ef¡)ece de fentiment eíl: particulierement
affeété a l'imitation de la belle Nature,
&
a ce qu'on appelle beautés d'expreffion.
11
[aiíit avec tranfport les beautés fublimes
&
frappantes, démele avec finelfe les beautés
cachées,
&
profcrit ce qui n'en a que l'apparence. Souvent meme il prononce des arrets
íéveres fans fe donner la peine d'en détailler les motifs, parce que ces morifs dépendent
d'une foule d'idées difficiles a développer fur le champ,
&
plus encore
a
trau{mettre aux
autres. C'eíl:
a
cette efpece de fentiment que nous devons le gout
&
kgénie, diil:ingués
run de l'autre en ce que le génie eft le fentiment qui crée,
&
le gout, le Centimem qui juge.
Apres le détail
OU
nous fommes emrés fur les différemes parties de nos connoilfances
1
&
{ur les caraB:eres qui les diftinguent, il ne nous reíl:e plus qu'a former un Arbre généa-
10gique ou encyclopédique qui les ralfemble fous un meme point de vue,
&
qui [erve
a
marquer leur origine
&
les liaifons qu'elles om entr'elles. Nous expliquerons dans un
moment l'ufage que nous prétendons faire de cet arbre. Mais I'exécurion n'en eft pas fans
difficulté. Quoique l'hiftoire philofophique que nous venons de donner de l'origine de nos
idées, foit fort otile pour faciliter un pareil travail , il ne fam pas croire que l'arbre e\1cy–
clopédique doive ni puiífe meme etre fervilement aífujerti
a
cette hiftoire. Le [yfteme
général des Sciences
&
des Arts eft une efpece de Iabyrinthe, de chemin tortue\Jx
OU
I'efprit s'engage fans trop connoitre la rome qu'il doit tenir. Prelfé par fes befoins ,
&
par ceux du corps augue! il ell: uni, il étudie d'abord les premiers objets qui fe pré–
fenrent
a
lui; pénetre le plus avant qu'iI peut dans la connoiífance de ces objers; rencontre
bientot des difficultés qui l'arrerent,
&
foit par l'efpérance ou meme par le defe[poir de
les vaincre, fe jette dans une nouvelle route; reviem enfuite fur fes pas; franchit quel–
quefois 1es premieres barrieres pour en rencomrer de nouvelles;
&
paífant rapidemenr d'un
obj et
a
un aurre, faít fur chacun de ces objets a différens imervalles
&
comme par fecouífes,
une fuite d'opérations dom la génération meme de fes idées rend la difcominuité néceífaire.
Mais ce defordre, tout
ph~ofophique
qu'il eíl: de la part de l'ame, défigureroit, ou pliltor
anéantiroit entierement un Arbre encyc!opédique dans lequel on voudroit le repré[enter.
D'ailleurs, comme nous l'avons déja fait femir au fujet de la Logique, la plupart des
Sciences qu'on regarde comme renfermant les principes de toutes
~es
amx:es
,&
qul doivenr
par cette raifon occuper les premieres places dans l'ordre encyc!opédique, n'obíervent pas
le meme rang dans I'ordre généalogique des idées, parce qu'elles n'om pas été inventées
1es premieres. En effet, notre étude primitlve a dil etre celle des individus; ce n'eí!:
qu'apres avoir conlidéré leurs propnétés particulieres
&
palpables, que nous avons par
















