
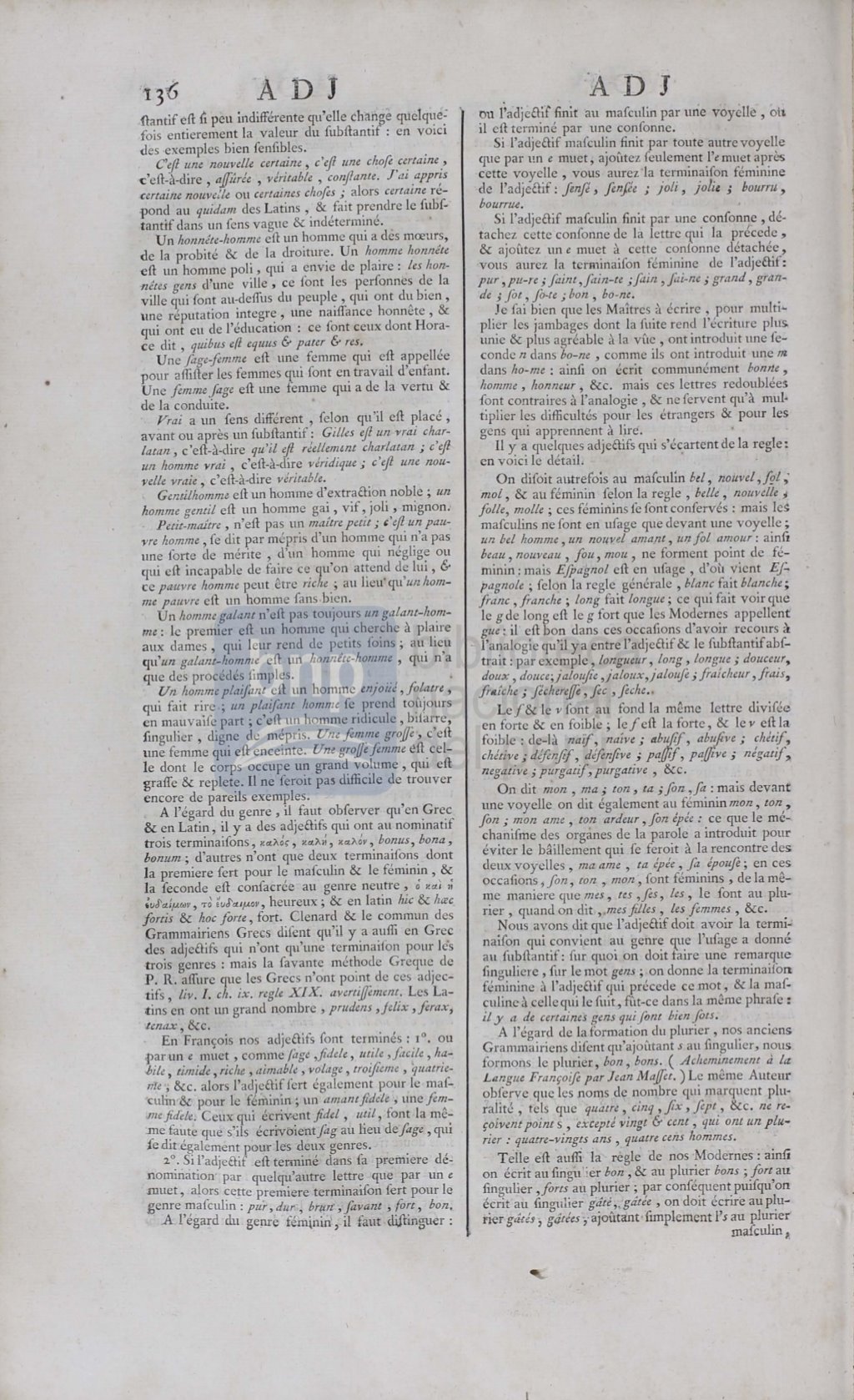
A D
J
fiantif
e.ílh
peu indifférente qu'elle
cha~ge qtlelql~e~
fois entlerement la valeur du {ubílantlf: en VOICI
des exemples bien {enlibles.
C'l1UlU nouyelle certaine, c'l1llne clzofe certaine,
{:'eil-a-dire ,
affiirée
,
viritable
,
cOlljlanle. J'ai appris
certailze nOllye!ü
ou
eertaims e/LOfeS
;
alors
eerlaim
ré–
pond au
quidam
des Latins,
&
fait prendre le {ub{–
tantifdans un {cns vague
&
indéterminé.
Un
lzollfz<te-Izomme
eíl un homme qn! a des mreurs,
de la probité & de la droinu·e. Un
lzomme Izonnete
eíl 1m homme poli, qui a env!c de plaire:
Les lzon–
netes gens
d'une ville, ce {ont les
p~r{onnes
d.e la
ville c¡ni {ont au-delfus du peuple , qm ont du bien,
une réputation integre, une nailfance honnete ,
&
qui ont eu de l'éducaoon : ce {ont ceux dont Hora–
ce dit ,
'luiblls e(l equus
&
pater
&
res.
Unefage-femme
ea
une femme qtlÍ eil appellée
pour affiiler les femmes qui (ont en travail d'enfant.
Une
femme Jage
eil une femme qui a de la verm
&
de la condu!te.
Vrai
a un fens dilférent , {elon qtl'Ü eíl: placé,
avant ou apres un (ubíl:antif:
GiLLes
11
un vrai elzar–
latan,
c'eíl:-a-dire
qu'ill1 dellemem elzarlalan
;
,'11
un lzomme vrai
,
c'eíl-a-dire
vt!ridique; e'l1 une nOIl–
velle vraie,
c'eíl:-a-dire
véritable.
Gemillzomme
eíl un homme d'extrafrion noble;
UlZ
Izomme gentil
eíl: un homme gai, vif, joli , mignon.
Petit-ma1tre,
n'eíl: pas un
maÍlre petit;
,'11
un pall–
vre Izomme
,
(e dit par mépris d'un homme qui n'a pas
une (orte de mérite , d'un homme qtli néglige ou
qtu ea incapable de faire ce qu'on attend de lui ,
&
ce
pauvre Izomme
peut etre
riehe
;
au liel!"
qtl'ulllzom–
me pallvre
ea un homme {ansbien.
Un
Izomme galam
n'eíl: pas toujours
un galant-lzom–
me:
le premier ea un homme qlu cherche a plaire
aux dames, qui leur rend de petits {oins; au lieu
qu'un galam-Izomme
eíl: un
Jzonnetc-Izomme,
qtl! n'a
que des procédés fimples.
Un lzomme plaij;ml
ea
un homme
enjoiié, folalre ,
quí fait rire ;
un plaifant /zomme
{e prcnd toujours
en mauvai{e part ; c'ea un homme ridicule, bi/arre,
fmgulier , digne de mépris.
Une fimllle grofl',
c'ea
une femme qui eíl: enceinte.
Une groffi fimme
éíl: cel–
le dont le corps occupe un grand volume, qui eíl
gralfe & replete.
Il
ne (eroit
pa~
difficile de trouver
encore de pareils exemples.
A
I'égard dll genre ,il faut ob(erver qu'en Grec
& en Latin, il
Y
a des adjefrifs qlU ont au nominatif
trois terminai{ons,
"-«A¿~,
'-«A';, x«A¿v,
bonus, bona,
bonum;
d'autres n'ont que deux terminai/ons dont
la premiere {ert pour le ma{culin & le féminin , &
la (econde eíl: con(acrée au genre neutre,
ó
Yo,,) ,;
ouJ'«;p..,v,
'r.
~uJ'
«Ip.av,
heureux; & en latin
Jzic
&
/Ulle
fortis
&
Izoc forte
,fort. Clenard & le commun des
Grammairiens Grecs di{ent qu'il y a auffi en Grec
¿es adjeé.l:ifs 'lui n'ont qu'une terminai/on pour les
trois genres : mais la (avante méthode Greque de
P. R.
alfure qtle les Grecs n'ont point de ces adjec–
tifs,
Liv.
l .
ch. ix. regle
XIX.
aven1fement.
Les La–
tins en ont 1m grand nombre,
prudens ,jelix ,firax,
lenax,
&c.
En Frans:ois nos adjeé.l:ifs {ont terminés:
1°.
ou
1Jarun
e
muet, comme
(age ,fidele, utile ,[acile, ha–
bile, timide, ric/ze
,
aimable
,
volage
,
troijieme
,
quatrie–
me ,
&c. alors l'adjeé.l:if (ert également pour le ma{–
culin & pour le féminin ; un
ttmantfldeie
,
une
fim–
me
fidel~.
Ceux qui écriv.ent
fide!, mil,
font la me–
.me
~a~te
qtle s'ils écrivoient¡ag aulieu
deJago,
qui
fe dit eg;alement pour les deux genres.
2~.
SI
~'adjeé.l:if
eíl: ternuné dans {a premiere dé–
norrunal:!on- par qtlelqtl'autre lettre que par un
e
muet, alors cene premiere terminai(on {ert pour le
.genre
,~a(culin
:
pur, dur
,
brlfT!, JaYÚnt
,
(ore, bono
Al
egard du ge¡u-e féminin, il faut dijlinguer :
·A
D
J
on l;adjeé.l:if finit au ma(culin par une voyelle , oh
il eíl: terminé par une conronne.
Si l'adjeé.l:if ma{culin finit par toute autrevoyelle
que par un
e
muet, ajolltez (culement
l'e
muet apres
cette voyelle , vous aurez la terminai(on féminine
de l'adjefrif:
fenfl, fenfte
;
jolí, jolie
;
bourru:>
bourruc.
Si l'adjeé.l:if ma{culin finit par une confonne , dé–
tachez cette con{onne de la lettre qui la pnf'ccde
~
& ajoí'itez un
e
muet a cette coruonne détachée,
vous aurez la tcrminai{on féminine de l'adjefrif:
pur ,pu-re
;
¡aint ,¡ain-te ;fairz ,¡ai-ne
;
grand
,
gran–
de
j
Jot
,
Jo-te; bon
,
bo-ne.
.Je (ai
~ien
que les Ma1tres
a
écrire , pour multi..
plier les ¡ambages dont la {uite rend l'écriture plus–
urue & plus agréable a la vue , ont introduit une {e–
conde
n
dans
bo-m
,
comme ils ont introduit une
m
dans
ho-me
:
ainfi on écrit communément
bOlllte,
hOfllflle, /zonneur,
&c. mais ces lettres redoublées
{ont contraires
a
l'analogie , & nc (ervent qu'a mulo
tiplier les difficultés pour les étrangers
&
pour les
gens qui apprennent a liré.
11 Y
a qtlelcIues adjeé.l:ifs qui s'écartent t1e la regle:
en voici le détail.
On di(óit autretois au ma(culin
be!, nouvel, fill ;
mol,
& au féminin {elon la regle,
beLle, nouye!le
~
folle, molle;
ces féminins fe {ont con{ervés : mais les
mafculins ne {ont en u(age que devant une voyelle ;
un be! Izomme, un nOltvel amallt, un fol amour:
ainft
beau
,
nouveau
,
fou, mOII,
ne forment point de fé–
minin :mais
Effiagnol
efi en ufage , d'oil vient
Ef–
pagnole
;
{elon la regle générale ,
blane
fait
blanche;
franc ,ftane/le
;
long
fait
longue;
ce qui fait voir qtle
le gde long eíl: le
g
fort que les Modernes appellent
gue:
il
ea
bon dans ces occafions d'avolr recours
a
- l'analogie qu'il ya entre l'adjeélif& le (ubilantifab{–
trait: par exemple,
longueur, long, longue; doueeur,
doux, douce;jaloujie ,jalollx,jaloufe; fralclzeur ,frais,
fr/delze
;
fle/zereffi ,fee
,
feche ..
Lef&
le
v
(ont au fond la meme lettre divifée
en forte & en foible;
lefeíl:
la forte, & ley eílla.
foible : de-la
naif, naíve; 4bujif, ablifive; elzétif,
eMtive; défirifif, défiujive
;
paffif, pq[Jive; négatif">
negative
;
purgatif, purgative
,
&c.
On dit
mon, fila; ton, ta
;
Jon ,fa
:
mais devant
une voyelle on dit également au fémirtin
mon
,
ton,
Jon; mon ame, ton arde/lr ,Jon ipée:
ce que le mé–
chanifme des organes de la parole a introduit pour
éviter le baillement qui {e feroit
a
la rencontre des
delLx voyelles ,
ma ame, ta épie ,fa ipoufe;
en ces
occafions;
fon, ton, mon,
font féminins , de la me–
me maniere que
files, tes ,fes, les,
le {ont a1l plu–
riel' , quand on dit ,
mes filles, les fimmes
,
&c.
NOlls avons dit que l'adjeé.l:if doit avoir la termi–
nai{on qtIÍ convient au genre qtle l'u{age a donné
au {ubíl:antif: {ur CJuoi on doit faire une remarque
finguliere , fur le mot
gens;
on donne la terminaifon
féminine
a
l'adjeélif ql1i précede ce mot, & la mar.
culinea cellequi le [¡lit, fut-ce dans la meme plu'a{e:
il
y
a de certaines gens quiJom bienJotS.
A
l'égard de la formabon du plw-ier , nos anciens
Grammairiens difent qll'ajoutant
s
au fingulier, nOllS
formons le plurier,
bon, bons.
(
Ac/zeminement
ti
La
Langue Fran,oifi par lean Maffit.
)
Le meme Autenr
ob{erve
que les noms de nombre qui ;marqtlent plu–
ralité , tels que
qualre, eillq
,
jix, jept,
&c.
ne re–
,oiventpoint
s ,
exceplé vingt
&
cem
,
qui om un pLu–
rier
:
quatre-vingts ans
,
quatre eens /zommes.
Telle eíl: auffi la regle de nos Modernes : ainli
on écrit au íingll';er
bon,
& al! plurier
bons
;
fort
au
fingulier
,forts
au plurier; par con{équent PU!{qu'on
écrit au úogulier
gáté
,.
gátée
,
on doit écrire au plu–
ricr
gátb, gdtJes,
ajo('¡tant íimplement
l's
au plurier
ma{culin
1
















