
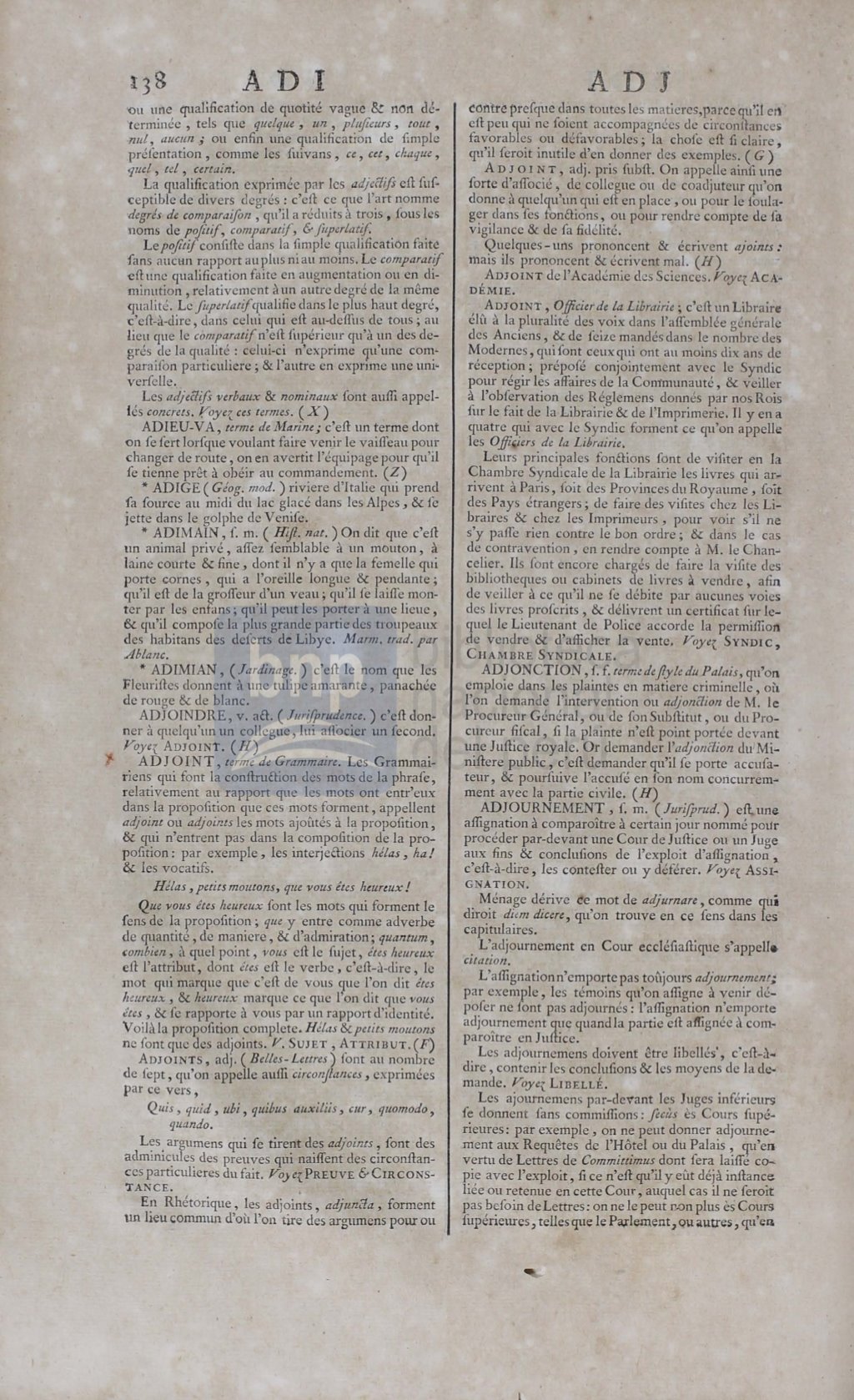
ADI
'Ou \lIle qualification de quotité vague
&
non clé–
terminée , tels que
quelqlte, un, plTlfieurs, toat,
nitl,
allC/tn;
ou enfin tille qualification de íimple
préCentation, comme les Cuivans,
ce, cee, ell/u¡ue,
que!
,
tel, '''tain.
La qualification exprimée par les
adjeélifs
eft
CuC–
ceptible de divers degrés : c'eft ce que l'art nomme
degrés de comparaiflm
,
qu'il a réduits a trois , Cous les
noms de
pojiti¡, comparati¡,
&
fitperlatif..
.
Le
pojitif
confifte daas la fimple qualificahon [¡ute
fans aucan rapport au plus ni au moins.
~e
comparati!
eíl: une qualification faIte en augmentatlOll on en di–
minution relativemcnt aun autre degré de la m&me
qualité.
L~
fuperlatifqualifie
dans le plus haut degré,
c'eft-a-dire, dans celui qui eft au-delfus de tous; au
lieu que le
comparatifn'eft
Cupérieur qu'a un des de–
grés de la qualité : celui-ci n'exprime <¡u'une com–
paraiCon particuliere ;
&
l'autre en expnme une uni–
verCelle.
Les
adjeélifs 1'erhaux
&
nominallX
fOllt auili appel–
lés
COlZcrets. t'oye{ ces termes.
(X)
ADIEU-VA,
arme de Marim;
c'eft un terme dont
on fe Cert lorfque voulant faire venir le vailfeau pour
changer de route, on en avertit I'équipage pour c¡u'il
fe tienne pr&t
a
obéir au commandement.
(Z)
*
ADIGE (
Géog. modo
)
riviere d'Italie qui prend
fa fource au midi du lac glacé dans les Alpes,
&
fe
jette dans le golphe de Venife.
*
ADIMAIN,
r
m. (
H':ft.
nato
)
On dit <¡ue c'eft
un animal privé, aírez femblable a un mouton, a
laine coune
&
fine, dont il n'y a que la femelle qui
porte comes, qui a l'oreille longue
&
pendante;
<¡u'il eft de la grolfeur d'un veau; qu'il fe laiíre mon–
ter par les enfans; qu'il peut les porter
11
une lieue ,
&
Cju'il compofe la plus grande partie des trollpeaux
des habitans des deferts de Libye.
Marm. trad. par
AhlalZc.
*
ADIMIAN ,
(Jardinage. )
c'eíl: le nom que les
Fleuriíl:es donnent a une tulipe amarante, panachée
de rouge
&
de blanco
ADJOINDRE, v. aa.
(Jurifprudence.
)
c'eft don–
ner
a
quelqu'un un collegue, lui aírocier un fecond.
roye{
ADJOINT.
(H)
ADJOINT,
terme de Grammaire.
Les Grammai–
riens qui font la confuuaion des mots de la phrafe,
relativement au rapport que les mots ont enu·'eux
dans la propofition que ces mots forment , appellent
adjoim
ou
adjoir.esles mots ajolltés
a
la propofition,
&
qui n'entrent pas dans la compofition de la pro–
pofition: par exemple, les interjeaions
hélas, ha!
&
les vocatifs.
H ilas , petits molltons, que 1'OUS ttes heureux!
Que 1'OUS étes heureux
(ont les mots qui forment le
fens de la propofition;
que
y entre comme adverbe
de quantite, de maniere,
&
d'admiration;
quantam,
combien,
aquel point,
1'oUS
eíl: le (ujet,
étes heureux
eft I'attribut, dont
éles
eíl: le verbe, c'eíl:-a-dire, le
mot qui marque que c'eft de vous que I'on dit
hes
heureu:t,
&
heureux
marque ce que I'on dü que
vous
Jees,
&
fe rapporte a vous par un rapport d'identité.
Voilit la propofition
complete.H.!las &petits montons
ne font que des adjoints.
1/.
SUJET , ATTRIBUT.
(F)
ADJOINTS, adj.
(Belles- Lettres)
[ont au nombre
de [ept , qu'on appelle au1Ii
circonflances,
exprimées
par ce vers,
Quis, quid,
ubí,
guipus auxiliis , C/lr, quomodo,
quando.
Les argumens c¡ui (e tirent des
adjoims
,
[ont des
adminic.ule~
des preuves qui nailfent des circonftan–
ces partLculteres du fait.
rOJeZ
PREUVE
&
CIRCONS-
TANCE.
.
E~1
Rhétorique, les adjoints ,
adjunaa,
forment
\Ul
heu c;ommu)1 d'oh l'on tire des argumens
po~u
ou
A D
J
centre pre(que dans toutes les matieres,parce
qu'iI
el1
eíl: peu qui ne foient accompagnées de circonfiancei
favorables ou d 'favorables; la chofe eíl: fi claire ,
cJ1l'il feroit inutile d'en donner des exemples. (
G)
AD
J
o
1
NT , adj. pris (ubft. On appelle ainfi une
forte d'aírocié, de collegue ou de coadjuteur c¡u'on
donne a c¡uelqu'un qui eff en place, ou pour le foula–
ger dans fes funaions, ou pour rendre compte de fa
vigilance
&
de fa fidélité.
Quelques- uns p[ononcent
&
écrivent
ajoints:
mais ils prononcent
&
écrivent mal.
(H)
ADJOINT de l'Académie des Sciences.
Voye{
ACA–
DÉMIE.
ADJOIN'r,
OJlicierde la Librairie
;
c'eftun Libraire
él!l
a
la pluralité des voix dans l'aírcmblée générale
des Anciens,
&
de feize mandés daas le nombre eles
Modernes, qui font ceuxqui ont au moins dix ans de
réception; prépo(é conjoil}tement avec le Syndic
pour régir les alfaires de la Com'munauté,
&
veiller
a
l'obfervation des Réglemens donnés par nos Rois
fur le fait de la Librairie
&
de l'lmprimerie.
TI
yen
a
c¡uatre Cflú avec le Syndic fonnent ce Cfll'on appelle
les
0Jli,iers de la Libmirie.
Leurs principales fonaions (ónt ele vifiter en la
Chambre Syndlcale de la Librairie les livres CfllÍ ar–
rivent a Paris, foit des Provinces du Royaume , (oít
des Pays étrangers; de faire des vifites chez les Li–
braires
&
chez les Imprimeurs, pour voir s'jl ne
s'y paíre rien contre le bon ordre;
&
dans le cas
de contravention , en rendre compte
a
M. le Chan–
celier. Ils font encore chargés de faire la vifite des
bibliothecJues ou cabinets de livres
a
vendre, afia
de veiller
a
ce qu'il ne fe débite p·lr aucunes voies
des livres pro{crits ,
&
délivrent un certificat fm le–
Cfllel le Lieutenant de Police accorde la permiflion
.de vendre
&
d'afficher la vente.
roye{
SYNDI C,
CHAMBRE SYNDI CALE.
ADJONCTION,
f.
f.termedeflyleduPalais,
qll'on
emploie dans les plaintes en matiere criminelle , OIL
I'on demande I'intervention ou
adjolZélion
de M. le
Procureur Général, ou de fon Subftitut , ou du Pro–
cureur fifcal,
fi
la plainte n'eft point portée devant
une Juftice royale. Or demander
l'adjolZélion
du Mi–
nillere public, c'eíl: demander <¡u'il fe porte accufa–
teur,
&
pourúlÍve I'accufé en lon nom concurrem–
ment avec la partie civile.
(H)
ADJOURNEMENT ,
f.
m.
(Jurifprud.)
eíl:. une
affignation a comparoitre a certain jom nommé pot1r
procéder par-devant une Cour de Juftice ou un Juge
aux fins
&
conclufions de I'exploit d'affignation
1
c'eíl-a-dire , les contefter ou y déférer.
roye{
ASSI–
GNATION.
Ménage dérive ce mot de
adjurnare,
camme
Cflli
diroit
diml dicere,
Cfll'on trouve en ce fens dans les
capitulaires.
L'adjournement en Cour ecc1éfiaftique s'appeU.
citatiolZ.
L'affignation n'emparte pas totljours
adjournement;
par exemple, les témoins qu'on affigne a venir dé–
po[er ne font pas adjournés: l'a1Iignation n'emporte
adjournement Cflle quandla partie eft aflignée a com–
paroitre en Juftice.
Les adjournemens doivent &tre libellés', c eft-a–
dire, contenir les conclufions
&
les moyens de la de–
mande.
roye{
LIBELLÉ.
Les ajournemens par-devant les Juges inférieurs
fe donnent fans commiflions:
ftcrls
es Cours {upé–
rieures: par exemple, on ne peut donner adjourne–
ment aux ReCflletes de I'Hotel ou du Palais ,
~u'en
vertu de Lettres de
Commiuimus
dont {era laiíre co–
pie avec I'exploit,
fi
ce n'eíl qu'il y eut déja inftance
liée ou retenue en cette Com , auquel cas
iI
ne {eroir
pas befoin deLettres: on ne le peut non plus es Cours
fupérieures, telles Cflle le Pa,rlement,
Qn
autres, qu'en
















