
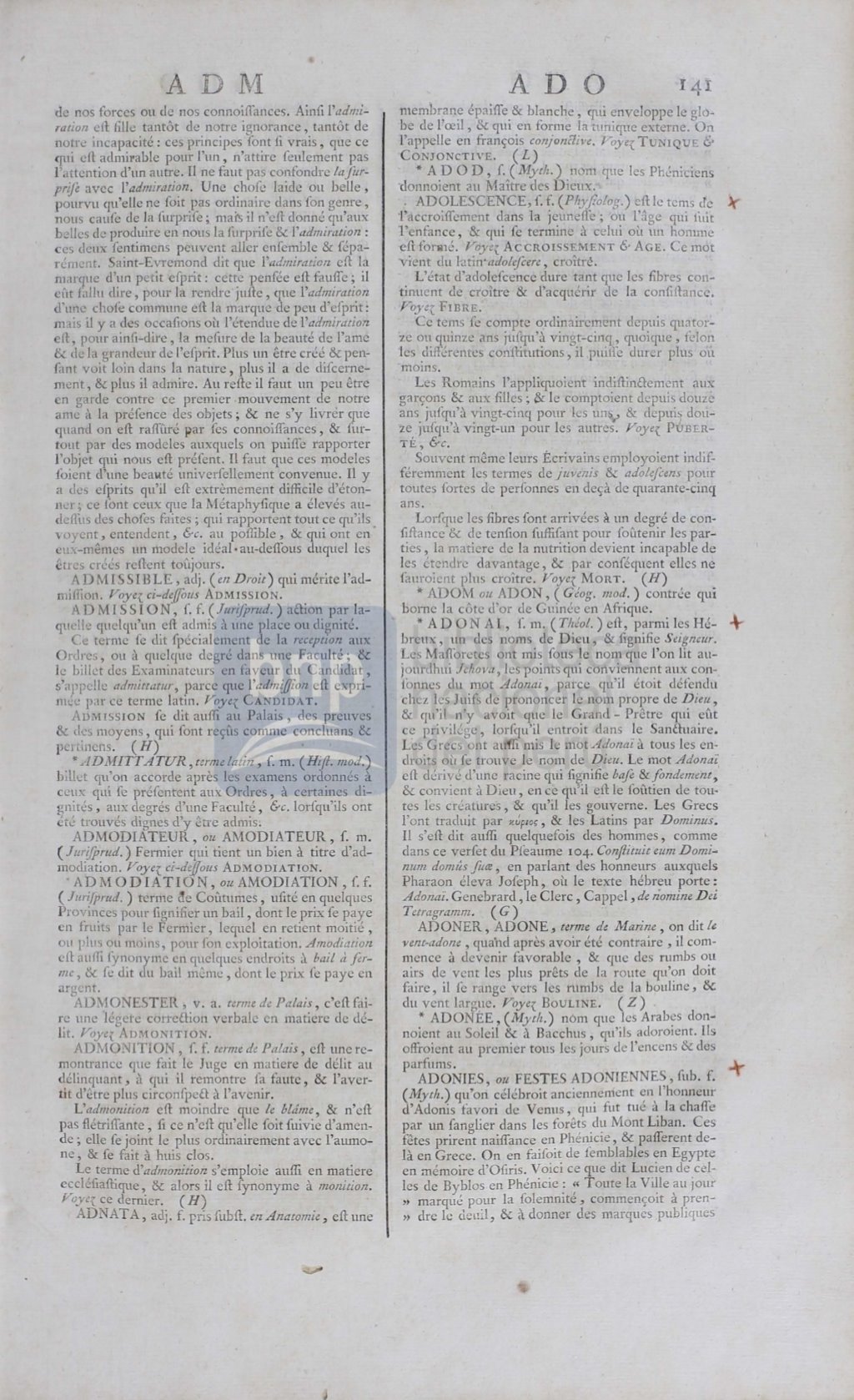
ADM
de nos forces ou de nos connoiiTances. Ainfi
l'
admi–
Tatioll
eíl filie tantot de nou-e ignorance, tantot de
notre incapacité : ces príncipes font fi vrais, que ce
<fui cíl ailllul·able pOlU" l'un, n'attire feulement pas
l'attentíon d'tUl antre.
Il
ne faut pas confondre
Lafur–
prife
avec
l'admiratioll.
Une chofe laide ou belie,
ponrvll qu'elie ne foít pas ordinaire dans fon genre,
nOlls caufe de la furprife; mats il n'ell: donné qu'aux
belies de produire en nous la nlrprile
&
l'
admiratiOll :
ces dellx fentÍmens petlvent aller enfemble
&
fépa–
rément. Saint-Evremond dit que
J'admiratioll
eft la
marque d'un petit efprit: cette penfée eíl fuu1Te; iI
eíit falIu dire, pCntr la rendre jufte , que
l'
admiratioll
d'une chole commune eílla marque de pel1 d'efprit:
mais il y a des occafions oil1'étendue de
l'admiration.
ell:, pour ainíi-dire , la meíilre de la beauté de l'ame
&
de la grandenr de ['efprit. Plus un etre créé
&
pen–
fant voit loin dal1s la nanlre, plus
i1
a de difcerne–
ment,
&
plus il admire. Au reíle
il
faut un peu etre
en garde contre ce premier ·mouvement de nou-e
ame
a
la préfence des objets;
&
ne s'y livrer qne
quand on eíl raílltré par fes connoiifances,
&
fur–
tout par des modeles auxquels on pui{[e rapporter
robjet qui nous ell: préfent.
Il
fallt que ces modeles
{oient d'une
beall.téuniver{ellement convenue.
Il
y
él
des efprits qu'il ell: extremement difficile d'éton–
Her; ce Iont ceux que la Métaphyfique a élevés au–
dcírllS des cho{es faites ; gui rapportent t0l:1t ce qu'ils .
voyent , entendent,
&c.
au poilible,
&
gilí ont en
c\lx-memes un 1110dele idéal ·au-de{[ous duquel les
etrcs créés reílent
toújour~.
ADMISSIBLE, adj.
(en
Droit)
qui mérite 1'ad–
miffioll.
Yoye{ ci-deffous
ADMISSION.
AD
MI
SS
1
ON, (.
f.
(JuriJPrud.)
ailion par la–
queHe quelqu'un eíl admis
á
une place on dignité.
Ce terme fe dit fpécialement de la
reception
allX
Ordres, ou
a
quelque degré dans une Faculté;
&
le
billet des Examinateurs en fuveur dn Candielat,
s'appc!le
admitlatur,
parce que
l'admijJzon
eíl expri–
m::c par ce terme latino
Yoye{
CANDIDAT.
ADMISSION (e dit auffi au Palais, des preuves
&
des
moyens, qui font reS:lls comme coneluans
&
pcnineos.
(H)
*ADMITTATUR, termelatill ,
f.
m.
(Hifl.
mod.)
balet qu'Ol1 accorde apres les examens ordonnés 11
cellx 'luí fe préfenteht anx Orelres, a certaines di–
gnités , aux elegrés d'une Faculté , &c.lorfc¡n'ils ont
ét<.\ trouvés dignes d'y &tre
admis~
ADMODIATEUR,
oz¿
AMODIATEUR, f. m.
(JuriJPrud.)
Fermier qui tient un bien a titre d'ad–
modiatíon.
Yoye{ ci-deflolts
ADMODIATION.
ADMODIATION, ouAMODlATION, f.f.
e
Jllrifprud.
) terme <1e Coutumes, uíité en c¡uelc¡ues
Pro,:illces pour íignifier un baíl, dont le prix {e paye
en fruits par le Fermier, lec¡nel en retient moitié ,
0\1
pl\1~
Ol! moins, pour fon exploitation.
Amodiation
ell: auffi fynonyme en quelques endroits
a
balL
ti
fir–
me,
&
{e dit du bail meme , dont le prix {e paye en
argento
ADl\10NESTER ,
V.
a.
terote de Palais,
c'eíl
fai–
re une léget-e cotteaion verbale en matiere ele dé–
lit.
Yoye{
ADMONITION.
ADMONITION,
f.
f.
termede Palais
, ell: tmere–
montranee que fait le Juge en matiere de délit an
détinquant ,
a
'lui
il
remontre fa fante,
&
l'aver–
tit d'ihre plus circonfpetl a 1'avenir.
L'admollition
eíl moindre que
le
bldme,
&
n'eíl
pas flétri{[ante,
1i
ce n'eft qu'elle {oit {lIivie d'amen–
de ; elle fe joint le plus ordinairement avec 1'atUllO–
He,
&
{e fait
a
huís elos.
Lc terme
d'admorntion
s'emploie auffi en matiere
eccJéíiaílic¡ne,
&
alors il ell: (ynonyme a
mOllilioll.
Yo~,,~{
ce dernier.
(H)
ADNATA , adj. f. prisnlbft.
enAllatomie,
eílune
ADO
membr,an~
épaure.
&
blanche, ql.l.i enveloppe le glo–
be de
1
ceil,
&
qm en forme la nmiqne eJ\:terne. On
l'appelle en frans:ois
conjonClive. Yoye{
TUNIQUE
&
CONJONCTIVE. (
L)
*
A D O D ,
f. (
Myth.)
nom que les Phéniciens
donnoient au Maitl-e des D ieux.
. ADOLESCENCE,{. f.
(Phyjiolog.)
eílle tems de
J(
1'l1ecroi{[ement dans la ieuneífe; ou l'age qui iiut
l 'enfance,
&
c¡uí {e termine a celui
O~l
un homme
efrfonl1é.
Yoye{
AC-CROISSEMENT
<S.
AGE. Ce mot
""ient du
Iatin-adoLifcere,
cromé.
L'état d'adole{cenee dure tant que les libres con–
tinuent de croItre
&
d'acqllérir de la con{jftanee.
royet
FIBRE.
Ce tems {e compte ordil1arrement depuis quator–
ze ou quinze ans jnfqn'a vingt-cinq, quoique, íelon
les différentes conirrtlltions,
iI
pui1fe dur r plus OH
moius.
Les Romains l'appliquoient indiftinaemcnt anx
garS:0Hs
&
aux filIes;
&
le comptoient depuis dome
ans jufc¡u'a vingt-cinq pom les un ...
&
deplli.~
dou–
ze jufqu'a vingt-un pour les autres.
Yoye{
PÚBER–
TÉ,
&c.
SOllvent meme leurs Écrivains employoient indif–
féremment les termes de
j uvenis
&
adoLejeens
pour
toutes fortes de perfonnes en deC;a de quarante-cinq
ans.
Lorfque les fibres {ont anivées
a
un degré de con–
fillance
&
de teniion fuffi{ant pour foutenir les par–
ties, la matÍere de la nutrition deVÍem incapable de
les étcndre elavantage,
&
par con{équent elies ne
(auroient plus croltre.
Yoye{
MORT.
eH)
*
ADOlv!
Olt
ADON ,
e
GJog. mod.)
contrée clui
borne la cote el'or de Gllinée en Afrique.
*
A D O N A
r,
f. m.
e
Tlufol.
) eíl, parmiles Hé-
+
breux, un des noms de Dieu,
&
fignifie
Seigneur.
Les Ma{[oretes ont mis {ous le nom que 1'0n lit au–
jourdhlli
fehova,
les points qui conviennent aux con–
ionnes du mot
Adona'i,
parce qn'il étoit défendu
chez les Juifs de prononcer le nom propre de
D ieu ,
&
qu'il n'y avoit que le Grand - Pretre qui eut
ce privilége, lorfqu'il entroít dans le Sanfulaire.
Les Crecs ont auffi mis le
motAdona'i
a
tous les en–
droits
ot,
fe trouve le nom de
Diell.
Le mot
Adona,
eíl dérivé d'tUlC racine qui ngnifie
baje &fondemem,
&
eonvient
a
Dieu, en ce qu'il eílle foutien de ton·
tes les crél1tur s ,
&
qn'il les gOllverne. Les Crees
l'ont traduit par
"JplO~ ,
&
les Latins par
Domillus.
Il s'eíl dit auffi quelquefois des hommes, comme
dans ce ver{et du Píeaume
104.
Conftituiteum D omi–
nltm
d01711tS jiU!!,
en parlant des honneurs auxquels
Pharaon éleva Jofeph, Olt le texte hébreu porte:
Adonai·.
Cenebrard , le Clerc , Cappel ,
de
nomine D ei
Tetragramm.
(
G)
ADONER, ADONE,
terme de Marine ,
on dit
le
'JIent-adone
, qua'nd apres avoir été contraire ,
il
com–
mence
a
devenir favorable,
&
que des rumbs OH
airs de vent les plus prets de la route qn'on doit
faire, il fe range vers les rumbs de la bouline,
&
du vent largue.
Voye{
BOULINE.
e
z)
*
ADONÉE,
(Myth. )
nóm que les
Arab~s
don–
noient an Soleil
&
a
Bacchus, qu'ils adorOlent. Ils
offroient au premier tous les jOllrs de l'encens
&
des
parfums.
+
ADONIES,
OIl
FESTES ADONIENNES, fub. f.
(Myth.)
qll'on célébroit anciennement en l'honnettr
d'Adonis favon de Venus, 'luí fut nté
~
la cha{[e
par 1m fanglier dans fes forets
d~l
Mont LIban. Ces
fetes prirent nl1iífance en Phérucle,
&
paíferent de–
la
en Crece. On en faifoit ele femblables en Egypte
en mémoire d'Ofiris. Voici ce que dit Lucien de cel–
les de Byblos en Phénicie:
~<
T oute la
V~le
au jour
" marqué pour la {olemmte, commenS:0lt
a
I?ren–
,¡
dre le dellil,
&
a
donner eles marques pubhques
















