
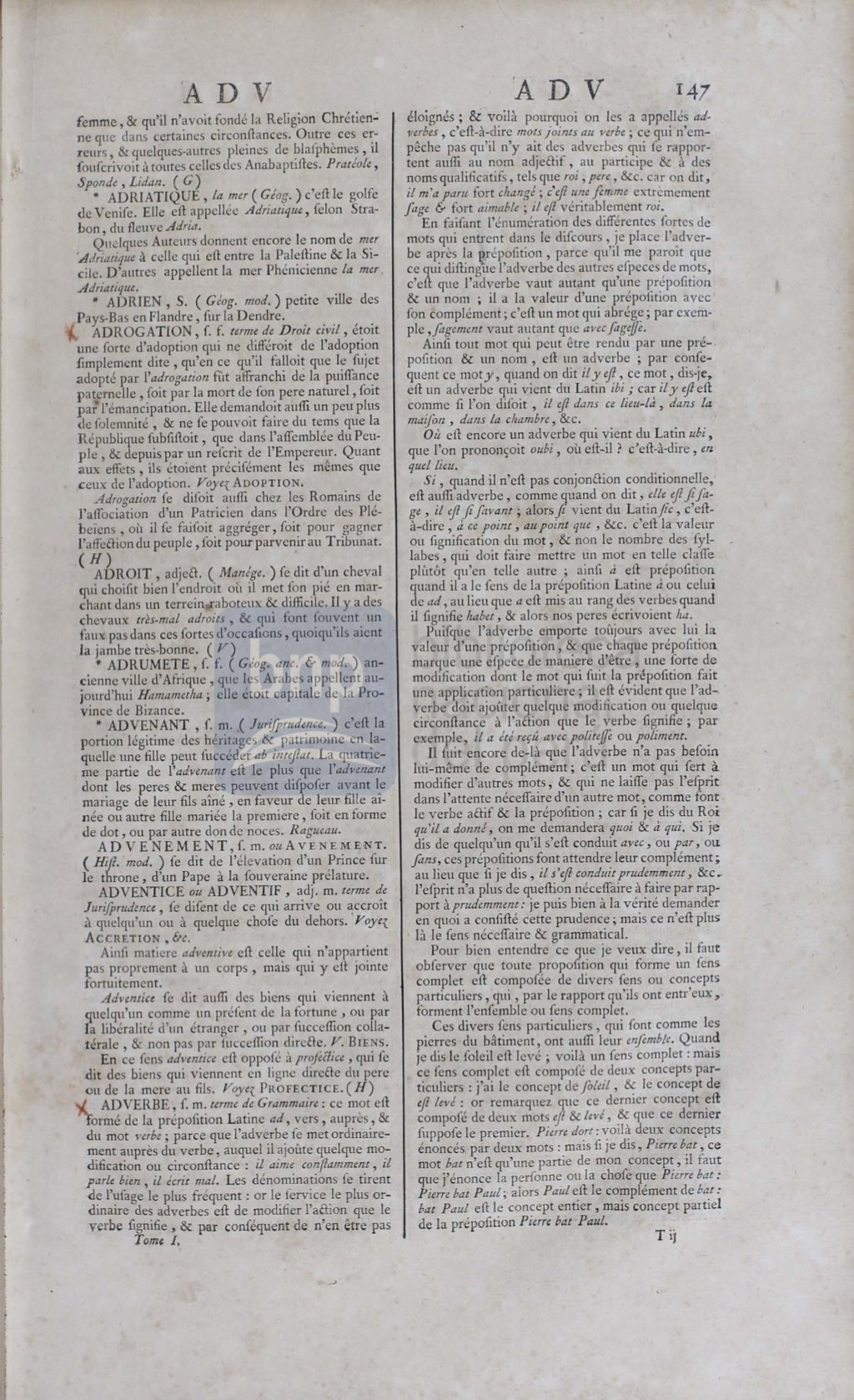
ADV
femme, & qu'il n'avoit fondé la Religion Cmétien':
ne que dans certaines circonfiances. Ouu'e ces er–
reurs, & quelques-autres pleines de blafphemes , il
foufcrivoit ft routes celles des Anabaptiíl:es.
Pratéoü,
Sponde, LitÚzn. (G)
.. ADRlATIQUE,
La mer (Glog.
)
c'eíl: le golfe
de Venife. Elle eíl: appellée
Adríatique,
felon Stra–
bon, du fleuve
Adría.
QlI Iqlles Auteurs donnent encore le nom de
ma
'AdriatÍljlle
a
celle
qui
eft entre la Paleiline
&
la Si–
cile. D'autres appellent la mer Phénicienne
La mer
Adríatique.
.. ADRlEN, S.
(Gtfog. mod.)
petite viUe des
Pays-Bas en Flandre, fUI la Dendre.
ADROGATION, f. f.
terme de Droít civil,
étoit
une forte d'adoption qui ne diiféroit de l'adoption
íimplement elite, qu'en ce qu'il falloit que le fujet
adopté par
I'adrogation
mt affranchi de la puiífance
paternelle , foir par la mort de fon pere natID'el, foit
par l'émancipatiol1. Elle demandoit auffi un peu plus
de folemnité, & ne fe pouvoit fau'e du tems que la
République fubftfioit, que dans l'aífemblée du Peu–
pIe,
&
depuis par un refcrit de l'Empereur. Quant
aux effets , ils étoient préciCément les memes que
ceux de I'adoption.
Voye{
AnOPTION.
Adrogatíon
fe difoit auffi chez les Romains de
l'aílociation d'un Patricien dans l'Ordre des Pié–
belens , oil il fe faifoit aggréger, foit pour gagner
l'affcél:ion du peuple, foit pour parvenu' au Tribunat.
(H)
ADROlT , adjeél:. (
Manége.
)
fe dit d'un cheval
qui choifit bien l'endroit Oll il met fon pié en mar–
chant dans un terrein raboteux
&
difficile.
11
y a des
chevaux
tr~s-mat
adroíts,
&
qui font fouvent un
faux pas dans ces fortes d'occafLOns, quoiqu'ils aient
la jambe tres-bonne.
(V)
'" ADRUMETE,
f.
f. (
Géog. anc.
&
modo
)
an–
cienne ville d'AfriCflle, que les Arabes appellent au–
jourd'hui
Hamametha;
elle étoit capitale de la Pro–
vince de Bizance.
.. ADVENANT ,
f.
m. (
Jurifprudence.
)
c'eft la
portion légitime des héritages
&
patrimoine en la–
quelle une filie peut fuccéder
ab imejlat.
La quatrie–
me partie de
I'advenant
eíl: le plus que
['advenallt
dont les peres
&
meres peuvent difpofer avant le
mariage de leur fils amé, en faveur de leur fiUe al–
née
011
autre fille mariée la premiere, foit en forme
de dot, ou par autre don de noces.
Ragueau.
AD V ENEM ENT,
f.
m.
ouA
VENEM ENT.
(
Hip. modo
)
fe dit de I'élevation d'un Prince fm
le throne, d'un Pape
a
la fouveraine prélanlre.
ADVENTICE
ou
ADVENTIF , adj. m.
terme de
Jurifprudence,
fe difent de ce qui arrive ou accrolt
a
quelqu'un ou
a
CfllelCflle choCe du dehors.
''''oyt{
ACCRETION •
fre.
Ainfi matiere
adventive
eft celle CfltÍ n'appartient
pas
~roprement
a un corps, mais qui y eíl: jointe
fortllltement.
Advelltí"
fe dit auffi des biens qui viennent ft
quelqn'un comme un préfent de la fortllne , ou par
la libéralité d'un étranger , ou par fllcceffion colla–
térale , & non pas par lilcceffion direél:e.
V.
BIENS.
En ce fens
adventÍce
eíl: oppofé
a
profiélíce
,
qui fe
dit des biens qui viennent en ligne direcre du pere
ou de la mere au fils.
V¡rye{
PROFECTICE.(H)
"ti..
ADVERBE,
f.
m.
temze de Grammaire
:
ce moe eft
formé de la prépolition Latine
ad,
vers , aupres ,
&
du mot
verbe;
paree que I'adverbe fe met ordinaire–
ment allpres dll verbe, auquel il ajollte Cfl,elque mo–
dification ou circoníl:ance :
iL
aime conflamment, íL
parle bien, íi
leríe
mal.
Les dénominations fe tirent
de I'ufage le plus fréquent : or le fervice le plus or–
dinalre des adverbes eíl: de modifier l'aél:ion que le
verbe íignifie ,
&
par
conféCfllent de n'en etre pas
Tom~
J.
'A D V
I47
éloignés ; & voiHl pourquoi on
les
a appellés
ad–
,'erbes,
c'eft-a-elire
mots joínts alt verbe;
ce qui n'em–
peche pas qu'il n'y ait des adverbes
qui
fe rappor–
tent auffi au nom adjeél:if, au participe & a des
noms qualificatifs, tels que
roí, pere,
&c. car on dit,
it m'a pam
fort
changé; e'eft une fi",me
extremement
¡age
&
fort
aímable
;
ít efl
véritablement
roí.
En faifant l'énumération des elifférentes fortes de
mots qui entrent dans le difcours, je place I'adver–
be apd!s la g.répofition , parce qu'i1 me parolt que
ce qui eliíl:ingue I'adverbe des autres efpeces de mots,
c'eft que I'adverbe vaut autant qu'une prépofition
& un nom ; il a la valem d'une prépofition avec
fon complément; c'eft un mot qui abrége; par exem–
pie
,fagement
vaut autant que
aveefagif{e.
Ainfi tout mot qui peut etre rendu par une pré–
pofition & un nom , eft un adverbe ; par confe–
quent ce
moty,
quand on dit
ít
y
eft,
ce mot, elis-je.
eft un adverbe qui vient du Latin
íbi;
car
it
y
ejl
eft
comme fi l'on difoit,
íL eft dans
ce
Litu-la, dans la
maijOn, dans la ehambre,
&c.
OÚ
eft encore un adverbe qui vient du Latín
ahi,
que l'on
pronon~oit
ollbi,
Ol!
eft~il
?
c'eft-a-dire,
en
quet lieu.
Si,
quand
i1
n'eft pas conjonél:ion conditionnelle,
eft auffi adverbe, comme 9uand on dit,
eLLe eft
ji
Ja–
ge, iL ejl
ji
Javant
;
alorsj'
vient du Latinjic, c'eft–
a-dire,
a
ce
poínt, au poínt 'fue,
&c. c'eft la valeur
ou fignification du mot,
&
non le nombre des fyl–
labes, qui doit faire mettre un mot en telle c1a{[e
plutot qu'en telle autre ; ainfi
ti.
eft prépofition
quand il a le fens de la prépofition Latine
a
ou celui
de
ad,
au lieu que
a
eft mis au rang des verbes quand
iI
fignifie
habet,
& alors nos peres écrivoient
ha.
Puifque l'adverbe emporte tofljours avec lui la
valeur d'une prépofieion , & que chaque prépolition
marque une efj)ece de maniere d'etre , une forte de
modification dont le mot qui fuit la prépofition fait
une application particuliere; il eft évident que I'ad–
verbe doit ajoí'tter quelque modification ou quelque
circonftance a l'aél:ion que le verbe fignifie ; par
exemple,
it a élé
re~u
avee poliuJfe
ou
poliment.
Il
fuit encore de-la que I'adverbe n'a pas befoin
lui-meme de complément; c'eft un mot qui fert
a
modifier d'autres mots,
&
qui ne lai{[e pas l'efprit
dans l'attente néce{[aire d'un autre mot, comme font
le verbe aél:if
&
la prépofition; car fi je elis du Roi
qu'iL a donné,
on me demandera
quoi
&
a 'fui.
Si
je
elis de quelqu'un qu'il s'eft conduit
avee,
ou
par,
OtL
fans,
ces prépofitions font attendre leur complément;
aulieu que fi je dis ,
it
s'eft eondulcprudemment,
&c_
l'efprit n'a plus de queftion néce{[aire a faire par rap–
port a
pnuiemment:
je puis bien a la vérité demander
en quoi a confifté cette prudence; mais ce n'eíl: plus
la le fens néce{[aire
&
grammatical.
Pour bien entendre ce que je veux dire, il faut
obferver que tonte propolition qui forme un fens
complet eíl:
compoCée
de divers fens ou concepts
particuliers, qui , par le rapport qll'ils ont entr'eux
~
forment l'enfemble ou fens complet.
Ces divers fens particuliers, qui font comme les
pierres du batiment, ont auffi leur
enfembLe.
Quand
je dis le foleil eft levé; voilft
tLI1
fens complet :mais
ce fens complet eft compofé de deux concepts par–
ticuliers : j'ai le concept de
jiJltil
,
&
le concept de
eft levé:
or remarql1ez que ce dernier concept eíl:
compofé de deux mots
eft
&
levé ,
~
que ce dernier
fuppofe le premier.
Píem dor! :
vOlla deux concepts
énoncés par deux mors : mais íi je dis,
Pierre bat
,
ce
mot
bat
n'eft qu'une partie de mon concept, il faut
que j'énonce la perfonne ou la chofe que
Piu re bat :
Piure bat Pautó
alors
Paul
eíl: le complément de
bat:
bat Paut
eft le concept entier , mais concept partie1
de la prépoíition
Piure bat Paul.
Tij
















