
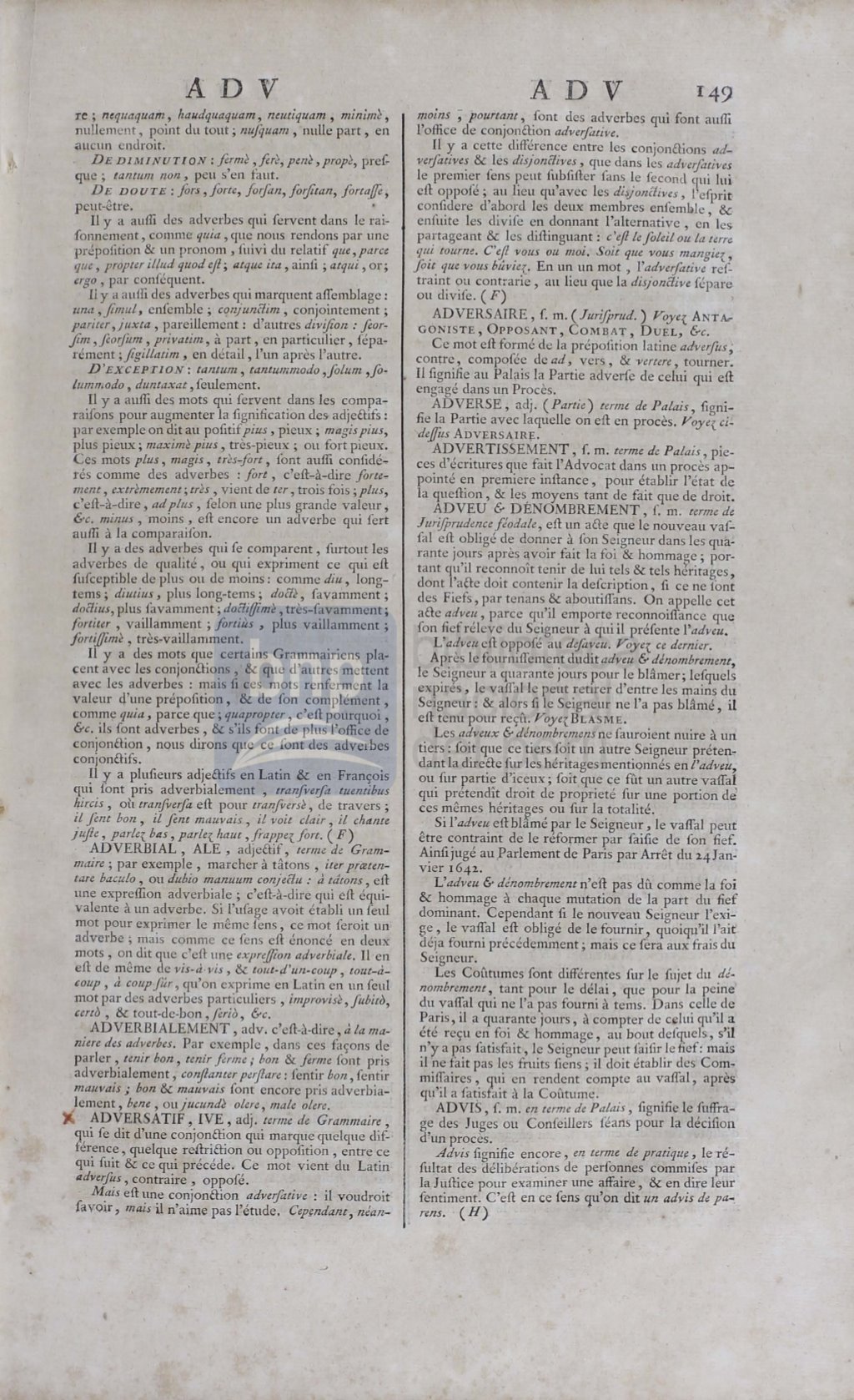
ADV
re ;
nequaquam, haudquaquam, ntlltiquam,
minim~,
nullement, point du tout ;
nufquam
,
nulle part, en
aucun cndroit.
DE DIMINUTION:
fi:m~ ,/ér~, pen~ ,prop~,
pref–
que;
tamulll non,
peu s en faut.
DE D
o
U TE:
fors ,foru, foifan,foifitan, fortaffi,
pellt-etre.
.
Il Y
a aulIi des
adv~rbes
qui [ervent dans le rai–
{ollnement comma-
'lUla,
que nous rendons par une
prépoútion'
&
un pronom , [uivi du n:latif
que ,.paree
que, propur ilfu;' quod
eJl;
,uque ua,
amú ;
atqul
,
or;
crO'o
,
par con[equent.
"Ji
ya auffi des adverbes
~Ii
m?rquent
~í!'emblage:
lina ,fimul,
en[emble;
conJunclLm,
con)OIntement;
pariur ,jllxta
,
pareillement: d'auu'es
divijion
:
fior–
fim ,fiorjitm, privatim,
a
part, en particulier, [épa–
l'ément
;figiLLatim,
en détail, l'tm apres I'antre.
D'EXCEPIION:
tallLum, tantummodo ,jolllm ,jo–
lummodo, dumaxat,
[eulement.
Il
y a auffi des mots qui [er,:,ent ,dans les c,ompa–
rauons pour augmenter la
~g~lficat~on
des
ad)~éh,fs
!
par exemple on dit au pOúuf
plus.
'
plenx;
magls
ftuS,
plus pieux;
maxilll~
pius
,
tres-pleux; ou fort pleux.
Ces mots
plus, magis, tres-fart,
[ont auffi conúdé–
rés comme des adverbes :
fort,
c'eft-a-dire
forte–
ment, extrememem;
tres
,
vient de
ter,
u'ois fois ;
plus,
c'eft-a-dire,
adplus,
[elon une plus grande valeur,
&c. minus,
moins , eft encore un adverbe qui [ert
aulTi
a
la comparaiion.
U
y a des adverbes qui [e comparent, [urtout les
adverbes de qualité, ou qui expriment ce qui eft
(u[ceptible de plus ou de moins: comme
diu,
long–
tems;
diutius,
plus long-tems;
doc7e,
[avamment;
doClius,
plus [avamment;
daa¡(fim~
,
tres-[avamment;
fortiter
,
vaillarnment ;
fortius
,
plus vaillamment ;
fortif!im~
,
tres-vaillarrunent.
II y a des mots que certains Grammairiens pla–
cent avec les conjonilions,
&
que d'aurres mettent
avec les adverbes : mais ú ces mors renferment la
valeur cj.'une prépoútion,
&
de [on complément,
comme
quia,
paree que;
quapropter,
c'eft pourquoi ,
&c.
ils [ont adverbes ,
&
s'ils font de plus l'of!1ce de
conjonétion, nous dirons que ce [ont des adverbes
conjonétifs.
Il
y
a pluúeurs adjeétifs en Latin
&
en Fran<;ois
'lui iont pris adverbialement ,
tranfveifa tuentibus
hircis ,
011
tranfoeifa
eft pour
tranfverse,
de travers ;
il fint bon, il fine maIlvais , il voÍ& dair, il chante
jujle, parle{ bas, parle{ IUlUt ,fral'pe{fort,
(F)
ADVERBIAL, ALE, adjeaif,
tmm de Gram–
mmre
;
par exemple, marcher a dhons ,
iter praten–
tare bacIllo ,
ou
dubio manuulll conjeClu.' a tátons
,
eft
une expreilion adverbiale ; c'eft-a-dire qui eft équi–
valente
a
un adverbe, Si
l'u[a~e
avoit établi un ienl
mot pour exprimer le meme iens, ce mot [eroit un
adverbe ; mais comme ce [ens eft énoncé en deux
mots, on dit que c'eíl: une
exprejJio/l adverbiale.
Il en
eft de
m~me
de
vis-a,vis
,
&
tout-d'un-coup, tout-a–
coup, a coupfúr,
qu'on cl\.:prime en Latin en un [eul
mot par des adverbes particuliers ,
improvis~,
Jitbito,
cereo,
&
tout-de-bon
,ferio, &c.
ADVERBIALEMENT, adv. c'eft-a-dire,
ti
la ma–
nitre des adverbes.
Par exemple, dans ces
fa~ons
de
parler,
tenir bon, tenir firme; hon
&
firme
[ont pris
adverbialernent,
cOlljlanter
p~rjlare:
[enrir
hon,
[enrir
mauvais; bon
&
mauvais
[ont encore pris adverbia–
lement,
bene
,
ou
jucunde olere, male olere.
,.. ADVERSATIF, IVE, adj.
mme de Grammaire,
qui [e dit d'une conjonilion qlli marque 'lllelque dif–
férence, quelque refirillion ou oppoútion , entre ce
qui fuit
&
ce qui précéde. Ce mot vient dll Latin
IldvujitS,
contraire, oppo[é.
M,ais
eí!: une conjonfrion
adverjktive
:
il vOlldroit
{avo¡r,
mais
il
n'aime pas l'étllde.
Cep;ndant, n¿all-
ADV
moins
;
pourtant,
[ont des adverbes qui font auili
l'office de conjonétion
adverfative.
Il y a cette clifFérence entre les conjonaions
od–
veifatives
&
les
disjonc7ives,
quc dans les
adverfatives
le premier Cens pellt [ubúfter fans le fecond qui lui
eft oppoCé; au lieu qu'avec les
di;jonClives,
l'c[prit
conúdcre d'abord les deux membres en[emble ,
&
enCuite les diviCe en donnant l'alternativc , en les
panageant
&
les diftinguant:
c'ejlle foled OIl La terre
qui tourm. C'ejl vous ou moi. Soit que vous mangie{,
joit que vous búvie{.
En un un mot ,
I'adverfative
re[–
traint on contrarie, au lieu que la
disjonClive
[épare
ou divi[e. (
F)
ADVERS AIRE, f. m. (
Jllrijjmtd.) Voye{
ANT
h–
GONISTE, OPPOSANT, COMBAT, DUEL,
&c.
Ce mot eft formé de la prépofition latine
adverjitS;
contre, compofée de
ad,
vers,
&
vertere,
tourner_
Il
úgnifie au Palais la Partie adver[e de celui qui eft
engagé dans un Proces.
ADVERSE, adj,
(Partie) temu de Palais,
figni–
ne la Partie avec laquelle on eft en proces.
r
oye{
cí–
deffus
ADVERSAIR¡;:.
ADVERTISSEMENT, f. m.
terme de Pa/oís,
pie–
ces d'écritures que fait l'Advocat dans un proces ap–
pointé en premiere inftance, pour établir l'état de
la queftion ,
&
les, moyens tant de fait que de droit_
ADVEU
&
DENOMBREMENT, f. m,
terme de
JuriJPrudence féodale,
eft un aéte que le nouveau va[–
[al eft obligé de donner
a
ron Seigneur dans les qua–
rante jours apres avoir fait la foi
&
homma
g
e; por–
tant qn'il reconnoit tenir de lui tels
&
tels heritages ,
dont I'aéte doit contenir la defcription,
[1
ce ne iont
des Fiefs, par tenans
&
aboutiífans. On appelle cet
afre
adveu,
parce qu'il emporre reconnoUfance que
ron fief réleve du Seigneur
a
'luí il préCente l'
adveu.
L'
adveu
eft oppo[é au
defo.veIl. Voye{ ce demi.,.
Apres le fourniífement dudit
adveu
&
dénombrement,
le Sei
9
neur a quarante jours pour le blamer; le[qllels
expires, le vaífalle peut retirer d'entre les mains du
Seigneur:
&
alors fi le Seigneur ne l'a pas blarné, il
eft tenu pour re<;ll. Voye{BLAsME.
Les
adveIlx
&
d¿nombremens
ne [auroient nuire a un
tiers: [oit que ce tiers [oit un autre Seignem préten–
dant la direéte [m les héritages mentionnés en
l'adveu,
ou [ur partie d'iceux; [oit que ce fllt un autre vaífal
'lui pretendit droit de proprieté [ur une portion de'
ces memes
hérita~es
ou [ur la totalité.
Si l'
adveu
eft blamé par le Seigneur , le vaífal peut
~tre
contraint de le refopner par [aiúe de ron fief.
Ainú jugé au'parlement de París par Arret du 24
J
an–
vier 1642.
L'fldveu
&
dénomhremem
n'eft pas dlt comme la foi
&
homrnage achaque mutation de la part du fief
dominant. Cependant ú le nouveau Seigneur l'exi–
ge, le vaífal eft obligé de le fournir, quoiqll'i11'ait
déja fourni précédemment; rnais ce [era aux frais du
Seigneur.
Les COltnlrnes [ont différentes {ur le [ujet du
dé–
nombrement,
tant pOllT le délai, que pour la peine
du vaífal qui ne I'a pas fourni
a
tems. Dans
~elle.
de
Paris, il a quarante jours,
a
compter de celul qU'll
~
été re<;u en foi
&
hornrnage, au bout de(q:lels, s',il
n'y a pas [arisfait , le Seigneur peut íáifir ,le fief: malS
il ne fait pas les fruits úens ; il doít étabhr des Com–
miífaíres, qui en rendent compte au vaífal, apres
qu'il a [atisfait
a
la Colltume.
ADVIS, f. m.
en &erme de Pfllms,
Ggnifie le fn,ffra–
ge des
J
uges on Con(eillers [éans pour la declúon
d'tm proces.
"
Advis
úgnifie encore,
en termt de pratlqllf..,
le re–
[ultat des délibérations de per[onnes comm¡[es pa.r
la Jufrice pom examiner une affaire,
&
en dire leur
fentiment. C'eft en ce [ens qu'on dit
un adyjs de pa.,
mlS.
(H)
















