
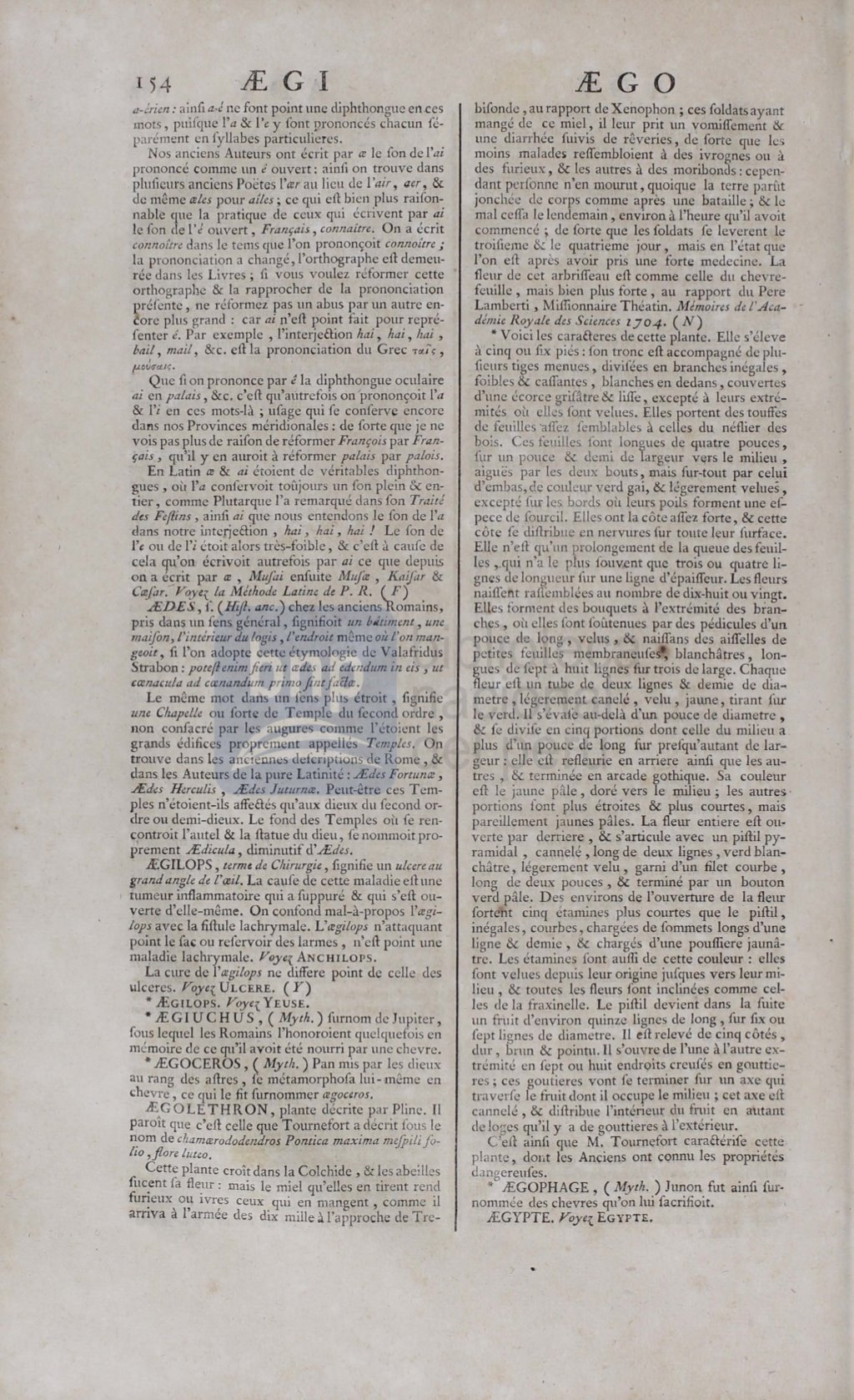
154
..,E
G 1
a-Jrien:
ainfi
a-é
ne font point une cüphthongue en ces
mots, puif'lue l'a
&
I'e y [ont prononcés chacun
[é–
parément en fyllabes particulieres.
Nos anciens Auteurs ont écrit par a le Con del'aí
prononcé comme un
¿
ouvert: aiofi on trouve dans
plufieurs anciens Poetes l'
ar
au lieu de
l'air, aer,
&
de meme
ales
pour
arles;
ce qui eíl: bien plus raifon–
nable que la ln'atique de ceux qui écrivent par
ai
le fon de l'
J
ouvert,
Franfais, conna[tre:
On a
~crit
cOllnoltre
dans le tems que l'on pronon<;olt
connoltre;
la prononciation a changé, l'orthographe eíl: demeu–
rée dans les Livres; fi vous voulez réformer cette
orthographe & la rapprocher de la prononciation
pré[ente, ne réformez pas un abus par un autre en–
~ore
plus grand : car
aí
n'eíl: point fait pour repré–
[enter
é.
Par exemple , l'interjefuon
haí, hai, Itai ,
baíl, mail,
&c. eíl: la prononciation du Grec
Tctl~
,
fLO~q'('lIt;.
Que fi on prononce par
é
la diphthongue oculaire
ai
en
palais,
&c. c'eíl: qu'autrefois on pronon<;oit l'a
&
l'i
en ces mots-l1\ ; u[age qui [e con[erve encore
dans nos Provinces méridionales : de forte que je ne
vois pas plus de rai[on de réformer
Franfois
par
Frtzn–
fais,
qn'il yen auroit
a
réformer
palais
par
paloís.
En Latin a &
oí
étoient de véritables diphthon–
gues , Oll l'
a
con[ervoit toftjours un Con plein
&
en–
rier, comme Plutarque l'a remarqué dans [on
Traid
des Feflills,
ainfi
aí
que nous entendons le Con de l'a
dans noo'e interjeéEon ,
lzai, hai, hai!
Le Con de
l'e ou de I'i étoit alors tres-foible, & c'eíl: a catúe de
cela qu'on écrivoit autrefois par
aí
ce qne depui.s
on a ecrit par a ,
MuJlzi
enfuite
Mufa
,
Kaifar
&
Cafar.- Voye{ la M¿thode Latíne de
P.
R.
(
F)
.JJDES,
í:
(Hzjf.
ane.)
chez les anciensRomains,
pxis dans un [ens général , figrnfioit
UIl
bJtiment, une
Illaifon, l'íntérieur du logis
,
['~ndroit
meme
ou l'Oll mall–
gtoit,
fi l'on adopte cette étymologie de Valafridus
Strabon:
poeeflenimfieri
ut
ades ad edendum ín tis, ut
camacula ad call1andum primoJimfaélre.
Le meme mot dans un [ens plus étroit , fignifie
une Citapelle
ou Corte de Temple du [econd ordre ,
non confacré par les augures comme l'étoient les
grands édifices proprement appellés
Temples.
On
trouve daos les anciennes detCriptions de Rome , &
dans les Auteurs de la pure Latinité :
./.Edes Fortulla,
./.Edes Herculis
,
./.Edes Jumrfla.
Peut-etre ces Tem–
ples n'étoient-ils affeél:és qu'aux dieux du fecond or–
dre ou demi-dieux. Le fond des Temples Ol! [e ren–
controit l'autel & la íl:atue du dien, fe nommoit pro–
prement
./.Edícula,
diminutif
d'./.Edes.
lEGILOPS,
terme de C/¡irurgíe,
fignifie un
ulcereau
grandangle de ['aJil.
La cauCe de cette maladie eíl:une
nlmeur inflammatoire qni a fuppuré & qui s'eíl: ou–
verte d'elle-meme. On confond mal-a-propos
I'agi–
lops
avec la fiíl:ule lachrymale.
L'regilops
n'attac¡uant
point le [a¡; ou re[ervoir deslarmes, n'eíl: point tille
maladie lachrymale.
roye{
ANCHILOPS.
La cure de
I'agilops
ne differe point de celle des
ulceres.
Voye{
ULCERE.
(Y)
.. ftGILOPS.
Voye{
YEUSE.
.. ftGIU C H U S, (
Myth.)
[urnom de Jupiter,
[ous lequel les Romains l'honoroient quelquefois en
mémoire de ce Cju'il avoit été nourri par une chevre.
.. .tf:GOCEROS , (
MytlL.)
Pan mis par les dieux
au rang des aíl:res, fe métamorpho[a lui- meme en
¡;hevre, ce qui le fit [llrnommer
agoceros.
ftGOLE THRON, plante décrite par Plinc. Il
parolt que c'eíl: celle que Tournefort a décrit [ous le
n.omde
clzamarododendros Pontica maxima mifPílifo-
110
,jlore lraeo.
Cette plante crolt dans la Colchide , & les abe!lles
fuc~nt
[a
fle.ur:mais le miel qu'elles en tirent rcnd
funeux ou lvres ceux 'lui en mangent comme il
arriva
a
l'armée des dix mille
a
l'appro;he de Tre-
..,EGO
bifonde, au rapport de Xenophon ; ces [oldatsayant
rnangé de ce miel, il leur prit un vomilfement &
une diarrhée [uivis de reveries, de Corte que les
moins malades relfembloient
a
des ivrognes ou
a
des furieux,
&
les autres
a
des moribonds: cepen–
dant per[onne n'en mourut, quoique la teIre parllt
jonchée de corps comme apres une bataille;
&
le
mal ceiTa le lendemain , environ
a
l'heure qu'il avoit
commencé ; de forte que les [oldats fe leverent le
troiíieme
&
le quatrieme jour, mais en l'état que
l'on
dI:
apres avoir pris une forte medecme. La
fleur de cet arbriifeau
dI:
comme celle du chevre–
feuille, mais bien plus forte, au rapport dn Pere
Lamberti , Miffionnaire Théatin.
M¿moires de l'Aca–
d¿mie Royale des Sciences
l:J04-
(N)
.. Voici les caraél:eres de cette plante. Elle s'éleve
a
cinq ou íix piés: fon tronc eíl: accompagné de plu–
fieurs tiges menues, divi[ées en branches inégales ,
foíbles
&
caiTantes , blanches en dedans , couvertes
d'une écorce grifiltre
&
liife, excepté
a
leurs extré–
mités
011
elles [ont velues. Elles portent des touffes
de feuilles 'aiTez [emblables a celles du néflier des
bois. Ces feuilles [ont longues de quatre pouces,
[ur un pouce
&
demi de largeur vers le milieu,
aigues par les eleux bouts, mais [ur-tout par celui
d'embas, de cOllleur verd gai,
&
légerement velues,
excepté fur les bords Oll leurs poils forment une e[–
pece ele fourcil . Elles ont la cote aiTez forte,
&
cette
cote [e diftribue en nervures fur toute lem [urface.
Elle n'eíl: Cju'un prolongernent de la queue des feuil–
les ,.qui n'a le plus [ouvent que trois
au
quatre li–
gnes de longueur [m une ligne d'épaiifeur. Les flems
nai1[ent rafiemblées au nombre de dix-huit ou vingt.
Elles forment des bouquets
a
l'extrémité des bran–
ches, OU elles [ont fOlltenues par des pédicules d'un
pouce de long, velus,
&
naiiTans des aiiTelles de
petites feuilles membraneufe , blanchatres, lon–
gues de [ept a huit lignes fur trois de large. Chaque
fleur eíl: un tube ele denx lignes & demie de dia–
metre , légerelIlcnt canelé , velu, jalille, tirant [ur
le verd. Il s'éva1e au-dela d'till ponce de diametre ,
&
fe divife en cinq portions dont celle du milieu a
plus el'nn pouce de long
1i.rrpre[qu'autant de lar–
geur : elle eH reflenrie en arriere ainfi que les au–
tres,
&
terminée en arcade gothique. Sa couIeur
eíl: le jaune pille, doré veIS le milieu; les autres '
portioJls font plus étroites
&
plus courtes, mais
pareillement jaunes pales. La fleur entiere eíl: ou·
verte par elerriere,
&
s'articule avec un piíl:il py–
ramidal, cannelé, long de deux lignes , verd blan–
charre, légerement velu, garrn d'un filet courbe,
long de deux pouces,
&
terminé par
1m
bouton
verd paleo Des environs de l'ouvertJrre de la fletrr
[ortent cinc¡ étamines plus courtes que le piíl:il,
inégales, courbes, chargées de fommets longs d'une
ligne
&
demie,
&
chargés d'une pouíliere jauml–
treo Les étamines [ont auffi de cette couleur : elles
font velues depnis leur origine ju[ques vers leur mi–
líeu,
&
toutes
les
fleurs [ont inclinées comme cel–
les de la fraxinelle. Le piíl:il devient dans la [uite
un fruit d'environ quinze lignes de long, [ur íix on
fept líanes de diameo·e. Il eíl: relevé de cinq cotés ,
dur,
bnm
&
poinru.Ils'ouvre de I'une a l'autre ex–
trémité en [ept ou huit endroits creufés en gQuttic–
res; ces goutieres vont fe termine:,fur un axe qui
trave¡{e le fruit dont il occupe le l111heu ; cet axe ea
cannelé ,
&
di.íl:ribue l'intérieur eln futit en at\tant
de loges qn'il y a de gouttieres
¡\
l'extérie;lr:
C'eíl: ainfi que M. Tournefort caraél:enfe ceHe
plante, dOlít les Anciens ont connu les propriétés
dangereu[es.
*
ftGOPHAGE, (
Myth.
)
Junon fut ainfi fur–
nommée des chevres qu'on lui facrifioit.
...EGYPTE.
Voye{
EGYPTE.
















