
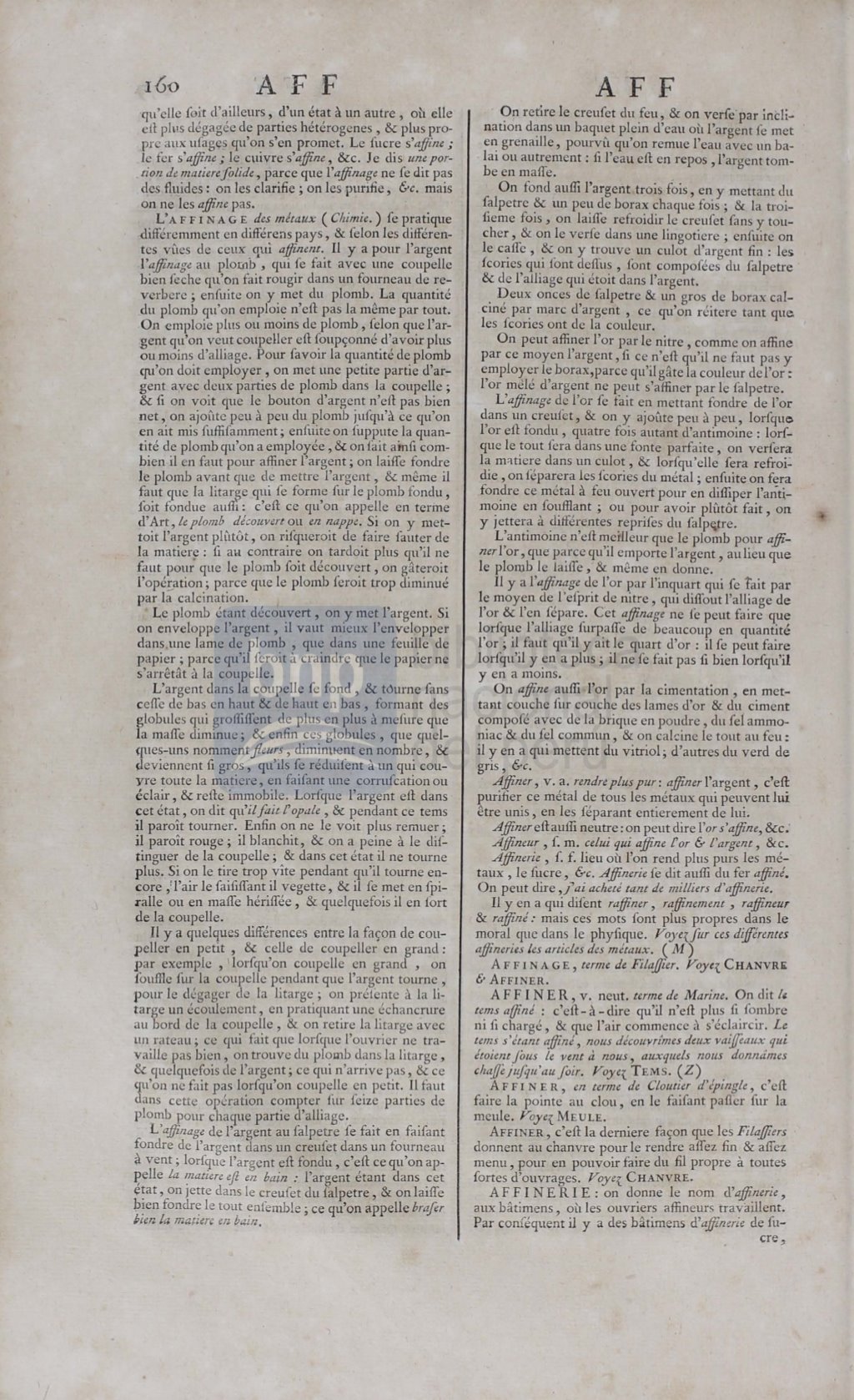
lOO
AFF
qLI'elle feied'ailleurs, d'un état
a
un autre, on elle
eH pl¡ts dégagée de parties hétérogenes , & plu.s pro–
pr allx ufages qu'on s'en prometo Le fuere
s'affine;
le
[er
s'affine;
le cuivre
s'affine,
&c. Je dis
une por–
non de matierefolide,
paree qLle
l'affinage
ne fe dit pas
des fluides : on les clarifie ; on les purifie,
&c.
mais
on ne les
affine
pas.
.
L'
A
FFIN
A G
E
des métaux
(
Cftimie. )
fe pratique
<lifféremment en différens pays,
&
felon les différen–
tes vlles de ceux
qui
afftnent.
II
y a pour l'argent
l'affJ.l2age
au plomb> qui fe [ait avee une coupelle
bien feche qll'on fait rougir dans lm fourneau de re–
verbere; enfuiee on y met du plomb. La quantité
du plomb qu'on emploie n'eíl: pas la mt!me par tout.
On emploie plus ou moins de plomb, felon quel'ar–
gent qu'on veut coupeller eíl: foupc;:onné d'avoir plus
ou moins d'alliage. Pour favoir la quantité de plomb
'11.1'on doie employer , on met une petite partie d'ar–
gent avee deux parties de plomb dans la coupelle;
& íi on voit qlle le bOllton d'argent n'eíl: pas bien
net, on ajolite peu
a
pell du plomb jufqu'a ce qu'on
en ait mis fuffifamment; enfuite on fuppute la quan–
tité de plornb qu'on a employée >& on úlÍt ainíi com–
bien il en faut pOllr affiner l'argent ; on laiífe fondre
le plomb avant que de mettre l'argent, & mt!me il
faut que la litarge qui fe forme fur le plomb fondu ,
foit fondue auffi: c'eíl: ce c¡u'on appelle en terrne
d'Art,
leplomb découvert
ou
en nappe.
Si on y met–
toit l'argent plutat, on ri{qLleroit de faire fauter de
la matiere :
fi
aH contraire on tardoit plus qll'i! ne
faut pour que le plomb foit découvert , on gaeeroie
l'opéry.tion.;
p~rce
c¡ue le plomb feroit trop eLiminué
par la calc111at1On.
Le plomb étant découvert, on y met l'argent. Si
on enveIoppe l'argent, il vaut mieux l'envelopper
dans.une lame de plomb , que dans une feuille de
papier ; paree qLI'il feroit
it
craindre que le papier ne
s'arretat
a
la coupelle.
L'argent dans la coupelle fe fond, &
t~urne
fans
ceífe de bas en haut & de haut en bas, formant des
globules c¡ui groffiífent de plus en plus
a
merme que
la rnaífe diminue; & enfin ces globules, qLle qLlel–
qlles-uns
nornmentJleurs,
eLirninuent en nombre, &
deviennent íi gros, c¡n'ils fe rédui{ent a un qui cou–
yre toute la matiere, en faifant une corrufcation ou
édair, & reíl:e immobile. Lorfc¡ue I'argent eíl: dans
cet état, on dit
qu'ilfait l'opale
,
&
pendant ce tems
il parolt tourner. Enfin on ne le voit plus remucr ;
il parolt rouge; il blanchit, & on a peine
¡'¡
le di!:'
tinguer de la coupelle;
&
dans cet état il ne tourne
plus. Si on le tire trop VIte pendant qu'il tourne en–
core ,'l'air le failiífant il vegette, & il fe met en fpi–
ralle ou en maífe hériífée,
&
quelqLlefois il en 10rt
de la coupelle.
Il ya quelques différences entre la fac;:on de cou–
peller en petit , & celle de coupeller en grand:
par exemple , Ilorfqu'on coupelle en grand > on
foume fur la conpelle pendant quc l'argent tourne ,
pour le dégager de la litarge; on prétente
a
la li–
targe un écoulement, en pratiqllant une échancnrre
au bord dc la coupelle ,
&
on retire la litarge avec
un rateau ; ce qui fait cJ1le lorfque I'ouvrier ne tra–
vaiUe pas bien, on trouve du plolllb dans la litarge>
&
quelqLlefois de l'argent; ce qui n'arrive pas, & ce
<lu'on ne fait pas lorfqu'on coupelle en perito Il faut
dans cette opération compter fur feize parries de
plomb pour chaque partie d'alliage.
L'affinag¿
de l'argent au falpetre fe fait en [aifant
fondre de I'argent dans un creufet dans un fourneau
a
vent; lonque l'argent efr fondu, c'eli cequ'on ap–
~elle
la
~llatiere
ejl
en
bain
:
l'argent étant dans .cet
e~at,
on ¡ette dans le creu{et du {alpetre ,
&
on 13..lífe
b~en fondr~
le tout enlemhle; ce qu'on appelle
braJer
he¡¡
14 maflere
m
bam.
AFF
On rerire le creufet du feu,
&
on verfe par incli–
nation dans
un
baquet plein d'eau
o~ll'argent
fe met
en grenaille, pourvll qu'on remue l'eau avec un ba–
lai 011 autrernent :
fi
l'eau eíl: en repos ,I'argent tom–
be en maífe.
On fond auffi I'argent trois fois, en y mettant du
falpetre & un peu de borax chaque [ois;
&
la troi–
íieme fois > on laiífe refroieLir le creuret fans y tou–
cher,
&
on le verfe dans une lingotiere ; enfuite on
le cafre, & on y trouve un culot d'argent fin : les
{cories qui font deífus , font compofées du falpetre
& de l'a1liage qui étoit dans I'argent.
Deux onces de falpetre
&
un gros de borax cal–
ciné par marc d'argent , ce qu'on réitere tant que
les fcories ont de la coulem.
On peut affiner I'or par le nitre, eomme on affine
par ce moyen l'argent,
íi
ce n'eíl: qu'il ne faut pas y
employer le borax,parce qu'il gate la couleur del'or :
l'or melé d'argent !le peut s'affiner par le falpetre.
L'affinage
de l'or fe fait en mettant fondre de l'or
dans un creufct,
&
on
y
ajot'¡re pen
a
peu, lor{quo
l'or efr fondu, quatre fois autant d'antimoine : lorf–
que le tout fera dans une fonte parfaite, on verfera
la m'lticre dans un culot, & lorfqu'elle fera
refroi~
die, on leparera les fcories du métal ; enfuite on fera
fondre ce métal
¡'¡
feu ouvert pour en eLiffiper l'añti–
mome en foumant ; ou pom avoir plutat fait on
y jettera
a
différentes reprifes du falp<otre.
'
L'antimoine n'efr meilJeur que le plomb pour
affi–
nerl'or,
que parce qu'il emporte l'argent, aulieu que
le plomb le laiífe>
&
meme en donne.
n
y a
l'affinage
de l'or par l'inqLlart qui fe tait par
le moyen de l'e{prit de nitre, qLLÍ diífout l'alliage de
l'or & I'en fépare. Cet
affinage
ne
fe
peut faire que
lorfque l'alliage furpaífe de beaucoup en qLlantité
l'or; il faut qu'il y ait le quart d'or : il fe peut faire
lorfqu'il y en a plus;
il
ne fe fait pas íi bien lorfqu'il
yen a moins.
On
affine
auffi I'or par la cimentation , en met–
tant couche
{ur
couche des lames d'or
&
du ciment
compo{é avee de la brique en poudre , du fel ammo–
niac
&
du [el commun,
&
on cakine le tout au feu:
il y en a qui mettent du vitriol; d'autres clu verd de
gris,
&c.
Affiner,
V.
a.
rendreplus pur: affiner
I'argent, e'efr
purifier ee métal de tous les métaux qui peuvent lui
etre unis , en les féparant entierement de lui.
Affinerefrauffi
neutre: on peutdire
l'or s'affine,
&c:
Affineur,
f.
m.
cebú
qui
affine l'or
&
l'argent,
&c.
Affinerie,
f. f. lieu on l'on rend plus purs les mé-
taux , le (ucre,
&c. Affinerie
fe eLit auffi du fer
affiné.
On peut dire
,.lai ac/¡eté tant de milliers d'affinerie.
Il y en a qui eLifent
raffiner, ra:ffinement
>
raffineur
&
raffiné:
mais ces mots font plus propres dans le
moral que dans le phylique.
Voye).../ilr ces différentes
affinerics les anicles des müaux.
(11{)
A FF
J
N
A G
E,
terme de Filaffier. Voye{
CHANVR¡¡
{/ AFFINER.
A
F FIN
E
R,
V.
neut.
terme de Marine.
On dit
ü
tems a(finé
:
c'efr-
a-
eLire qu'il n'eíl: plus
fi
fombre
ni
fi
chargé,
&
qLle l'air eornmence
a
s'édaircir.
Le
tems s'üant afliné, nous découYrlmes deux Yaijfealtx quí
élOient jous
le
yent
ti
nous, auxqllels nOllS donnames
clUlffejufqu'flufoir. Voye{
TEMS.
(Z)
AFFINER,
en terme de Clolltúr d'Jpingle,
c'eíl:
faire la pointe au dou, en le faifant pafier fur la
meule.
Voye{
MEULE.
AFFINER, c'eíl: la derniere fac;on que les
Filaffiers
donnent au cnanVl'e pom le rendre aífez fin
&
aífez
menu , pour en pouvoir faire du
fil
propre
it
toutes
fortes d'ouvrages.
Voye{
CHANVRE.
.
A
F FIN
E
R
1 E : on donne le nom d'
affinene ,
aux batimens,
o~lles
ouvriers affineurs rravaillent.
Par conféquent i1
y
a des batimens
d'affineric
de fu–
ere,
















