
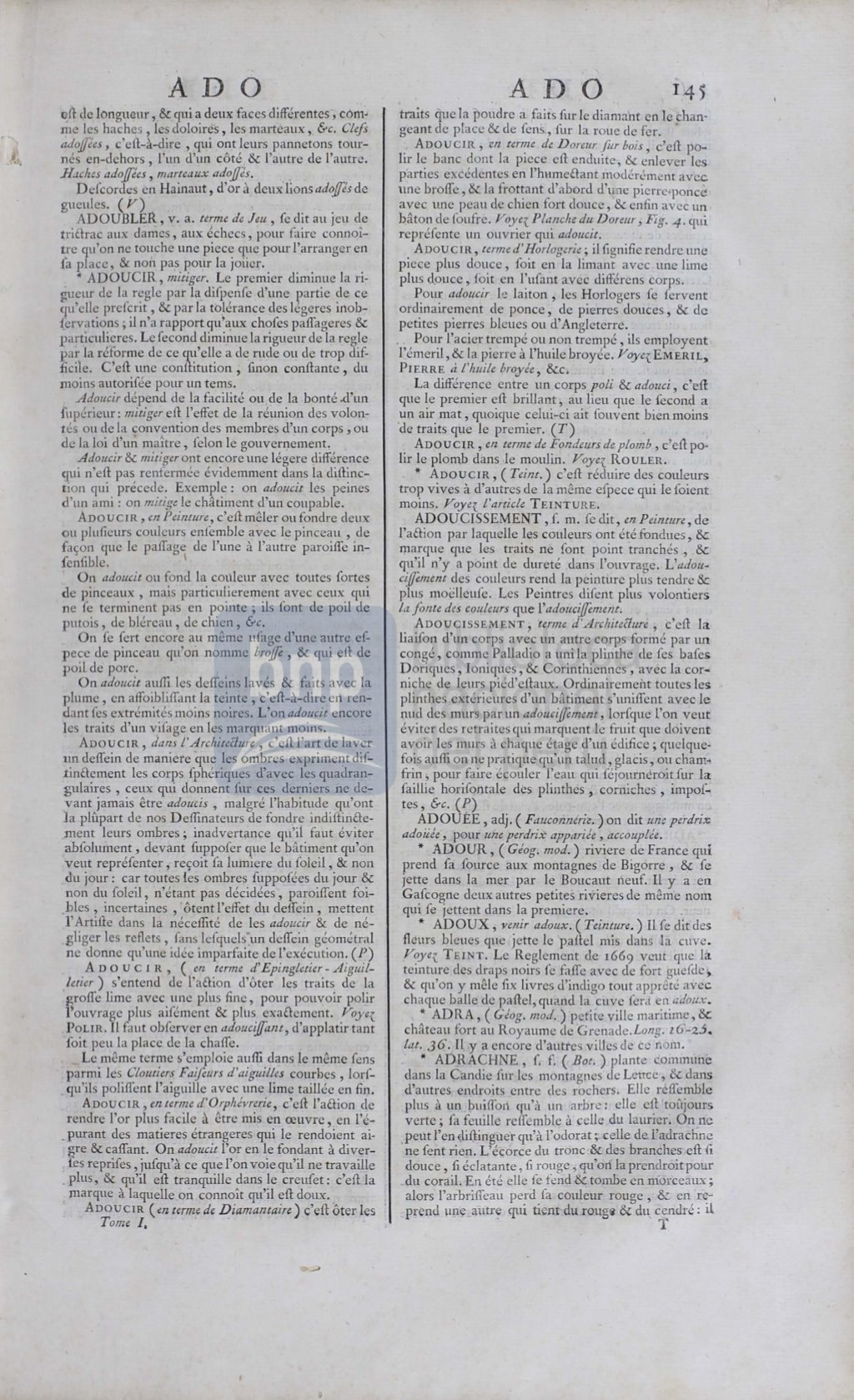
ADO
ell de longuaur ,
&
qni a deux faces différentes, cóm·
me les haches, les doloires , les malteaux,
&c. Clefs
adoffies,
c'ell-a-{Ere , qui ont leurs pannetons tour–
nes en-dehors , I'un d'un coté
&
I'autre de I'autrc.
HdcILes adoffies
,
marteaux adoffis.
Defcordes en Hainaut, d'or a deux lions
adoffis
de
gueules.
(Y)
ADOUBLER, v. a.
terme de Jsu,
(e dit au jeu de
triarac aux dames, aux échecs, pour faire conn01-
tre qu'on ne touche une piece que pow'l'arrangcr en
fa place,
&
non pas pour la joiier.
.. ADOUCIR,
mitiger.
Le premier diminue la ri–
gueur de la regle par la di(pen(e d'une partie de ce
</u'elle prefcrir ,
&
par la tolérance des legeres inob–
fervations; il n'a rapport qu
'a.uxcho(es paifageres
&
palticulieres. Le (econd diminue la rigueur de la regle
par la réforme de ce qu'elle a de rude ou de trop dif.
ficíle. C'ell une conllitution, finon conil:ante, du
nlOins autori(ée pour un tems.
Adoucir
dépend de la facilité ou de la bonté .d'un
1upérieur:
mitiger
ell l'effet de la réunion des volon–
tés ou de la convention des membres d'tm corps , ou
de la loi d'un maitre, ieton le gouvernement.
Adoucir
&
mitiger
ont encore une légere différence
c¡ui n'ell pas rentt:lmee évidemment dans la diilinc–
tion qui précede. Exemple: on
adoucit
les peines
el'un ami: on
mitige
le chittiment d'un coupable.
ADOUCIR,
enPeúuure,
c'ellmeler oufondre deux
ou plufieurs couleurs en[emble avec le pinceau , de
fa<;on que le paifage de I'une
a
I'alme paroiíre in–
fenfible.
On
adortcit
ou fond la coüleur avec toutes (ortes
de pinceaux , mais particulierement avec ceux qui
ne fe terminent pas en pointe ; ils font de poil de
putois, de bléreau, de chien,
&c.
On fe (ert encore au meme u(age d'une autre ef–
pece de pinceau qu'on nomme
brOffi
,
&
qui ell de
poil de porc.
On
adoucit
auffi les deifeins lavés
&
fairs avec la
plume, en affoibliífant la teinte , c'ell-a-dire en ren–
dant [es extrémités moins noires. L'on
adoucit
encore
les traits d'un vifage en les marquant moins.
AOOUCIR,
dans l'Arclziteaure
,
c'e1l1'art de laver
un deifein de maniere que les ombres
exprimentdif~
tinaement les corps (phériclues d'avec les quadran–
gulaires , ceux qui donnent fm ces derniers ne de–
vant jamais etre
adorteis
,
malgré l'habitude qu'ont
la plupart de nos De/Jinateurs de fondre indiilinae–
ment leurs ombres; inadvert¡ll1ce qu'¡[ faut éviter
ab(olument, devant (uppo(er que le bittiment qu'on
veut repré(enter , re<;oit (a lullliere du (oleil ,
&
non
du jour: car toutes les ombres fuppo(ées du jour
&
non du foleil, n'étant pas décidées, paroiífent foi–
bIes, incertaines , otentl'effet du deifein, mettent
l'
Artille dans la néceffité de les
adoucir
&
de né–
gliger les reflets, (ans lefquels\1l1 deifein géométral
ne donne qu'une idée imparfaite de I'exécution.
(P)
A
D
o
U C IR, (
tn
tmne d'Epingktier
-
Aiguil–
[elier)
s'entend de ¡'aaion d'oter les traits de la
j!;ro/fe lime avec une plus fine, pour pouvoir polir
I'ouvrage plus aifément
&
plus exaaement.
YoyS{
POLlR. Il faut obferver en
adouciffant,
d'applatir tant
foit peula place de la chaife.
Le meme terme s'emploie auffi dans le m&me (ens
parmi
les
Clowiers Faifeurs d'aiguilles
courbes , lorf–
qu'ils poliifent I'aiguille avec une lime taillée en nn.
ADouCIR,entermed'Orplzévrerie,
c'elll'aaion de
rendre I'or plus facile
~
etre mis en ceuvre, en I'é–
. purant des matieres étrangeres qui le rendoient ai–
gre
&
caifant. On
adoucit
I'or en le fondant a diver–
fes repriCes ,jufqu'a ce que I'on voie qu'i1 ne travaille
plus,
&
qu'i1 ell tranquille dans le creu(et: c'ellla
marque a laquelle on connolt q1.l'il ell dome.
AoouclR
(m ttrme de Diamantair.)
c'eí!: oter les
Tome
J.
ADO
traits que la poudre a faits (ur le diamaht en le chan'
geant de place
&
de (ens, Cur la roue de fer.
AOOUCIR,
en terme de D oreur fur bois
c'ell po–
lir le banc dont la piece eíl: enduite,
&
;nlever les
parties excédentes en l'humeaant modérément avec
une broife,
&
la frottant d'abord d'u e
pierre'ponc~
avec une peau de chien fort douce,
&
enfin avec un
haton de Coufre.
Yoye{ PLanche du Donur, Fig.
4-
qui
repré(ente un ouvrier qui
adoucit.
ADOUCIR,
terme d'Horlogerie
;
il íignifie rendre une
piece plus douce, [oit en la limant avec une lime
plus clpuce, {oit en I'u[ant avec di/férens corps.
Pour
adoucir
b
laiton , les Horlogers fe (ervent
ordinairement de ponce , de pierres douces,
&
de
petites pierres bleues ou d'Angleterre.
. Pour ['acier trempé ou non trempé, i1s employent
l'émeril,
&
la piene
a
['huile broyée.
Yoye{
EMERIL.
PIERRE
ti
['Imile bro;yée,
&c.
La différence entre un corps
poli
&
adollci,
c'eíl:
que le premier ell brillant, au lieu que le (econd
a
un air mat, quoique celui-ci ait COllvent bien moins
de traits que le premier.
(T)
ADOUCIR ,
en terme
d~
Fondeurs de plomb
,
c'ell po–
lir le plonw dans .le monlin.
Yoye{
ROULER.
... ADOUCIR,
(Teint.)
c'ell réduire des couIeurs
trop vives
a
d'autres de la meme e(pece qui le (oient
moins.
Yoye{ l'article
TEINTURE.
ADOUCISSEMENT
,f.
m. (e dit,
en Peinture,
de
I'aaion par laquelle les couleurs ont été fundues,
&
marque que les traits ne font point tranchés,
&
qu'il n'y a point de dureté dans l'ouvrage.
L'adou–
ciffoment
des couleurs rend la peinture plus tendre
&
plus moelleufe. Les Peintres di(ent plus volontiers
la follee des couleurs
que l'
adollcij{emeñl'
AOOUCISSEMENT
I
'terme d'Arclziteawe,
c'ell la
liaiCon d'un corps avec un autre corps formé par 1m
congé, comme Palladio a un! la plinthe de [es bafes
Doriques, Ioniques,
&
Corinthiennes, avec la cor–
niche de leurs piéd'ellaux. Ordinairement toutes les
plinthes extérieures d'un batiment s\miifent avec le
nud des murs parun
adoucij{ement,
lorfque l'on veut
éviter des retraitesqui marquent le fruit que doivent
avoir les murs achaque étage d'un édifice; quelque–
fois auffi on ne pratique <¡u'un talud, glacis, ou cham.
frin; pour faire écouler I'eau qui (éjonrneroit[ur la
(ailEe horifontale des plinthes , corniches, impo!:'
tes,
&c.
(I!)
ADOUEE, adj.
(Fauconneri~.)
on dit
une perdri:t
adoiiée,
pour
une perdri:t appariée, accouplée.
... ADOUR,
(Géog. mod.)
riviere de France qui
prend (a Cource aux montagnes de Bigone,
&
(e
jette dans la mer par le Boucaut neuf. Il y a en
Gafcogne dellx autres petites rivieres de meme nom
qui (e jettent dans la premiere.
... ADOUX,
venir adoux. (Teincure.)
Il (e dit des
fléurs bleues que jette le paitel mis dahs la cuve.
Yoye{
TEINT. Le Reglement de 1669 veut que lit
teinture des draps noirs (e faife avec de fort guefde ,
&
qu'on y mele
(IX
livres d'indigo tout appreté avec
chaque balle de paitel, quand la cuve (era en
adoux.
... ADRA, (
Géog. modo
)
petite viUe maritime,
&
chitteau fort au Royaume de
Grenade.Long.
z6-z.5.
lato
36..
Il Y a encore d'auítes villes de ce nomo
.
... ADRACHNE,
C.
f. (
Bot.
)
plante c.ommune
dans la Candie (ur les montagnes de Lerree,
&
dans
d'autres endroits entre des rochers. Elle refiemble
plus a un buiifon qu'a un arbre : elle eJ.l: tofljOurS
verte; (a fenille reifemble
a
celle du launer. On ne
peut1'en di1l:inguer qn'a l'odorat;.celle de l'adrachnc
ne fent rion. L'écorce du tronc
&
des branches ellii
douce, fi éclatante, íi rouge, qu'on la prcndroitpQUl"
du corail. En éré elle (e fend
&
tombe en morceaux;
alors l'arbrilreau perd [a couleur rouge,
&
en re–
prene! une autre qui tient du rougQ
&
du cendré:
il
l'
















