
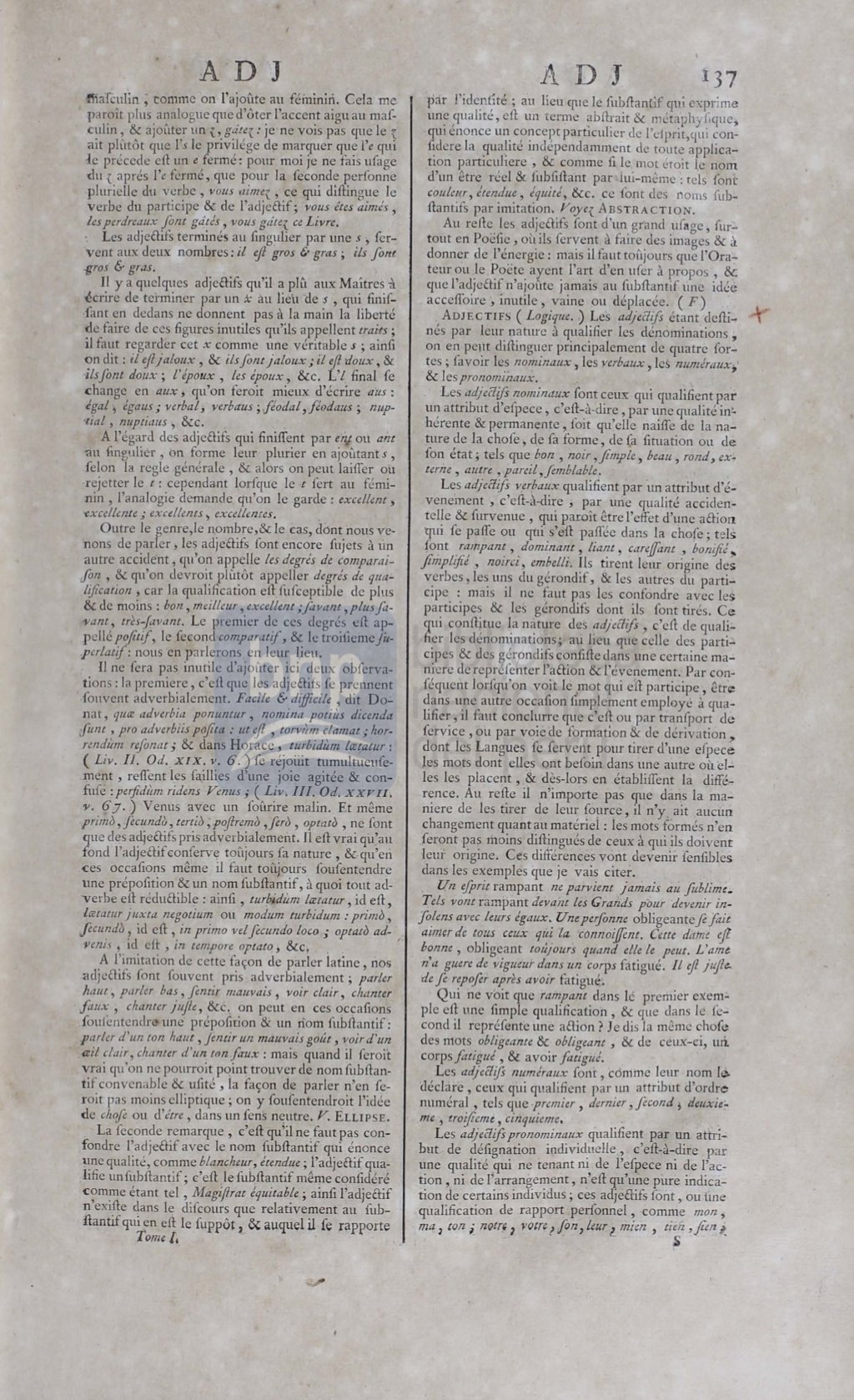
A D
J
:iiafculin ; comme on I'ajoftte au féininiñ. Cela me
parolt plus analogue ql1e d'oter l'accent aigu au maf–
cutin, & ajOtlter un {,
gate{
"
je ne vois pas que le {
ait pllhot que l's le privilége de marquer que l'e qui
le précede eft un
e
fermé: pour moi je ne fais uCage
¿u { aprés l'e fermé, que pour la feconde perfonne
plurielle du verbe ,
vous flime{
,
ce
qui
diftingue le
verbe du participe
&
de l'adjeB:if;
vous étes ainu!s ,
lesperdrea/IX 10m galés, vous gátez ee Livre.
Les adjeB:ifs terminés au frngulier par une
s
,
fer–
vent am.: deux nombres:
ii ifl gros
{}
gras; ds Jom
.gros
&
graso
Il ya quelques adjeB:ifs qu'il a pitI aux Maítres
a
écrire de terminer par un
x
áu lieh "de
s
,
qui finif–
fant en dedans ne donnent pas
a
la main la liberté
de faire de ces figures inutiles qu'ils appellent
traits ;
il faut regarder cet
x
comme une véritable
s
;
ainÍl
(Jn dit :
il ifljaltJllx
,
&
ds10m jaloux; il iflrioux,
&
¡lsJont doux; l'';poux, les époux,
&c. L'l final fe
change en
aw",
qu'on feroit mieux d'écrire
aus:
¿gal, égalls ; verbal, yerbtClls ; flodal, flodaus; nrp–
'tial
,
nllptialls
,
&c.
A
l'égard des adjeB:ifs qui finiífent par
en;
OU
ant
-au Ílngnliér, on forme leur plllrier en ajOtltants,
felon la regle générale , & alors on peut laiífer ou
rejetter le
t:
cependant lorfque le
t
fert au fémi–
nin , l'analogie demande qu'on le garde :
excellmt;
-exedlente; excellems
\
exeellemes.
Olltre le genre,le nombre,& le t:as, dónt nous
ve–
nons de parler, les adjeB:ifs font encore fujets a un
autre accident, qu'on appelle
les degrés de comparai–
fon
,
& qu'on devroit pllttot appeller
degrés de 'lua–
lifieatLOn,
cal' la qualification eíl: f\tfceptible de plus
&
de moins :
bon, m.illeur, exeellent;fovam ,plus
fa–
vam,
tr~s-javant.
Le premier de ces degrés eíl: ap–
pellé
pcifitif,
le [econd
eomparatif,
& le troiÍleme
ju–
perlatif:
nous en
parlerons.enleur lieu.
II
ne fera pas inlltile d'ajotlter ici deux obferva–
tions: la premiere , c'eíl: que les adjeB:ifs fe prennent
[ouvent adverbialement.
Facile
&
difficile
;
dit D o–
nat,
'lUIIl adverbia ponuntur, nomina
POti/ls
dieenda
¡um
,
pro adverbiis pojita
"
ue ifl
,
torvum clamat
;
hor–
Tendum refonae;
&
dans Horace,
eurbidum llIltatur
¡
(Liv. l1. Od.
XIX.
v.
6'1
fe réjoiüt tumulUleuCe–
roent , reífent les Caillies d'une joie agitée
&
con–
fllCe
:perjid/tm ridens Venus; (Liv.llI. Od.
XXVII.
$'.
6:J.
)
Venus avec un foíhire malin. Et meme
primo, jecundo, tmio ,pciflremo ,firo
,
optrte()
,
ne Cont
que des adjeB:ifs pris adverbialement. Jl eíl:vrai qll:an
fond l'adjefuf(wnCerve tOt1jOurS [a natme , & qu'en
ces occaÍlons meme il faut tOfLjOurS [oufentendre
une prépofition &
un
nom [ubíl:antif,
a
quoi tout ad–
verbe eH réduB:ible : ainfi ,
turbidum llIltatur,
id eíl:,
llIltalllr juxta negotium
ou
modum turbidum: primO.,
ficundo,
id eíl: ,
in primo ve!fieundo loco ; optato ad-
'Penis
!
id eíl: ,
in
lempore optato,
&c, .
'
A l'imitation de cette
fa~on
de parler latine, nos
adjeB:ifs fom fouvent pris adverbialement;
parler
haue, parler bas, fintir mauvais, yoir clair, ehaTller
faux, e!tanter juJle,
&c. on peut en ces occafions
[ou{entendre une prépofirion
&
un riom Cubftantif:
parLer d'un ton !tallt
,
jemir un mtiuvais góút
,
voir d'un
ail clair, chaTller d'un tM faux
:
mais quand il Ceroil:
vrai qu'on ne pourroit pqint trollver de nom fubftan–
tif convenable & uÍlté , la fas:on de parler n'en [e–
l'oit pas moins elliptique ; on y CouCentendroit l'idée
ce
c!tofe
ou d'/m, dans un fens n"utre.
V.
ELLIPSE.
La feconde remarque, c'eíl: qu'il ne.faut pas con–
fondre l'adjeébf avec le nom Cubíl:antif qui énonce
une qualité, comme
blanchtlt~,
étendue ;
l'adje€l:ifql1a–
litie unfubftantif; ,,'eft le Cubftantif
m~me
confidéré
comme étant tel ,
Magijlrat é'luitable
;
ainÍl l'adjeB:if
n'exifie dans le diCcours que relativement au Cub–
Rantifqlti en eíl: le Cuppot,
&
auquel
il
fe ,apporte
Tome 1,
A D
J
i37
par l'idenlÍté ; au !len que le Cubftanlif qui exprime
une 'lualité, eíl: un terme abíb-ait & métaph¡íique,
'lui énonce un.
C?~lcevt
particulier de l'e{prit,qui con–
.lidere la quahte 1l1dependamment de toute applica–
tion particuliere , & comme Íl le mot étoit le nom
d'un etre réel
&
íi.lbÍlíl:ant par lui-meme: tels foní:
eouleur, étendue, é'l/úd,
&c. ce font des noms Cub–
ftantifs par imitatioll,
Yoye{
ABSTRACTION.
An relle les adjeB:ifs Cont d'un grand ufllge, Cur–
tout en PoeÍle ,
Ol!
ils Cervent
a
faire des images
&
a
donner de l'énergíe: mais il faut totljOurS que l'Ora–
teur ou le Poete arent l'art d'en ufer a propos ,
&
que l'adjcB:if n'ajoute jamais au [ubHantif une idée
acceífoire, inutile, vaine on déplacée.
(F)
.
~
ADJECTIFS
(Logique.
)
Les
adjeélifs
étant deíl:i- \
nés par leur natme a qualitier les dénominations>
on en pellt diftinguer principalement de 'luatre
Cor–
tes; Cavoir les
nomina/lX
l
les
yerbaux
,les
Tlltméraux,'
&
lesprolLOminaux.
Les
adjeélifS nominaux
font ceux qui qualifient par
un attribut d'efpece, c'eíl:-a-clire, par une ql.lalité in!.
hérente
&
permanente, foit Cj11'elle naiífe de la na–
ture de la choCe, de fa forme, de (a Ílu1atíon ou de
[on état; tels que
bon, noir ,jimple) beau, rond, ex–
terne , autre ,pareil ,fimblable.
Les
adjeélifs verbaux
Cj11alifient par un attribut d'é–
venement , c'eíl:-a-clire, par une qualité acciden–
telle & furvenue , Cj1lÍ paro1t etre l'effet d'une aB:ion
tlui fe paífe
OH
qtü s'eíl: paífée dans la choCe; tels
font
rampant, dominant, !iant, ear1fam
,
bonifi¡
~
jimplifié
~
noirá, embelli,
Ils tirent leur origine des
vcrbes, les 11ns dll gérondif,
&
les alltres du parti–
cipe : mais
il
ne faut pas les confondre avec les
participes
&
les géronclifs dont jls Cont tirés. Ce
'lui conHitue la miture des
adjeélifs
,
c'eH de qllali–
fier les dénominations; au lieu que celle des parti–
cipes
&
des gérpndifs conÍlíl:e dans une certaine ma–
niere de repré[ehter l'aB:ion & l'évenement. Par con–
féquent lorCCj11'on voit le ,mot Cj1ti e11: participe, etre:
dans une autre occaÍlon Ílmplement employé
a
qua–
lifier, il faut conclun-e que c'eíl: ou par tranCport de
(ervice ,ou par voiede formabon
&
de dérivation
~
dont les Langues fe Cervent pour tirer d'une efpece
les mots dont elles Qnt be[oin dans une autre Ott'el–
les les placent,
&
des-lors en établiífent la diffé–
rence. Au reíl:e il n'importe pas que dans la ma–
niere de les tirer de leur
CO~lrce,
iI
n'y. ait aucun
changement quant au matériel : les mots fórmés n'en
feront pas moins diftingu6s de ceux
a
qui ils doivent
lem origine. Ces différences vont devenir Cenftbles
dans les exemples que je vais citer.
Un efprit
rampant
ne parvient jamais au fuhlime_
Tels vont
rampant
devant les Gral/ds pour devenir in–
Jolens
O1'te
leurs égaux. Une perflmne
obligeantefi
foit
ainier de tous eettx 'lui la eonnoif{ent. Cute dalne
ejl
bonne
,
obligeant
to/t)ours 'luand elle
le
peut. L'amt
n'a guere de viglteut dans un eorps
fatigué.
IL
ejl
juJle.
de fi repofir apres avoir
fatigué~
Qui ne voit que
rampane
dans lé premier exem–
pie eH une Ílmple qualification, & que dans le Ce–
cond
iI
repréCente une aB:ion? Je dis la meme chofe
des mots
obligeante
&
obligeant
,
& de ceux-c;:i,
U/l.
corps
fotigué
,
&
avoir
fatigué.
Les
adjeélifs nUlTléraltx
font , cóniine leur nom le.
déclare , ceux Cj1li qualiJient par lUl attribut d'ordre
numéral , tels que
.premier
,
demier, ficond
;
deuxie~
me
,
troifieme, ein'luieme.
.
.
Les
adjeélifspronominaux
c¡ualifient par un afui–
but de déÍlgnation individuelle, c'eft-a-dire par
une qualité qui ne tenant ni de l'efpece ni de I'ac–
t~on
, ni de
1'.arr~
ng.eJ?lent,n'eíl: <J:u'
u.nepure inclica–
hon de certarns ¡ndlVldus ; ces adjeébfs font , ou une
Cj1lalification de rapport perConnel, comme
lTlon,
ma,
tOIl
i
¡¡otr.~
1
1'otre?
fln, lmr
l..
mim
,
cien, jim
1..
.
.s
















