
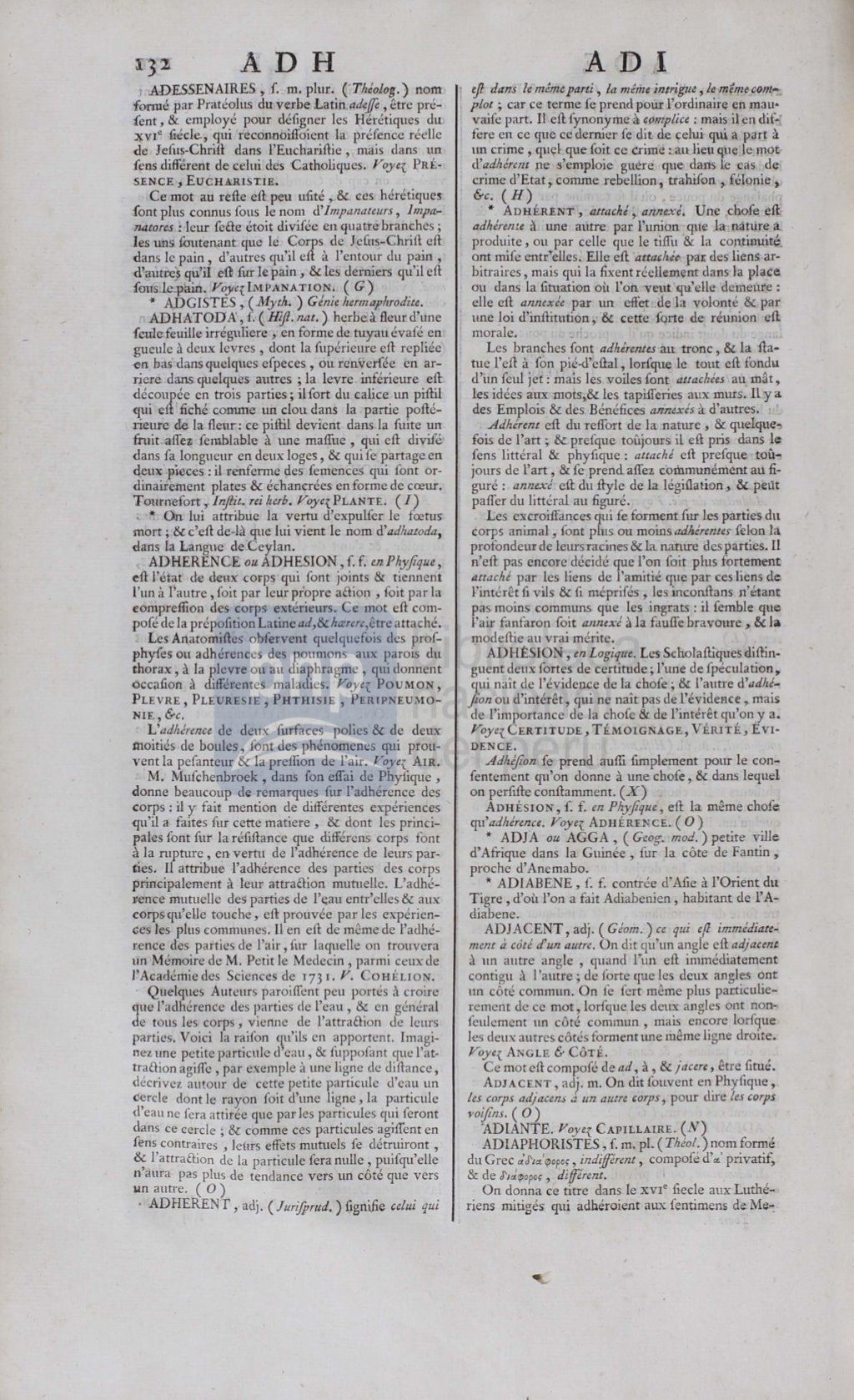
ADH
ADESSENAIRES, f. ro. plur.
(Théolog.)
noro
formé par Pratéolus du verbe Latin
atÚffi
,
erre pré–
{ent,
&
eroployé pour déligner les Bérétiques du.
~Vle
fiéde., qui reconnoiífoient la préfence réeIle
ele
Jefi.ls-Chrift dans l'Ellcharifrie, mais dans
lll1
feos difféIent de cehri des Catholic¡ues.
Voye{
PRÉ–
SENCE, EUCHARIS1:IE.
Ce mot au refl:e eitpeu llúté,. & ces
hérétique~
font plus connus fous le nom
d'Impanateurs,
lmp~
MtorM
:
leur feél:e étoit divifée en quatre branches;
les
l.lnS
wutenant que le Corps de Jc(ns-Chria efr
elans le pain, d'autres c¡u'il efr
a
l'entour du pain ,
d'autres
qu'ir
eíb
fur le
pain,
& les demiers qu'il efr
fOl1Sle..pain.
Voye{LMPANATION.
e
G)
*
ADGISTES,
(MytA.
)
G/fue hermaplzrodite.
ADHATODA:,
f.
e
H'.fl. nat.)
herbe.afleurd'une
feulefeuille irrégl.11iere , en forme de tu.yauéva(é en
gueule
a
deux levres , dont la fupérieure efr repliée
-en banlans quelques e(peces , ou renverfée en ar–
r)
e.redans CfueIques autres ; la levre inférieure e/l:
elécollpée en rrois parries; il fort du calice un pillil
<111i efr fiché conune
un
don dans la partie pofré–
rieute
eLe
la fleur: ce pillil devient dans la (uite un
fulÍt aífez femblable
a
tille maiTue , qui efr divifé
dans fa longueur en deux loges , & qui fe partage en
c\.eux pieces : il renferme des femences
qui
font or–
dinairement plates & écbancrées en forme de cceur.
Tournefort,
Inftit. rei
hubo
Voye{
PLANTE.
el)
, *
On
lui atrribue la vertu d'expulfer le fretus
mort; & c'ell: de-la que lui vient le noro
d'adhatoda,
dans la Langue de Ceylan.
ADHERENCE ouADHESlON, f. f.
cnPhyjique,
efl:
I'éiat de deux corps qui font joints
&
tiennent
l'un
a
I'autre ,foit par leur piopre aél:ion , foit par la
eornpreffion des corps ellltérieurs. Ce mot efl: corn–
pofé de laprépolitionLatine
ad,
&
hlum,
erre attaché.
Les Anatomiftes ob(ervent quelquefois des prof–
phyfes ou adhérences des poumons aux parois du
tborax,
a
la plevIe Ol! au diaphragme , qllÍ donnent
occaúon
a
différentes maladies.
Voye{
POUMON,
PLEVRE, PLEURESIE , PHTHlSIE , PER1PNEUMO–
"NIF.,
&c.
L'adlúrence
de deux furfaces polies
&
de deme
tnoitiés de boules, font des phénomenes qui prou–
vent la pe(anteur
&
la preffion de I'air.
Voy'{
AIR.
M. Mufchenbroek, dans fon eiTai de Phylique ,
donne beaucoup de remarques fur l'adhércnce des
corps : il y fait mention de différentes expériences
qu'il a faites fur cette matiere , & dont les princi–
pales font fur la réfúlance que différcns corps fom
a
la mpture , en vertu de I'adhérence de leurs par–
cies.
Il
attribu0 I'adhérence des parties des corps
prrncipalement
a
leur attraél:ion mutuelle. L'adhé–
I'ence mutuelle des parties de l'<,;au entr'elles & aux
corps qu'elle touche, eíl: prouvée par les expérien–
Ges les plus communes.
Il
en ell: de rn&me de I'adhé–
rence des parties de I'air , fur laquelle on trouvera
un Mémoire de M. Petit le Medecin, parmi ceuxde
l'
Académie des Sciences de 173
I.
V.
COHÉLION.
Quel<Iues Auteurs paroiífent peu portés
a
croire
que l'adhérence des parties de I'eau , & en général
de tous les corps, vienne de l'attraél:ion de leurs
parties. Voici la raifon c\u'ils en apportent. Imagi–
nez tille petite particule d eau ,
&
fuppofant que I'at–
traél:ion agiífe , par exemple
a
une ligne de diaance,
décrivez alltour de cette petite particule d'eau un
<lercle dont le rayon foit d'une ligne, la particule
d'eau ne fera attirée que par les particules c¡ui feront
dans ce cercle ;
&
comme ces particules agjífent en
fens contraires , lehrs effets munlels fe détruiront ,
&
l'attraél:ion de la partieule fera nulle, puifqu'elle
n'aura pas plus de tendance vers un coté que vers
un aun·e.
(O)
. ADHERENT, adj.
(Jurifpmd.
)
lign\lie
celui qui
ADl
, ejl
dans le memeparti, la m'me iT1tpigue
,
le mef(l6com–
plot
;
car ce terrne [e prend pour l'ordinaire en mau·
valle
parto
Il
eft fynonyrne
a
complie,
:
mais il en dif··
fere en ce que ce demier fe dit de ceIui qtu a part
a.
un erime , qud que[oit ce crlme : au lieu que le mot
d'adhérem
ne s'emploie guere que dads le cas de
crime d'Etat,. corome rebellion, traMon , félonie ,
&c.
eH)
*
ADHÉRENT,
attaehé, an./l,xé.
Une chofe eO:
adhéreme
a
une autre par l'uníQn que
la-
náture
á
produite, ou par celle que le tiiTu
&
la cOntimlité
om
mife entr'elles. Elle efl:
atta",ée-
pati
des liens ar–
bitraires, mais qui la nxent réellement dans la plata
ou dans la útna1Íoo oh 1'0n vent qu'elle demeute:
elle
ea
annexée
par
un
effet
de
la
volonté & par
une loi d'inll:itution,
&
cette farte de réunion eíl:
morale.
Les branches font
adherentes
an
trone, & la íl:a–
tue l'efl:
a
fon pié-d'efral, lorfqtte le tout eft fondu
d'un [eul jet: rnais les voiles font
altachées
au mat,
les idées at1X IDOts,& les tapüferies aux murs.
n
y
a
des Emplois & des Bénéfices
annexés
a
d'autres.
Adhérent
efl: du reiTort de la nature ,
&
quelque~
fois de l'art ;
&
prefque tOU}ours il eft pris dans
l~
fens littéral
&
phyíique:
auaclzi
ell: pre(qtle
tou~
jours de
l'art,
&
fe prendaífez comrnunément au
fi–
guré:
annex¿
efr du fl:yle de
la
légiílation, & peút
paífer du littéral au figuré.
Les excroiffimces q!li fe fonnent fur les partiesdl1
corps animal, font pLus en rnoios
a4.htrente,
felon la
profondeur de leursraeines &
la
nanlre des
parties.lln'eíl: pas encore décidé que l'on Coit plus fortement
attaché
par les liens de l'amitié qtle par ces liens de
I'intéret
fi
vils
&
ft
méprifés , les mconfians n'étaut
pas moios cororouns que les irtgrats : il [emble que
l'air fanfaron foit
anmxé
a
la faulfe bravoure ,
&
la
modefl:ie au VTai mérite.
ADHÉSION,
en
Logique.
Les Scholailiques
diflin.
guent deux fortes de certitnde; l'une de fpéculation
~
'{tlÍ nalt de l'évideoce de la chofe; & I'autre
d'adhé–
pon
ou d'intéret, qui ne nait pas de l'évidence '" roais
de l'importance de la chofe
&
de
l'intéret qtl'on ya.
Voye{CERTITUDE, TÉMOIGNAGE, VÉRJTÉ, ÉVI'
DE CE.
Adhijion
fe pTend auffi fimpleroeot pour le con–
(entement qu'on donne
a
une chofe, & dans lequel
on perfúte coníl:amment.
e
X)
ADHÉSION,
f.
f.
en P/¡yfique,
dI:
la meme chofe
CJu'adMrtnce. Voye{
ADHÉRENCE.
e
O)
.. ADJA
ou
AGGA
,
e
Geog. mod.)
petite ville
d'Afriqtle dans la Guinée, fur la cote de Fantin,
proche d'Anemabo.
*
ADIABENE,
f.
f. contrée d'Aíie
a
l'Orient du
Tigre, d'oh ron a fait Adiaberuen , habirant de l'A–
diabene.
ADJACENT, adj.
e
Géorn. ) ce qui
efl
immédiate–
mmt
a
cóté
d'Ufl
alttre.
On dit qu'un angre efr
adjacent
a
un autre angle , quand l'un efr immédiatement
contigu
a
I
'autre ; de forte que les deux angles ont
lln coté cornmun. On te fert meme plus paniculie–
rement de ce mot, lorfque les deux angles ont non–
(culernent un coté commun, mais enCOTe lorfque
les deux amres cotés forment tme meme ligne droite.
Voye{
ANGLE
&
CoTÉ.
Ce mot ea compofé de
ad,
a,
&
jacere,
etre
[¡tué.
ADJACENT , adj. m. On dit [Ollvent en Phylique,
les corps adjacens
a
un aulTt eorps,
pour dire
les eorps
yoijins.
e
O)
i\DIANTE.
Poye{
CAPILLAIRE.
\N)
ADIAPHORISTES, f. m. pI.
(Theol.)
nom formé
dll Crec
';J'Ia.'C¡¡Dp.~,
indijferent,
compofé d'
a.'
privarif,
&
de
J'/(lC¡¡Dpo~ ,
différcnt.
'
On donna ce titre dans le XVI· lieele aux Luthé–
riens rnitigés qtü adhéraient aux fentimens de Me-:
















