
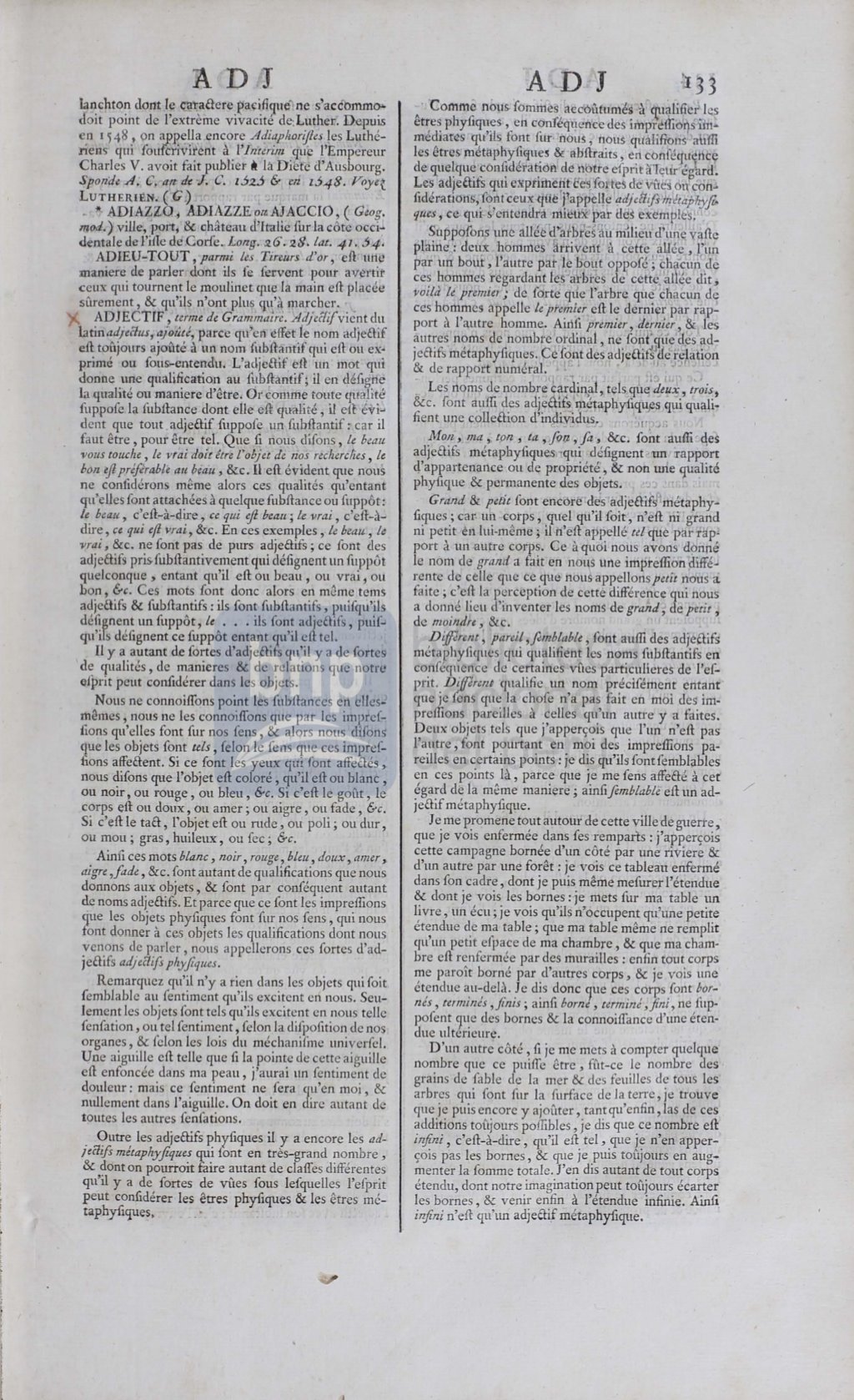
ADJ
lanchton dont le <¿araélere
I?aeif!qlle~
ne s'aec'bmmo>–
doit point de I'extreme vivacité de:l.urhet. De.puis
en
1
548 ,
on appella encare
Adiaphorijles
les I,.uthé–
ríen, qui {oufáiviteht
a
l'
[nterim
que l'Empereur
Charles V. avoit fait publier
1\
la Diete d'Ausbourg.
Spon"de
A. C.
an
tú.
-J.
C.
z.5.zj&
en
z.548. Vóyet
LUTHERIEN. (
G)
• 1'.
ADIAZZ.O
j
IDIAZZE
~mAJACCIO,
(
Geog.
mod.)
ville, port,
&
ohatean d'Italie fur la cote oeci..
dentaledel'illede Corfe"
Lorzg. !iG.2.8.
Lat.
4, .
.54-
ADIEU-TQUT,
parmi
Les
Tinurs d'or,
ell une
maniere de parler dont ils [e fervant pour avettit
ceux qui tournent le moulinet que la main eft plaGée
surement,
&
qu'íls n'ont plus qu'a marcber.
ADJECTIF,
lerme de Grammaire. Adjeéfif
viént dn
latinadjeélus, ajoúté,
paree qn'en éffet
le
nom adieétif
e1t
toujours
ajo-w.téa
un
nom fubil:antif qui eft ou ex–
primé ou [ous-entendu. L'adjeaif
eft
un mot qui
donne une qualification au [ubtl:antif; il en défigne
la qualité 011 maniere
d'~tre.
01'
camme
toute qlfa.1ité
(uppoCe la [ubil:ance dont elle
el1
qll'alité ,
il
en éViJ
dent que tout adjeaif [uppoCe un Cubftantif: car il
faut etre , pour etre tel. Que ti nous difons,
Le
beau
1'OIlS cOliche,
Le
vrai doit étre ¿'obja de nos recherclies,
Le
bón
efl
prtferabJe all benll
,
&c.
U
eíl évident que nous
ne confidérons meme alors ces qualités qu'entant
qu'elles Cont attachées a quelque [ubfl:ance ou [uppot:
lo
heall,
c'eft-a-4ire,
ce 'llli
efl
benll;
le
vrai
,
c'eft-a–
dire,
ce
'lui
efi
vrai,
&c. En ces exemples ,
Le
beal¿,
Le
1'rai,
&c. ne [ont pas de purs adjeétifs; ce {ont des
adjeélifs pris[ubftantivement qui défignent un [uppot
quelconqlle, entant qu'il eft ou beau , ou vrai, ou
hon,
&c.
Ces mots [ont donc alors en meme tems
adjeélifs
&
[ubftantifs: ils [ont [ubfl:antifs , pui[qu'ils
défignent un [uppot,
Le
•• •
ils [ont adjeétifs, puiC.;
qu'ifs détignent ce [uppot entant qu'il
ea
tel.
I!
ya autant de [ortes d'adje.élifs qu'il
y
a de [orte9
de qualités, de manieres
&
de relations que notre
o[prit peut confidérer dans les objets.
Nous ne connoi{[ons point les Cubil:ances en elles..:
memes, nous ne les connoi{[ons que par les impref–
fions qu'elles font [ur nos [ens, & alors nous dlCon5
<lue les objets [ont
le/S,
{elon le [ens que ces impreC–
fions affeétent. Si ce [ont les yeux qui (ont affeétés,
nous di[ons que I'objet
ea
coloré, qu'il eft ou blanc ,
ou noir, ou rouge, ou bleu,
&c.
Si c'ea le gOllt, le
corps ea on doux, on amer; ou aigre , on fade,
&c.
Si c'eí!: le taét, I'obiet eft ou mde, ou poli; ou dur,
ou mou; gras, huileme, ou fec;
&c.
Ainfi ces mots
bLane, noir, rouge, bLeu, doux, amer,
aigre ,fade,
&c. Cont autant de qualifications que nous
donnons aux objets,
&
[ont par con[équent alltant
de noms adjeétifs. Et paree que ce [ont les impreffions
que les objets phyfiques font fllr nos [ens, qui nous
font donner
a
ces objets les qnalincations dont nous
venons de parler, nous appellerons ces [ortes d'ad–
jeétifs
adjeaifs phyJiques.
Remarquez qll'il n'y a rien dans les objets qui foit
[emblable au [enciment qu'ils excitent en nous. Seu–
lement les objets [ont tels qu'ils excitent en nous telle
(enfation, on tel [entiment, Celon la diCpofition de nos
organes,
&
felon les lois du méchanifme univerfel.
Une aiguille eft telle que fi la pointe de cette aiguille
eft enfoncée dans ma peau, j'aurai un Centiment de
douleur: mais ce [enciment ne [era c¡u'en moi,
&
nullement dans l'aigllille. On doit en dire autant de
toutes les autres [enfations.
Outre les adjeaifs phyfiques il y a encore les
ad–
jeaifs métaphyJiques
qui [ont en tres-grand nombre,
&
dont on pourroit faire autant de cla{[es différentes
qu'il y a de Cortes de vUes [ous leCquelles l'e{¡)rit
peut conúdérer les
~tres
phyfiques & les
~tres
mé-
taphyfigues.
.
A ·D
J
133
'Comme
nóus
[ommes aecóUtuméli
a
qtlalifier les
~tre~ phyíiCf1:~S
, eh conféquence des impreílIoqsiln.
mécJ.jar~s
qlt fis font fUT nOlls,
nou~
qLiáiifions al1m.
les etres
mét!lphyficill~5
&
aJ:jfuaits,
e~
confé9L«!t\ce
de
que~c¡u:
conf¡dérat;t0fl
~e
n tre efpnt n cHr
é~\¡rd.
Les adjeétifs Cf111 el<ptllhefit
f!~
COl
te~
de
vUés
01'1
con–
fidérafions,
10M
ceux
t¡iie
raPPr1!e
'fdjetlifi }n'¿taphyfo
ques,
ce. qui-s'entencl!'a mil!tl?f'pa'r
é:l¿~
exempH!s;
StIPPof'On,S
une
auée
dYafbt'eN'u mJuieu ¡{'urie v¡¡fte
praine : dellX homnles
~rrivent
a
cette ,álIée , gun
par
mt
bo~t,
l'atltre pat le bout 0PI?o[é; éhácun de
ces hommes regardaht les a 'bres de cette.
alÍ~e
dit,
voilt'i Lé ptemiel
;
de Corte Cf1le I'atbre que chacun de
ces hommes appelle
le ptemíer
efl: le dernier par rap–
port a l'autre homme. Airtfi
premier, dernier,
& les
autres noms de nombre ordinal, ne [Ollf(¡'uec{es ad–
jeétifs métaphyfiques. Cé [
q.ntdes
adjeétifs:de~~,ation
&
de rapport numéral.
Les noms de nombre
bardf~t,
telsCf11e
1
deux,
trois,
&c. [ont aufIi. des adjeétíts méfa,phyfiqu,es
qtÚ
quali–
fient une colleaion d'individus.
11'
Mon,
ma,
ton, ca, foa ,fa,
&c.
[ont auili qes
adjeélifs
métapbyfiques ~qLú
détignent
'Un
-rapport
d'appartenance ou de propriété,
&
non mie c¡ualité
phyfique
&
permanente des objets.
.
Grand
&
petit
[ont encóre des
adjeéti~)métaphy
fiques; car un cotps, quel qu'il [oit, n'eí!: ni grand
ni petit en lui-meme;
il
h'efl: appellé
teL
qué par rap–
port a
1111
{lutre corps. Ce
a
quói nous avons aonné
le nom de
granti
a fah en nous une impteffion diffé–
rente de celle que ce
que
nous appellons
puit
nOLlS a
faite; c'ea la perception de cette difFérence qui nous
a donné líeu d'inventer les noms de
grand
,
de
petit
,
de
moindrt,
&c.
Diffirent
~
pnreil ,jembLablt
,
font aum des adjeétifs
métaphyfiques qui c¡ualinent les noms [ubfl:antifs en
conCéquence de certaines vlles particulleres de l'e[–
prit.
Differem
c¡ualifie un nom préclfément entant
que je íens que la chofe n'a pas faít en mol des im–
preffions pareilles a celles qu'un alltre
y
a faites.
Deux objets tels que j'appers;ois Cf1le I'un n'eft pas
l'autre, font pourtant en moi des impreffions pa–
reilles en certains points : je dis Cf11'i1S [ontfemblables
en ces points la, parce que je me [ens affeété
a
cet
égard de la m&me maniere; ainfi
fembLahLe
eftun ad–
jeétifmétaphyfique.
Je me promene tout autour de cette villede guerre,
que je vois enfermée dans [es rempans : j'appers:ois
cette campagne bornée d'un coté par une riviere &
d'un antre par une foret : je vois ce tablean enfermé
dans Con cadre, dont je puis meme me[urer l'étendue
& dont je vois les bornes: je mets Cur ma table un
livre, un écu; je vois Cf11'ils n'occllpent Cf11'une petite
étendue de ma table; que ma table meme ne remplit
C[u'un petit e{¡Jace de ma chambre ,
&
Cf1le ma cham–
bre efl: renfermée par des murailles : enfin tout corps
me paroit borné par d'autres corps, & je vois une
étendue au-dela. Je dis donc 1ue ces corps [ont
bor–
nts, terminés ,jinis
;
ainfi
borne, terminé,fini,
ne filp–
pofent 9ue des bornes
&
la connoi{[ance d'une éten–
due luterieure.
D'un autre
co.té, fi je me mets a compter quelCf1le
nombre Cf1le ce pui{[e
~tre,
flIt-ce le nombre des
grains de {able de la mer & des feuilles de tous les
arbres (jlú [ont [ur la Curface de la terre, je trouve
que je puis encore y ajollter , tantqu'enfin, las de ces
additions tOlIjOurS poffibles , je dis Cf1le ce nombre eft
infini,
c'ea-a-dire, Cf11'il eft tel, que je n'en apper–
«ois pas les bornes,
&
c¡ue je puis tOtljOllrS en aug–
menter la fomme totale.J'en dis autant de tout corps
étendu, dont norre imaginacion peut tOlIjOurS écarter
les bornes ,
&
venir enfin
a
I'étendue infinie. Ainfi
infini
n'eíl: (Iu'un adjeétif métaphyfique.
/
















