
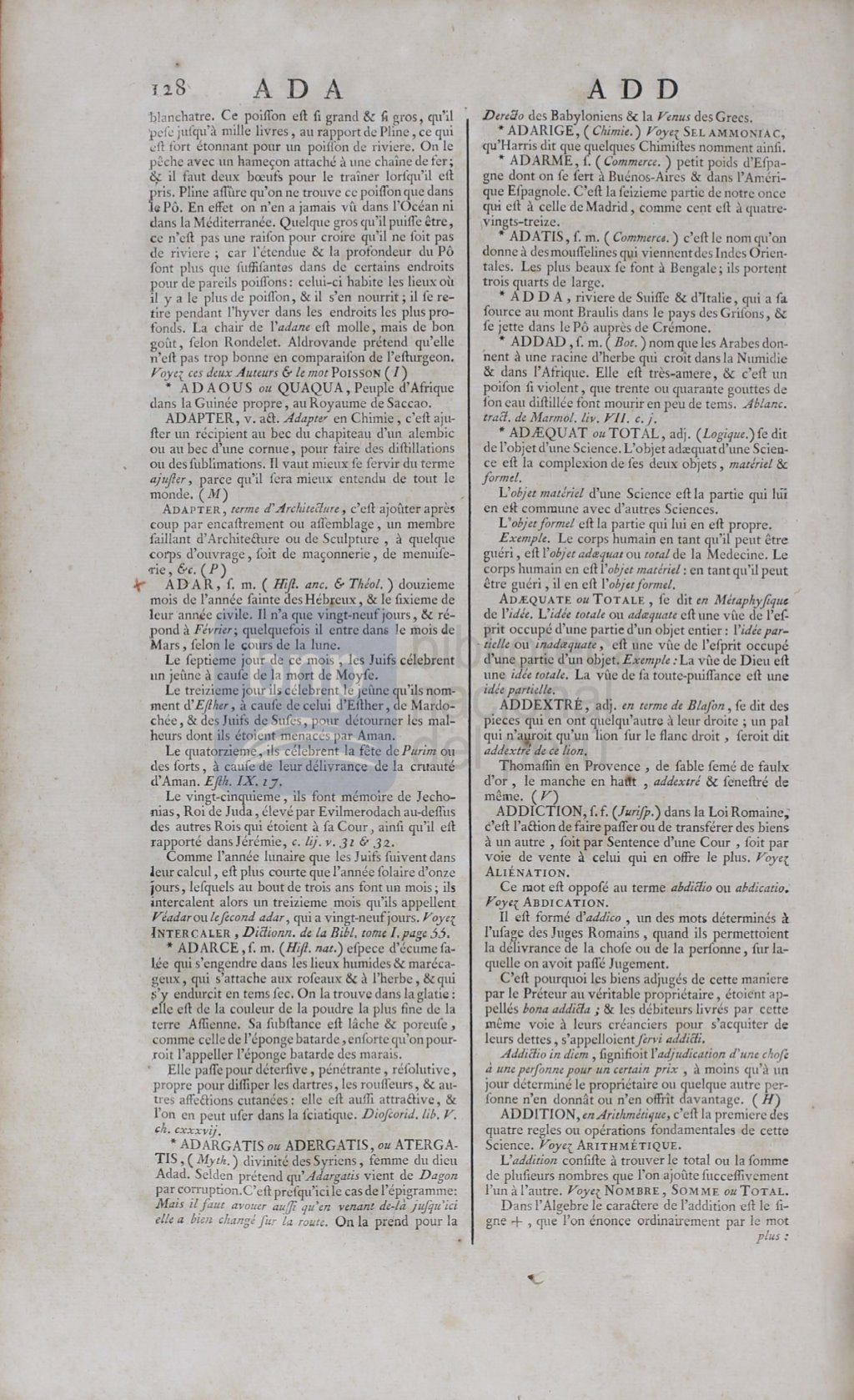
ADA
b.lanc:hatre. Ce poi1fon eft fi granel
&
{.i
gros, qu'il
p e[e ju[qu'a mille livres, au I'apport de Pline, ce qui
dl:
tort étonnant ponr un poiífon ele I'iviere. On le
p~che
avec un
hame~on
attaché a une chaine de fel' ;
8{.
il faut eleux bocufs pour le traine!" lorfqu'il eíl
pris. Pline affitre qu'on ne trouve ce poiífon que dans
l~
PO.
En effet on n'en a jamais
VII
dans 1'0céan ni
dans la Méditerranée. Quelque gros qu'il puiífe etre,
ce n'eft pas une rai[on ponr croire qu'il ne [oit pas
de riviere; cal' rétenelue
&
la profoneleur elu
PO
[ont plus que {ufli{antes elans ele certains enelroits
pour ele pareils poi1fons: celui-ci habite les lieux
011
il Y a le plus ele poi!I'on,
&
il s'en nourrit; il [e re–
tire pendant l'hyver dans les endroits les plus pro–
fonds. La chair de
l'adane
eíl molle , mais de bon
gout, [elon Rondelet. Aldrovande prétend qu'elle
n'eft pas trop bonne en comparaifon de l'efturgeon.
Voye{ ces deux Auteurs
&
le
mot
POISSON (
1)
.. ADAOUS
ou
QUAQUA,Penpled'Afrique
dans la Guinée propre, au Royaume de Saccao.
ADAPTER, v . aét.
Adapter
en Chimie, c'eft aju–
fter un récipient au bec du chapiteau d'un alembic
on au bec d'une cornue, pour faire des diftillations
ou des{ublimations.
Il
vaut mieux (e [ervir du terme
ajujler,
paree qu'il [era mienx entendu de tout le
monde.
CM)
,
ADAPTER,
terme d'Arc!ziteélure ,
c'eíl ajollter apres
coup par encaílrement ou aífemblage, un membre
[aillant d'Architeél:ure ou de Sculpture ,
a
quelque
corps d'ouvrage, {oit de
ma~onnerie,
ele menuife–
<rie,
&c.
(P)
.t'
ADAR,
f.
m. (
Hifl.
anc.
&
Tlzéol.
)
douzieme
mois de l'année [ainte desHébreux ,
&
le {rxieme de
lcur année civile.
n
n'a que vingt-neuf jours,
&
ré–
pond a
Février;
quelquefois il entre dans le mois de
Mars, {elon le cours de la lune.
Le {eptieme jour de ce mois , les Juifs célebrent
nn jelllle
a
cau[e de la mort de Moy{e.
Le treizieme jour ils célebrent le jelllle qu'ils nom–
ment d'
Ejllzer,
a
cau[e de celui d'Eílher, de Mardo–
chée ,
&
des Juifs de Slúes, pour détourner les mal–
heurs dont ils étoient menacés par Aman.
Le quatorzieme, ils célebrent la fete
dePurim
ou
des {orts,
a
cau{e de leur délivrance de la cruauté
d'Aman.
Ejllz.
IX,
l7.
Le vingt-cincJuieme, ils font mémoire de Jecho–
nias, Roi de luda , élevé par Evilmerodach au-deífus
des autres Rois qui étoient
a
(a Cour ) ainú qu'il eft
rapporté dansJérémie,
c. lij.v.
3 l
&>
32.
Comme l'année lunaire que les hufs {uivent dans
lem caleul, eíl plus courte que l'année Colaire d'onze
íours, le{quels au bout de trois ans font un mois; ils
intercalent alors un treizieme mois qu'ils appellene
Véadarou leflcond adar,
qui a vingt-neufjours.
Yoye{
INTERcALER,
Diélioll1l. de ta Bibt. tome I.page
's's .
.. ADARCE, {. m.
(Hij!.
nat.)
ef¡)ece d'écume{a–
Lée qui s'engendre daos les Jieux humides
&
maréca–
geux , qui s'attache aux rofeaux
&
a
I'herbe,
&
qtU
$'y endurcit en tems[eco On la trouve dans la glatie :
.elle eft de la couleur de la poudre la plus fine de la
terre Affienne. 5a {llbl1:ance eíllache
&
poreufe,
comme celle de l'éponge batarde,enforte qu'on pour–
,roit l'appeller l'éponge batarde des marais.
;Elle paífepOllr cléteríive , pénétrante, ré{olutive,
propre pour diffiper les clartres, les rouífems,
&
au–
u"es affeél:ions cutanées: elle eíl auffi atU'aétive,
&
ron en peut ufer dans la {ciatique.
Viofcorid.
tib.
V.
cit. cxxxvij.
.. ADARGATIS
ou
ADERGATIS,
ou
ATERGA–
TIS , (
My tlt.)
diviniré des Sy:riens, femme du dieu
Adad. Selden prétend qu'
Adargalis
vient de
V agon
par
.co~llption"C'eíl
preequ'ici le cas de l'épigramme:
MalS
ti
falu avouer
au(fi
tjll'en venant de-Id jujt¡tt'ici
e!ü
a bim
clumgJfur la route.
On la prend pour la
ADD
V ereélo
des Babyloniens
&
la
Venus
des Crecs.
.. ADARIGE, (
Cltimie.) Yoye{
SEL AMJYlONIAC,
qu'Harris dit que quelques Chirnifies nomment ainfi.
.. ADARME,
f.
(Commerce.
)
petit poicls d'Efpa–
gne dont on {e {ert
a
Buénos-Aires
&
dans l'Améri–
que Efpagnole. C'eílla {eizieme partie de notre once
~i
eíl
a
~eUe
de Madrid, comme cene eft
a
qllaU'e–
vrngts-trelze.
.. ADATJS,
f.
m. (
COml1lerc8.
)
c'eílle nom qu'Qn
donne
a
desmouífelines qui viennentdes Indes Orien–
tales. Les plus beaux {e font
a
Bengale; ils portent
trois quarts de largc.
.. AD DA, riviere de Suiífe
&
d'Ttalie, qui a
{a
fource au mone Braulis dans le pays des Crifons,
&
(e jette dans le
PO
aupd:s de Crémone.
.. ADDAD,
f.
m.
(Bot.)
nom que les Arabes don–
nent
a
une racine d'herbe qui crolt dans la Numiclie
&
dans l'Afrique. Elle eíl u"es-amere,
&
c'eílun
poi{on fi violent, que trente ou quarante gouttes de
fon eau dillillée font mourir en peu de tems.
Ablanc.
traél. dejYfamzol. tiv.
r/J.
c.j.
.. ADk.QUAT
ou TOTAL,
adj.
(Logique.)
{e dit
de l'objet d'une Science. L'objet adrequatd'une Scien–
ce eílla complexion de {es dellx objets,
matérie/
&
forme/o
L'objet madriel
d'une Science eílla partie qui lúi
en eH comlDune avee d'autres Sciences.
L'objetformel
eílla partie qui lui en eft propre.
Exempte.
Le corps humain en tant qu'il peut etre
guéri, eft l'
objet adO!tjllat
ou
total
de la Medecine. Le
corps humain en eft
I'objet matériel:
en tantqu'il peut
etre guéri,
il
en efi
l'objecformel.
AD..EQUATE
ou
TOTALE, {e dit
en
Métaplzyfitjue
de
l'idle, L'idée totale
ou
adQ!quate
eílune vlle de l'ef.
prit occupé d'une partie d'un objet enrier:
l'idie par-
- lielte
ou
inadO!tjuate,
eíl une vlle de I'efprit occupé
d'une partie d'un objeto
Exemple
"
La Vlle de Dieu eft
une
idie totale.
La vue de {a toute-puiJI'ance eft une
¡die parlietle.
ADDEXTRÉ, adj.
en
terme de Btafon,
{e dit des
pieces qui en ont quelqu'autre
a
leur droite ; un pal
qui n'auroit qu'tm lion
[ur
le flanc droit, {eroit dit
addextré de ce tion.
Thomaffin en Provence, de Cable remé de faulx
d'or, le manche en hat't ,
addextré
&
(enefué de
meme.
(Y)
ADDICTION,
f.f.
(Jurijp.)
dans la Loi Romaine;
c'eft l'aétion de faire paífer ou de transférer des biens
¡\
un autre , {oit par Sentence d'une Cour , [oit par
voie de vente
a
celuí qui en olfre le plus.
Vrye:¡;
ALIÉNATION.
Ce IDOt eft oppo{é au terme
abdiélio
on
abdicatio;
Yoyer..
ABDICATION.
Il
eft formé
d'addico
,
IlIl
des mot, déterminés
a
l'u{ane des Juges Romains , quand ils permettoient
la delivrance de la chofe ou de la perfonne, {ur la–
queUe on avoit paífé Jugement.
C'eft pomquoi les biens adjugés de cette maniere
par le Prétem au véritable propriétaire, étoient ap–
pellés
bona addiéla
;
&
les débitems livrés par cerre
meme voie a leurs créanciers pour s'acquiter de
lems dettes, s'appeUoientflrvi
addié'li.
Addiélio in diem,
fignilioit
l'adjttdication d'lme chrif'c
ti
une perfonne pour un certain prix
,
¡\
moins qu'a un
jOltr déterminé le propriétaire ou quelque autre per–
(onne n'en donnar ou n'en olfrit clavantage.
(H)
ADDITION,enAritltméti'lue,
c'efi la premiere des
quatre regles ou opérarions fonda mentales de cette
Science.
Voye:¡;
ARITHMÉTIQUE.
L'
addition
confiíle
¡\
trollver le total ou la fomme
de plu(¡eurs nombres que l'on ajollte {ucceffivement
l'un
a
l'autre.
Voye{
NOMBRE, SOMME
ou
TOTAL.
D ans l'Algebre le caraétere de l'addition "eft le fi–
gne
+ ,
que l'on énonce ordinairement par le mor
plus :
















