
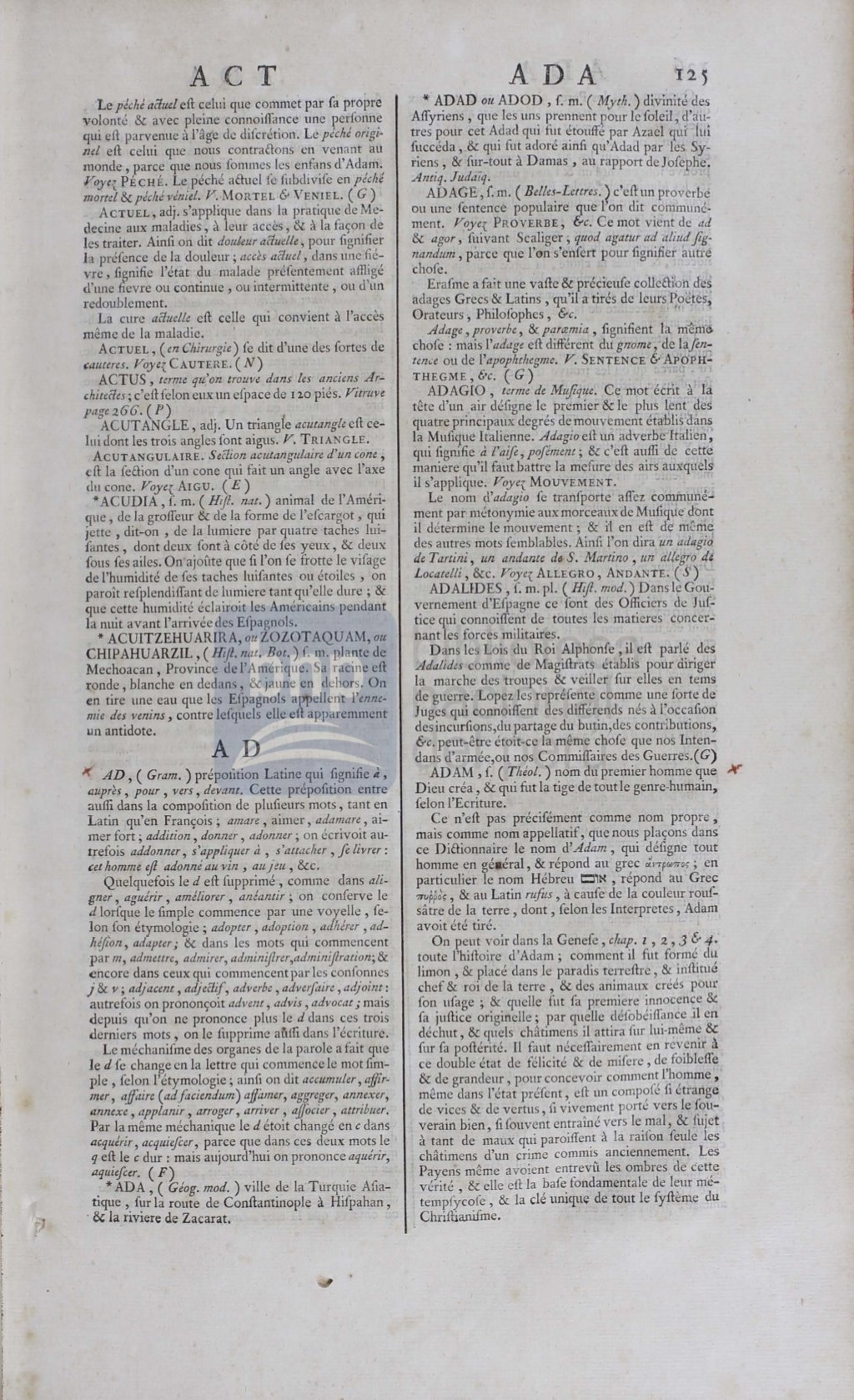
ACT
Le
p¿ehe aCEltel
eíl: celui que commet par (a propre
",olonté & avec pleíne connoilfance une per(onne
quí eíl: parvenue
a
l'age de di{crétion. Le
piehé origt ..
ml
eíl: celuí que nous contraaons en venant au
monde, parce que n0115 {0111mes les enfans d'Adam.
roye{
PÉCHÉ. Le péch' aaucl {e {ubdivi{e en
péclté
lllortel &péeMvéniel.
V.MORTEL
&
VENIEL. (
G)
ACTUEL, adj. s'applique dans la pratique de Me..
decine aux maladies,
a
lem acd:s,
&
a
la fac;on de
les traiter. Ainfi on dit
douleur aCluelle,
pom iigníñer
la
pré{ence de la douleur ;
acc~s
aallel,
dans une fié–
vre, fignifie l'état du malade préfentement amigé
cl'lUle ñevre ou continue , ou intermittente , ou d'un
redoublement.
La cure
aélueLle
eíl: celle qui convient
a
l'acd:s
m~me
de la maladie.
'
ACTUEL, (
en Chirrtrgie)
fe dit d'une des fortes de
cameres. Voye{
CAUTERE.
(N)
ACTUS,
urme 'lu'on
trouY~
dans les anciens Ar–
ehiteéles;
c'eíl:{elon eux un efpace de 120 piés.
Vitrlrve
page
266. (
1')
ACUTANGLE, adj. Un triangíe
aeruangleeft.ce–
lui
dont les trois angles font aigus.
V.
TRIANGLE.
ACUTANGULAIRE.
Seélion acutanglllaire d'uneone,
eft. la feaion d'un cone qui fait
un
angle avec l'axe
du cone.
Voye{
AIGU.
(E)
"ACUDrA,
f.
m.
(H'.ft.
nat.)
animal de l'Améri..
que, de la grolfeur & de la forme de l'e{cargot, qui
¡ette , dit-on , de la lumiere par quatre taches lui–
(antes, dont deux {ont
a
coté de {es yeux, & deux
(ous {es ailes. On ajollte que fi I'on fe frotte le vifage
de l'humidité de {es taches luifantes ou étoiles , on
parolt refplendilfant de lumiere tant qu'clle dure;
&
que cette humidité éclairoit les Américains pendant
la mut avant l'alTivée des Efpagnols.
" ACUITZEHUARlRA,
ou
ZOZOTAQUAM,
ou
CHIPAHUARZIL,
(H'.ft.
nato Bot.)
f.
m. plante de
Mechoacan , Province de l'Amérique. Sa racine eíl:
ronde, blanche en dedans, & jalUle en dehors. On
en tire une eau que les Efpagnols appellent
l'enne..
mi~
des venins,
contre lefquels elle eft. apparerrullent
un antidote.
AD
í(
AD,
(
Gram.
)
prépolÍtion Latine qui fignifie",
aupr~s
,
pour
,
vers, devant.
Cene prépoiition entre
auffi dans la compoiition de plufieurs mots, tant en
Latín qu'en Franc;ois;
amare,
aimer,
adamare,
ai–
mer fort ;
addition, donner
,
adonner;
on écrivoit au..
trefois
addonner, s'apptiquer
ti
,
s'attaeher, fe tivrer :
cetlwmme
l'
adonn¿ au vin
,
attjm
,
&c.
Quelquefois le
d
eft. fupprimé ,comme dans
ali ..
gner, aguérir
,
amétiorer, anéamir;
on con{erve le
d
lorfque le fimple commence par une voyelle , {e..
Ion (on étymologie ;
adopter, adoptÍoll
,
adhércr, ad–
Itijion, adapter;
& dans les mots qui commencent
par
m, admmre, admirer, adlllilliftrer,adminiftration;
&
encore dans ceux qui commencentpar les con{onnes
j
&
v; adjaeent, adjeélif, advcrbc ,ad'Yclfairc, adjoim:
autrefois on prononc;oit
advmt, advis, advocat;
mais
depuis qu'on ne prononce plus le
d
dans ces u'ois
derniers mots, on le {upprime aúffi dans l'écfiture.
Le méchanifme des organes de la parole a faít que
le
d
{e change en la lettre qui commence le mot fim–
pIe, felon l'étymologie; ainfi on dit
accumuler, affir..
mer, affaire (adfaciendum) af/illner, aggreger, annexer,
annexe, applanir, arroger, arriver, a.lfocier, attribuer.
Par la
m~me
méchanique le
d
étoit changé en
e
dans
acquérir, acr¡uieji:er,
parce que dans ces deux mots le
q
eft. le
e
dur : mais aujourd'hui on prononce
aquérir,
ll'fuiifcer. (F)
. "ADA, (
Glog. modo
)
ville de la Turquie Afia–
nque "
f~r
la route de Coníl:antinople
el
Hi{pahan,
, &
la f1V1ere de Zacarat.
ADA
*
ApAD
Oll
ADOD ,
f.
m. (
Myth.)
divinité des
Aífynens, que les
un~ ~rennent
pour
le
{oleil, d'a.u–
tres
~our
cet A,dad qlll ft!t
~toufFe
,par Azael
(LUf
lui
{ucceda , & C[lll fut adore a10fi qu Adad par les Sy–
riens,
&
fm-tout
el
Damas, au rapport de Jo{ephe.
Amir¡. Judair¡.
ADAGE,
f.
m.
(Belle5-Lettres'
l
c'eíl:110 proverbe
Oll
une fentence populaire que
1
on dit communé..
mento
Voye{
PROVERBE,
&c.
Ce mot vient de
ad
&
agor,
{uivant Scaliger,
quod agatur ad aLilldJig..
nandul/l,
paree C[lle ]'()n s'en{ért pour fignifier auu'e
chofe.
Erafme a fa;t une vaíl:e & précieufe colleMoh efes
adages Grecs
&
Latins , qu'il a tirés de leuts
Poet(:!)~
Orateurs, Philo{ophes,
&c.
"
Adage ,proverbe,
&
part2mia,
figni/ient la.
m~nf~
chofe : mais l'
adage
eft. di/férem dli
gnome,
de
lafen–
ten.:e
OU
de
l'apoplzt/¡egme.
V.
SENTENCE
&
ApOPH=
THEGME,
(,oc.
(G)
,
ADAGIO,
terme de Mu.Jique.
Ce mot
étrit
el la
t~te
d'nn air défrgne le premier & le pllls lent des
quatre principanx degrés de mouvement étahlis'dans
la Mufique Italienne.
Adagio
eft. un adverbe ltalien,
qui figniñe
ti
l'aife, pofémcm;
& c'eft. auffi de cette
maniere qu'il fautbattre la meftlTe des airs auxquels
il
s'applique.
Voye{
MO\JVEMENT.
Le nom
d'adagio
{e tranfporte alfez communé–
ment par métonymie aux morceauxde MufiC[lle dOnt
il determine le mouvement;
&
i'l en eíl: de mcme
des autres mots {emblables. Ainfi I'on dira
un adagia
de TarLÍni, un andante ds
S.
Martino
,
un al/egro
d~
Locatelli,
&c.
Voye{
ALLEGRO , ANDANTE. (
S)
ADALIDES,
f.
m. pI.
(H'.ft.
modo
)
Dans le Gon..
vernement d'E{pagne ce {ont des Officiers de Ju(–
tice qui connoilfent de toutes les matieres éoncer–
nant les forces militaires.
Dans les Lois du Roí Alphon{e , il efi parlé des
Adalides
comme de Magiíl:rats établis pour diriger
la marche des troupes & veiller {ur elles en tems
de guerreo Lopez les repréfente comme une (orte de
Juges qui connoiífent des difFérends nés
a
I'occaiion
desincurfions,du partage du butin,des contribntions,
&c.
peut-~tre
étoit..ce la meme chofe que nos Inten–
dans d'armée,ou nos Commiífaires des GuelTes.(G)
ADAM ,
f. (
Théol.
)
110m du premier homme C[lle
K
Dieu créa, & C[ltÍ fut la tige de tout le genre..humain,
{elon l'Ecriture.
Ce n'eíl: pas préci[ément comme nom propre,
mais comme nom appellatif, que nous plac;ons dans
ce Diélionnaire le nom d'
Adam,
qui défigne tout
homme en géaéral,
&
répond au grec
J.v7p.J7rO~ ;
en
particulier le nom Hébreu
C1N
,
répond au Grec
77Uppd~,
&
au Latin
mfus,
el
cauCe de la couleur rou(–
satre de la terre, dont , {elon les Interpretes, Adam
avoit été
tiré.
On peut voir dans la Gene{e ,
chapo
l
,
2,3
&
4.
toute I'hift.oire d'Adam; comment il fut formé dll
limon ,
&
placé dans le paradis
telTeft.re,
&
il1ft.itué
chef
&
roi de la telTe , & des animaux créés pou!'
{on ufage ;
&
C[llelle fut
{a
premiere innocence
&
{a juft.ice originelle; par C[llelle dé{obéilfance il en
déchut, & C[llels chatimens il attira
fitr
lui..
~&m:
&
{m
{a poíl:érité.
11
faut néceífairement en rev.erur
~
ce double état de félicité
&
de mi{ere, de fOlbleíle
& de grandeur , pour concevoir comment l'homme ,
m~me
dans I'état préfent, efi un compo{é fi étrange
de vices
&
de vertus, fi vivement porté vers le [ou–
verain bien, fi fouvent entralné vers le mal, & {ujet
a
tant de maux qui
paroiífe~t
a
la .rai{oll {eule les
chiltimens d'un crime commls anClennement. Les
Payens meme avoient entrevll les ombres de tette
vérité & elle cíl: la ba(e fondamentale de leur mé–
temp{;co{e ,
&
la cié uniC[lle de tout le {yíl:em,e du
Chriíl:ianifme.
















