
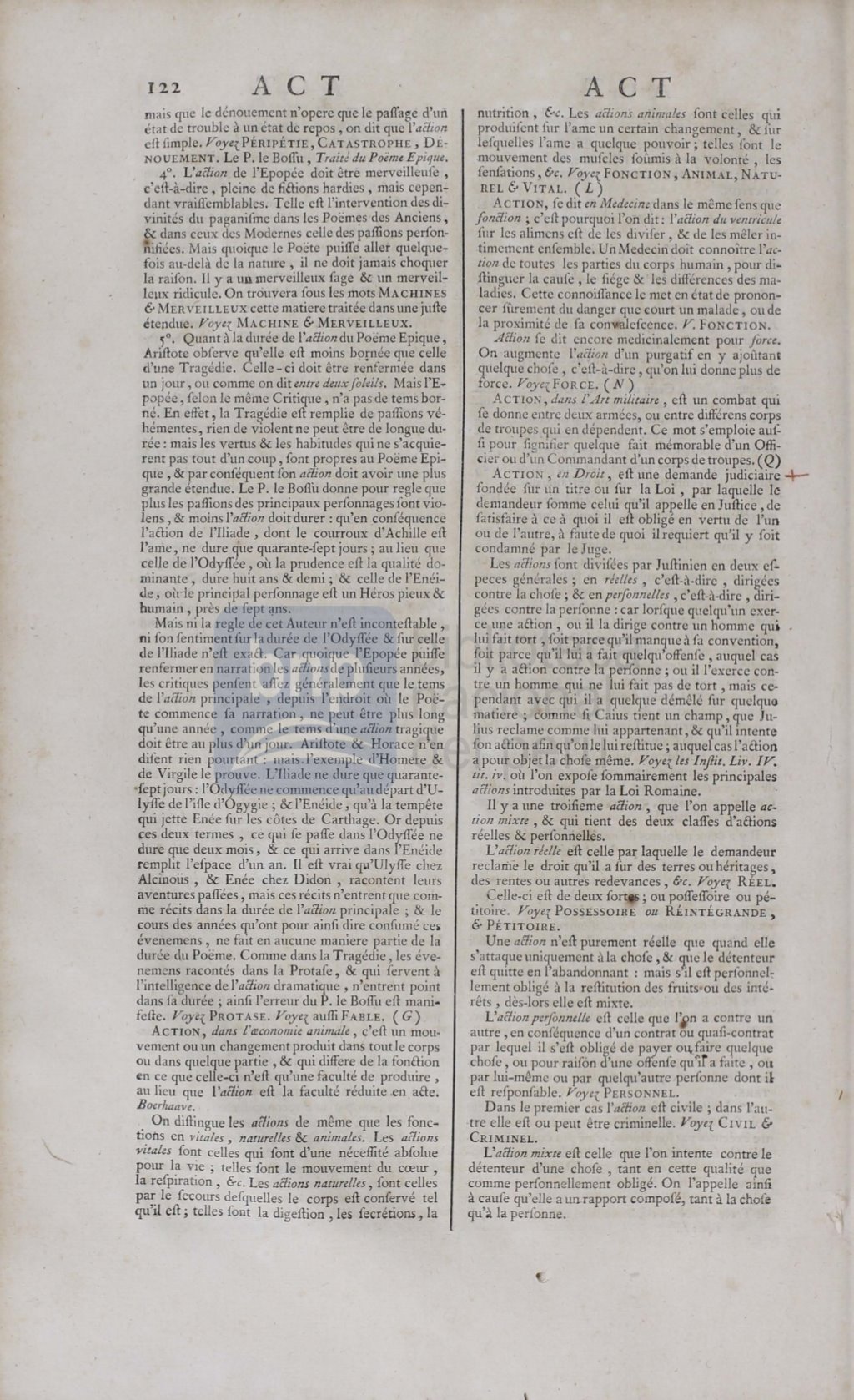
122
ACT
mais que le dénouement n'opere que le palfage d'un
érar de rrouble a un érat de repos, on dit que
l'a8ion
cíllimple. Voye{PÉRIPÉTIE, CATASTROPHE, DÉ–
NOUEMENT. Le
P.leBoíTu,
Traité duPoimeEpi'lut.
4°. L'aélion
de l'Epopée doir etre merveilleufe ,
c'efi-a-dire, pleine de /iéOons hardies , mais cepen–
dant vrai1I'emblables. Telle efi I'intervention des di–
vinités du paganifme dans les Poemes des Anciens,
& dans ceux des Modernes celle des paffions perfon–
ni/iées. Mais quoique le Poete puiíTe aller quelque–
fois au-dela de la nantre ,
il
ne doit jamais choquer
la raifon. 11 ya
1II1
merveilleux fage & un merveil–
lellx ridicule. On trouvera fous les mors MACHINES
&
MERVEILLEUX cette matiere traitée dansune jufie
étendue.
f/oye{
MACHINE
&
MERVEILLEUX.
~o.
Quanr a la durée de
l'a8iondu
Poeme Epique,
Al'ifiote obferve qu'elle efi moins b9!née que celle
d'une Tragédie. Celle - ci doit etre reruermée dans
un jour, ou comme on dir
tIltre deuxfoLeils.
Mais I'E.
popée, felon le meme Critique, n'a pas de tems bor–
né. En effet, la Tragédie efi remplie de paffions vé–
hémentes, rien de violent ne peut etre de longue du–
rée : mais les
vemlS
& les habitudes qui ne s'acquie–
rent pas rout d'un coup, font propres au Poeme Epi–
que,
&
par conféquent fon
ailion
doit avoir une plus
grande étendue. Le P. le Bofill donne pour regle e¡ue
plus les paffions des principaux perfonnages font vio–
lens ,
&
moins
l'a8ion
doit durer : qu'en conféquence
I'atrion de l'I1iade, dont le courroux d'Achille efi
l'ame, ne dure que quarante-fept jours ; au lieu que
celle de 1'0dyiTee , oü la prudence efi la qualiré do–
minante, dure huit ans
&
demi; & celle de l'Enéi–
de, olde princi¡Jal perfonnage efi un Héros pieux &
humain , pl'es de fept ¡¡ns.
Mais ni la regle de cet Allteur n'efr incontefiable ,
ni (on (enciment fur la durée de l'OdyíTée
&
fiu' celle
de l'IIiade n'efi exatr. Car quoique l'Epopée puiíTe
renfermer en narrarion les
amonsde
plufiems années,
les critiques penfent aíTez généralement que le tems
de
l'ailioll
principale , depuis I'endroit oü le Poc–
te commence fa narration, ne peut etre plus long
qu'une année, comme le tems d'¡me
a8ioll
tragique
doir erre au plus d'un jOllf. Arifiote & Horace n'en
difent rien pounant: mais.l'exemple d'Homere
&
de Virgile le prouve. L'Iliade ne dure que quarame–
(eptjours : l'OdyiTée ne commence qu'au départ d'U–
lyiTe del'iíle d'Ogygie; &1'Enéide, qu'a la tempete
qui jette Enée fm les cotes de Carthage. Or depuis
ces deux termes, ce qni fe paíTe dans l'OdyiTée ne
dure que deux mois,
&
ce qui arrive dans l'Enéide
remplit l'efpace. d'un ano Il efi vrai
q~I'UlyíTe
chez
Alcmoiis ,
&
Enée chez Didon , racontent leurs
avenntres paíTées, mais ces récirs n'entrent que com–
me récits dans la durée de
I'amon
principale ;
&
le
cours des années qu'ont pou!' ainfi dire confumé ce¡
évenemens, ne faít en aucune maniere partie de la
durée du Poeme. Comme dans la Tragédie, les éve–
nemens racontés dans la Prota(e,
&
qui fervent a
I'imelligence de
l'a8ion
dramatique , n'entrent point
dans fa durée ; ainfi I'erreur du P. le Boífu efi maní·
fefre.
Voye{
PROTASE.
Voyepuffi
FABLE.
(G)
ACTlON,
dans l'l1leonomie animale,
c'efi un mou–
vement ou un changement produit dans tout le corps
ou dans quelque partie ,
&
qui differe de la fontrion
('n cc que celle-ci n'efi qu'une faculté de produire>
au lieu que
l'aélion
efi la faculté réduite .en aék
Boerhaave.
. On difringue les
aélions
de meme que les fonc–
t10ils en
vitales> naturelles
&
animales.
Les
aélions
'Vitales
font celles qui font d'une néceffité ahfolue
pOLtr la vie ; telles font le mOLlvement du coeur ,
la refpiration,
&c.
Les
a8ions naturdles,
font celles
par le fecoLtrs defquelles le corps efi confervé tel
qu'il efi; telles font la digefrion ) les fecrétions, la
ACT
nutl'ition,
é-e.
Les
aélions animales
font celles qui
prodtúfent fm l'ame un certain changement,
&
litr
lefqnelles I'ame a quelque pouvoir; telles 10m le
mouvement des mufcles fOLunis a la volonté, les
fenfations,
&c. Voye{
FONCTION, A IMAL, NATU–
REL
&
VITAL.
(L)
ACTION, fe dit
en
M.edecine
dans le meme fens que
fonilioll
;
c'efi pourquoi I'on dit:
I'aélion dll ventríell!e
fur les alimens efi de les divifer,
&
de les meler io–
timement enfemble. Un Medecin doit connoltre
I'ae–
lion
de toutes les parcies du corps humain, pour
di–
fringuer la caufe , le ftége
&
les différences des ma–
ladies. Cette connoiíTance le Oler en état de pronon–
cer (urement du danger que court un malade , ou de
la proximiré de fa conVlalefcence.
V.
FONCTION.
Amon
fe dit encore medicinalement pour
force.
On augmcme
l'a8ioll
d'un purgatif en
y
ajoLltan[
quelque chofe, c'efi-a-dire, qu'on lui donne plus de
force.
Voye{
FORCE.
(N)
ACTlON,
d.lIls tAn militaire
,
ea un combat qui
fe donne entre deux armées, ou entre différens corps
de troupes qui en dépendent. Ce mot s'emploie auf–
fi pour figlllfier quelque fair mémorable d'un Offi–
ciel' OH d'un ommandant d'tm corps de troupes.
(Q)
ACTION,
.:n
Droit,
efi une demande judiciaire
4-–
fondée fm un litre ou f\Ir la Loi , par laquelle le
demandeur fomme celui qu'il appelle en Jufrice ,de
ú¡tisfaire a ce ¡I quoi il efi obligé en vertu de l'un
ou de ¡'mitre, ,\ faute de quoi il requiert qu'il
y
foit
condamné par le Juge.
Les
aélions
font divifées par Jnfiinien en deux ef–
peces générales; en
réelles,
c'efi-a-dire , dirigées
conO'e la chofe;
&
enperfonnelles
,c'efi-a-dire, diri–
gées contre la perfonne : car lorfque quelqu'un exer–
ce une aétion , ou il la dirige conrre un homme qU)
lui faít tort , foit paree qu'il manque
a
fa convention,
foit paree qu'illui a fait quelqu'offen(e , auquel cas
il
y a aétion contre la perfonne ; ou ill'exerce con–
tre un homme qui ne lui fait pas de tort , mais ce–
pendant avec C¡lli il a quelque démNé fm quclquG
matiere ; comme ft Cains tient un champ, que Ju–
lius reclame comme Itú appartenant, & qu'il intente
fon atrion a/in qu'onle lui reilirue; auquel cas I'aétion
a pom objet la chole meme.
Voye{
les
Injlit. Liv. IV.
tÍt.
iv.
011
I'on expo{e fommairement les principales
aélions
introduites par la Loi Romaine.
Il
y
a une trojfieme
a8ion,
que I'on appelle
ae–
tion mixte
,
&
qui tient des deux c1aíTes d'aaions
réelles
&
perfonnelles.
L'aéliOIl rée/Le
efi celle par laquelle le demandeur
reclarile le droit qu'i1 a fuI' des terres ou
hérita~es,
des rentes ou autres redevances ,
&e. Voye"
REEL.
Celle-ci efi de deux fort ; ou poíTeíToire ou pé–
titoire.
Voye{
POSSESSOIRE
ou
RÉINTÉGRANDE,
&
PÉTITOIRE.
Une
aélion
n'efi purement réelle que quand elle
s'attaque uniquement
a
la chofe,
&
Tle le dérenteur
efr quitte en I'abandonnant : mais sil efr perfonnel–
lement obligé
a
la reilitution des fnúts'ou des inté–
rets , des-Iors elle efr mixte.
L'
a8ionpeifiJlZllelle
efr celle que I.,n a contre un
autre ,en conféquence d'un contrar ou quaft-contrat
par lequel ji s'efi obligé de payer ou,.faire quelque
chofe, ou pour raifon d'une offenfe qu'ir a faite, Oll
par
lui-m~me
ou par quelqu'autre per(onne dont
i~
efi refponfable.
Voye{
PERSONNEL.
Dans le premier cas
I'amon
efl civile ; dans I'au–
tre elle en ou peut etre criminelle.
Voye{
CIVIL
&
CRIMINEL.
L'aélion mixte
efr celle que I'on intente contre le
détenreur d'une chofe, tant en cette qualité que
comme perfonnellcmenr obligé. On l'appelIe all1fi
a caufe qu'elle a un.rapport compo(é, tant
a
la chofe
qu'a la perfonne.
















