
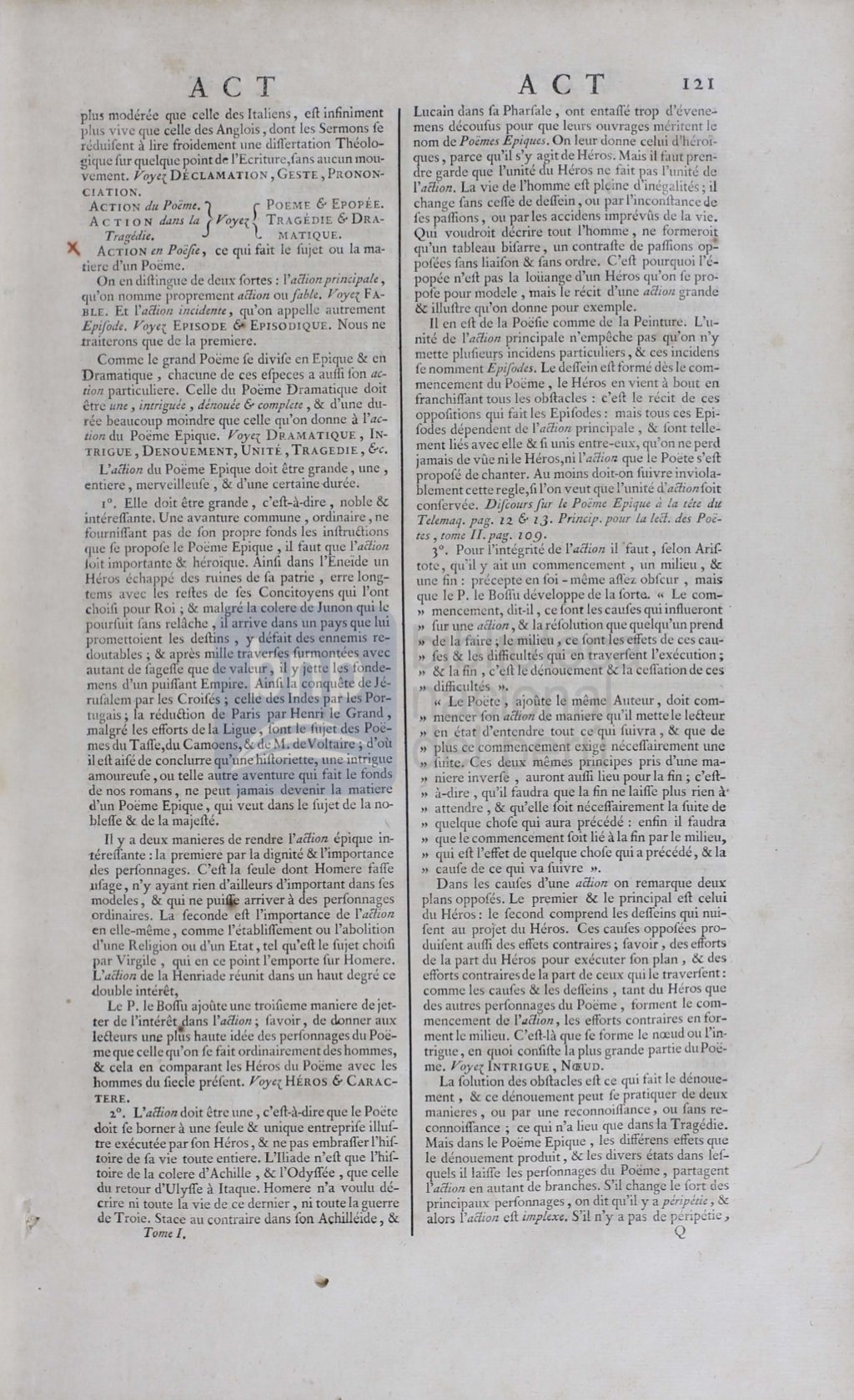
ACT
plt15
modérée que celle des Italiens, efi infiniment
plus vive que celle des Anglois , dont les Sermons [e
rédlú{cnt
a
lire froidement une difiertation Théolo–
gique [ur quelque point de l'Ecriture,[an aucun mou–
vement.
Voye{
DÉCLAMATION, GESTE, PRONON–
CIATION.
ACTION
dlt
poeme.}
f
POEM E
&
EpopÉE.
A CT ION
dans
La
Voye{"\
TRAGÉDIE
&
DRA-
TragUie.
t.
MATIQUE.
X.
ACTlON
en Poijie,
ce qui fait le [ujet ou la ma–
tiere d'un Poeme.
On en difiingue de deux [ortes : l'
aé/ionprincipaLe ,
qu'on nomme proprement
aé/ion onJable. Voye{
FA–
BLE. Et
I'aétion incidente ,
qu'on appelle autrement
Epifode. Voye{
EPISODE
&
EPISODIQUE. Nous ne
traiterons que de la premiere.
Comme le grand Poeme fe divi[e en Epique & en
Dramatique, chacune de ces e[peces a au¡!i [on
ac–
(ion
particuliere. Celle du Poeme D ramatique doit
&tre
une,
intriguée
,
dénouée
&
complete,
& d'nne du–
rée beaucoup moinme que celle qu'on donne
a
I'ac–
tion
du Poeme Epique.
Voye{
DRAMATIQUE, IN–
TRIGUE, DENOUEMENT, UNITÉ, TRAGEDIE,
&c.
L'
aaion
du Poeme Epique doit &tre grande, une,
entiere, merveilleu[e , & d'une certaine-durée.
l°.
Elle doit &tre grande, c'efi-a-dire, noble
&
intéreíf.,nte. Une avanture commune, ordinaire, ne
fomniffant pas de [on propre fonds les infiruétions
que [e propo[e le Poeme Epique , iI faut que
I'aaion
foit importante & héroique. Aínfi dans l'Eneide un
Héros échappé des ruines de (" patrie, erre long–
tems avec les refies de [es Concitoyens qlÚ I'ont
choili polU" Roi ; & malgré la colere de Junon qui le
pour(uit fans relache , íl arrive dans un pays que
ltú
promettoient les defrins , y défait des ennemís re–
doutables ; & apd:s rnille travenes [mmontées avec
autant de [ageífe que de valeur, il Y jette les fonde–
mens d'un puiffant Empíre. Ainfi la conqu&te de
J
é–
nú.,lcm par les Croifés; celle des Indes par les Por–
wgais; la réduaion de Paris par Henri le Grand,
malgré les efforts de la Ligue, [ont le [ujet des Poe–
mes du Taífe,du Camoens,& de M. deVoltaire ; d'oü
il efi airé de conclurre qu'une hifioriette, une intrigue
amourelúe,ou telle autre aventure qui fait le fonds
de nos romans, ne peut jamais devenir la matiere
d'un Poeme Epique, 'luí veut dans le [ujet de la no–
hIeRe & de la majefié.
II y a deux manieres de renme l'
aé/ion
épique in–
téreRante :la prerniere par la dignité & I'importance
des penonnages. C'efi la [eule dont Homere faRe
ll[age, n'y ayant rien d'ailleurs d'imporrant dans (es
modeles, &
qui
ne plÚ¡¡e arriver a des penonnages
ordinaires. La [econde efi l'importance de
I'aélion
en elle-m&me, comme l'établiRement ou I'abolition
¿'une Religion ou d'un Etat, tel qu'efi le [ujet chom
par Virgile, qui en ce point I'emporre fur Homere.
L'aé/ion
de la Henriade réunit dans un haut degré ce
double intér&t,
Le P. le BoRu ajollte une troifieme maniere de jet–
ter de I'imér&t dans l'
aé/ion;
fa
voir,
de oonner aux
leéteurs une plus haute idée des perfonnages du Poe–
meque celle qu'on [e fai t ordinairement des hommes,
& cela en comparant les Héros du Poeme avec les
hommes du lieele préfent.
Voye{
HÉROS
&
CARAC–
TERE.
2°.
L'aé/iondoit &tre une, c'efi-a-direque le Poete
doit [e borner a une (eule & unique entreprife illu[–
tre exécutée par [on Héros, & ne pas embraífer l'hif–
toire de [a vie toute entiere. L'Iliade n'efi que I'hi[–
toire de la colere d'Achille ,
&
l'Odyífée , que celle
dl~
retour d'UlyRe a Itaque. Homere n'a voulu dé–
enre ni toure la vie de ce dernier , ni toute la guerre
de Troie. Stace au contraire clans [on Achilléide, &
Tome l.
ACT
12I
Lncain dans [a Phar[ale , ont entalTé trop d'évene–
mens découfus pour que leurs ouvrages méritcnt le
nom de
Poiimes Epiques.
On lem donne celui d'héroi–
ques, paree qu'il s'y agit de Héros. Mais il f¡lIlt pren–
dre garde que I'unité du Héros ne fait pas l'unité de
l'aélion.
La vie de
I'homm~
efi pleine,d'inégalités; il
change fans ceRe de deífelll , ou pal'lmconfiance de
[es pafllons, ou par les accidens imprévlIs de la vie.
Qui voudroit décrire tout I'homme, ne formeroit
qu'un tablcau bifarre, un contrafie de paffions op–
polees fans liaifon & fans orclre. C'efi pourquoi I'é–
popée n'efi pas la loiiange d'un Héros qu'on fe pro–
po[e pour modde , mais le récit c!'une
aé/ion
grande
&
illufire qu'on donne pour exemple.
II en efi de la Poefie comme de la Peinture. L'u–
nité de
I'aé/io/l
principale n'emp&che pas qtl'on n'y
merte plufieufs incidens particuliers, & ces incidens
[e nomment
Epifodes.
Le deffein efiformé des le com–
mencement du Poeme , le Héros en vient
a
bollt en
franchilTant tous les obfiaeles : c'eíl: le récit de ces
oppofitions qui fait les Epi[odes: mais tous ces Epi–
[odes dépendent de
I'a$on
principale, & [ont telle–
ment liés avec elle & fi unis entre-eux, qu'on ne perd
jamais de Vlleni le Héros,ni
I'aaion
que le Poetes'eíl:
propofé de chanter. Au moins doit-on fuivre inviola–
blement cette regle,fi l'on veut que I'unité
d'aaion[oit
con[ervée.
Diftours
jit,.
le
Poeme Epique
a
la
téte du
TeLemaq. pago
I2
&
I3.
Princip.pour la lea. des Poi–
tes, tome lI.pag.
109.
3°.
Pour I'intégrité de
l'aélion
il faut, [elon AriC–
tote, qu'iI y ait un commencement , un milieu ,
&
une fin: précepte en [oi - meme ailez obfcur , mais
que le P. le Boílll développe de la [orte..
«
Le com–
" mencemcnt, dit-il, ce [ont les cau[es qui influeront .
" [m une
aaion,
& la ré/olution que quelqu'un prend
»
de la faire; le milieu, ce font les elfets de ces cau–
" fes & les difficnltés qui en traver[ent I'exécntion;
" &
la fin , c'efi le dénouement
&
la ceÍlation de ees
" difficultés ".
«
Le Pocte, ajollte le m&me Auteur, doit com–
" mencer [on
aéiion
de maniere qu'il mette le leéteur
" en état d'entendre tout ce qui [uivra, & que de
" plus ce commencement exige néceffairement une
" [uite. Ces deux memes principes pris d'tme ma–
" niere inver[e , auront auffi lieu pour la fin; c'efi–
" a-dire, qu'il fauw'a que la fin ne laiÍle plus rien
¡\.
" attenw'e, & qtl'eUe [oit nécelTairement la [uite de
" quelque chofe qlÚ aura précédé : eMn il fauma
" que le commencement [oit lié a la fin par le milieu,
" qui efi I'elfet de quelque chofe qtti a précédé, & la
" caufe de ce qui va fuivre ".
D ans les caufes d'une
aaion
on remarque deuJ(
plans oppoCés. Le premier
&
le principal efi celui
du Héros: le [econd comprend les deífeins qui nui–
Cent
au profet du Héros. Ces cauCes oppofées pro–
duifent auffi des elfets contraires; [avoir , des elforts
de la part du Héros pOur exécuter [on plan, & des
elforts contrairesde la part de ceux qui le travenent:
comme les caufes & les delTeins , tant du Héros que
des autres perConnages du Poeme, forment le com–
mencement de
l'uRion,
les efforts contraires en for–
ment le milieu. C'efi-h\ que [e forme le nreud onl'in–
trigue, en quoi conhfie la plus grande partie duPoe–
me.
Voye{
INTRIGUE, Nm:UD.
La [olution des obíl:acles efi ce qui fait le dénoue–
ment, & ce dénouement peut [e pratiquer de deux
manieres, ou par une reconnoilTance, ou fans re–
connoilTance ; ce qui n'a lien que ?ans la Tragédie.
Mais dans le Poeme Epique , les dilférens elfets que
le dénouement produit, & les divers états dans le[–
c¡uels illaiRe les perfonnages duo Poeme, partagent
l'aé/ion
en autant de branches. S'II change le fort des
principaux perfonnages, on dit qu'il y a
peripJtie ,
&
alors l'
aaion
eil:
implexe.
S'il n'y a pas de p 'ripétie,
Q
















