
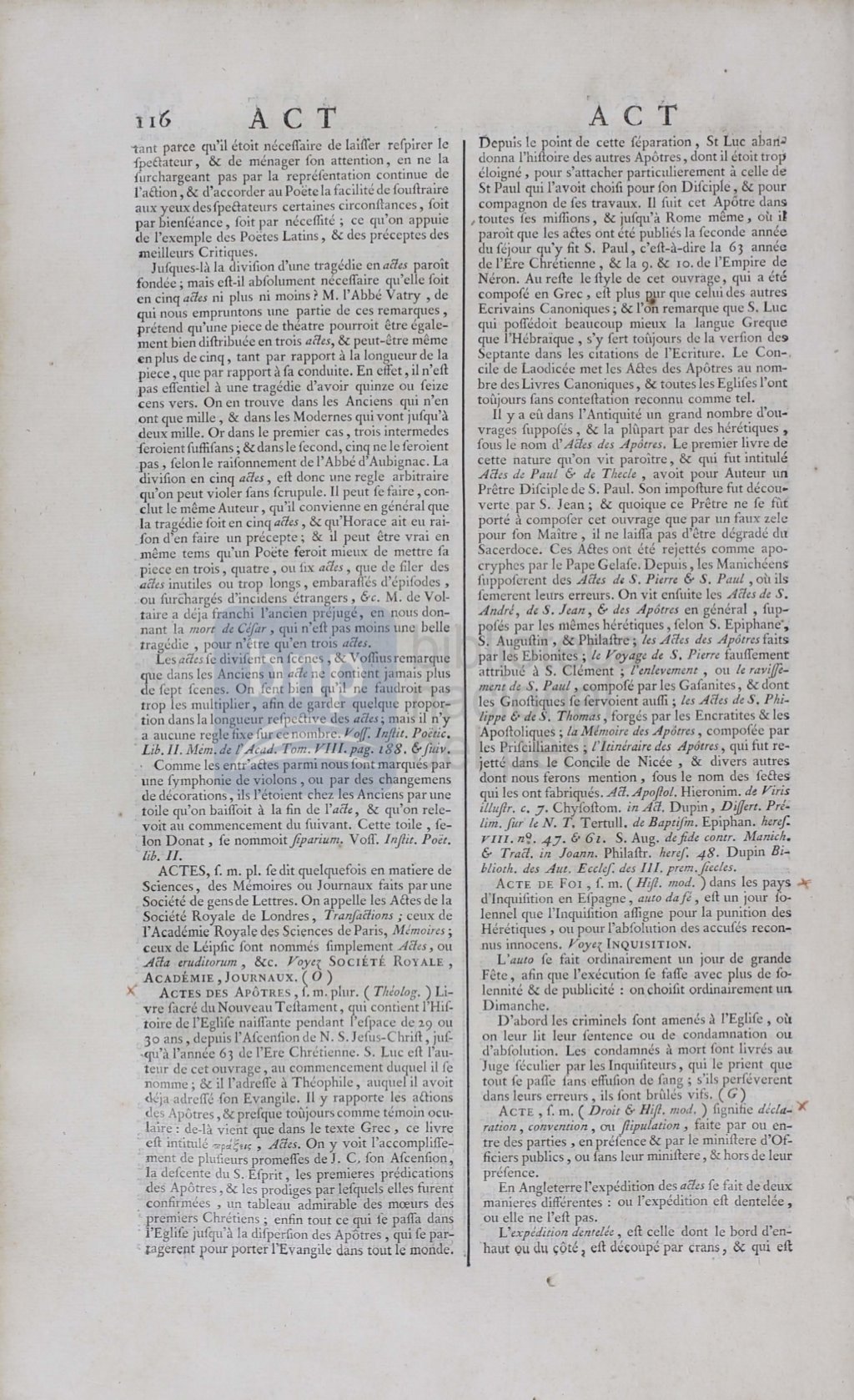
Act
'tant paree qn'il étoit néeeíraire de laiíler refpirer le
{peétateur, & de ménager fon attention, en ne la
{urchargeant pas par la repréfentation continue de
l'aétion, & d'accorder au Poetela facilité de fouftraire
aux yeux desfpeélateurs certaines circonftances , foit
par bienféance, foit par néceffité; ce qu'on appuie
de l'exemple des Poetes Latins, & des préceptes des
meilleurs Critiques.
Jufques-Ulla divifion d'une trapédie en
aCles
parolt
fondée; mais eft-il abfolument neceíraire qu'elle foit
en cinq
ailes
ni plus ni moins? M. l'Abbé Vatry , de
qui nous empmntons une partie de ces remarques,
prétend qu'une piece de théatre pourroit etre égale–
ment bien diftribuée en trois
aCles,
& peut-etre meme
en plus de cinq, tant par rappon
a
la longueur de la
piece, que par rapport
a
fa conduite. En effet, il n'eft
pas eírentiel a une tragédie d'avoir quinze ou feize
eens verso On en trouve dans les Anciens qui n'en
ont que mille,
&
dans les Modernes qui vont jufqu'a
deux mille. Or dans le premier cas, trois intermedes
{eroientfuf!ifans ; & dans le fecond, cinq ne le feroient
pas, felon le raifonnement de l'Abbé d'Aubignac. La
divifion en cinq
aCles,
eft donc une regle arbitraire
qu'on peut violer fans fcmpule. Il peut fe faire ,con–
clut le meme Auteur , qu'il convienne en général que
la tragédie foit en cinq
aCles,
& qu'Horace ait eu rai–
fon d'en faire un précepte;
&
il peut etre vrai en
meme tems qu'un Poete feroit mieux de mettre fa
piece en trois, qnatre , ou
(L"
aCles,
que de filer des
aCles
inutiles ou trop longs, embaraírés d'épifodes ,
ou furébargés d'incidens étrangers,
&c.
M. de Vol–
taire
~
déja franchi I'ancien préjugé, en ll,OUS don–
nant la
mort de Cifar,
qui n'eíl: pas moins une belle
tragédie , pour n'etre qu'en trois
ailei.
Les
aCles
fe divifent en fcenes, & Voffius remarque
que dans les Anciens un
aCle
ne eontient jamais plus
de fept fcenes. On fent bien qu'il ne faudroit pas
trop les multiplier, afin de garder quelque propor–
ríon dans la longueur refpeétive des
aCles;
mais
il
n'y
a aucune regle fixe fur ce nombre.
l/off. In/lit. Poitic.
. Lib.II.Mém.deL'Acad. Tom.VII1.pag.l88. &frtiv.
, Comme les entr'aétes parmi nous font marqués par
une fymphonie de violons , OH par des changemens
de décorations, ils I'étoient chez les Anciens par une
toile qu'on baiíroit a la
fin
de l'
aCle,
& qu'on rele–
voit au commencement du fuivant. Cette toile , fe–
Ion Donat, fe nommoit
jiparium.
Voír.
Injlit. Poc·t.
lih.l1.
ACTES, f. m. pI. fe dit quelc¡uefois en matiere de
Sciences, des Mémoires ou Journaux faits par une
Soeiété de gensde Lettres. On appelle les Aétes de la
Soeiété Royale de Londres,
Tranfaélions;
ceux de
l'
Aeadémie Royale des Sciences de Paris,
Mémoires;
ceux de LéipllC font nommés íimplement
AClu,
ou
ACla erudicorum,
&c.
Voye{
SOCIÉTÉ ROYALE,
. ACADÉMIE, JOURNAUX.
(O)
ACTES DES .APoTRES,
tm.
plur. (
Théolog.
) Li–
vre (¡¡eré duNouveau Teíl:ament, qui eontientl'Hir–
toÍl'e de l'Eglife naiífante pendant l'efpace de
29
ou
3o ans , depuis l'AIcenfion de N. S. Jerus-Chrill, juf–
,qu'a
l'année 63 de l'Ere Chrétienne. S. Luc efi I'au–
tem de cet ouvrage, au commencement duquel il fe
nomme;
&
ill'adreíre a Théophile, auquel
il
avoit
déja adreíré fon Evangile. Il y rapporte les aétions
d~s
Apotres ,& prefque toujours comme témoin ocu–
lalre : de-la vient que dans le texte Gree, ee livre
eíl: intintlé
""pde,,~
,
ACles.
On y voit l'aceompliíre–
ment de plufieurs promeífes de
J.
e
ron AIcenfion,
la defcente du S. Efprit, les premieres prédications
des Apo;res, & les prodiges par lefquels elles furent
confirmees , un tableau admirable des mreurs des
we~er~
Chr,étiens.; enfin tout ce qui ie paíra dans
1
EghCe JUrqll
a
la d¡rperfion des Apotres , qui fe par–
s.ageren t four poner l'Evangile dans tout le monde.
Úepuis le point de cette féparation, St Luc
aban,,)
donna I'hiíl:oire des autres Apotres, dont il étoit
trop
éloigné, pOl1l" s'attacher partieulierement
a
celle de
St Paul qui l'avoit choifi pour ron Difciple , & pour
compagnon de fes travaux. Il fuit cet Apotre dans
, toutes fes miffions, & jurqu'a Rome meme, 01¡
ir
parolt que les aéles ont été publiés la (econde année
du (éjour qu'y fit S. Paul, c'eíl:-a-dire la 63 année
de l'Ere Chrétienne , & la 9. & 10. de l'Empire de
Néron. Au refte le íl:yle de cet ouvrage, qui a été
comporé en Grec, eíl: plus p,ur que eelui des autres
Ecrivains Canoniques; &
l'o~
remarque que S. Luc
qui poífédoit beallcoup mieux la langue Greqlle
que I'Hébra"ique , s'y fert tOlljours de la venlon de9
Septante dans les citations de l'Ecrinlre. Le Con-,
eile de Laodicée met les Aétes des Apotres au nom–
bre desLivres Canonigues, & toutes les Eglifes l'ont
tOLljOurS fans eontefiatlon reeonnu comme te!.
Il ya ell dans l'Antiquité un grand nombre d'ou·
vrages fuppofés, & la plupart par des hérétiques ,
fous le nom d'
ACles des Apótres.
Le premier livre de
cette nature qu'on vit paroltrc, & qui fut intintlé
ACles d. Paul
&
de Theele ,
avoit pour Auteur un
Pretre Difeiple de S. Pau!. Son impoíl:ure fut
décou~
verte par S. Jean;
&
quoic¡ue ce Pretre ne fe fM
porté
a
comporer cet ollvrage que par un faux zelc
pour fon Maltre,
il
ne laiíra pas d'etre dégradé dlI
Sacerdoee. Ces Aétes ont été rejettés comme apo–
cryphes par le Pape Gelafe. Depuis, les Manichéens
rllppoferent des
ACles de
S.
Pierre
&
S .
Paul
, oit ils
femeTent leurs erreurs. On vit enfuite les
ACles de
S.
André, de
S .
Jean,
&
des Apótres
en général , fup–
pofés par les memes hérétiques ,felon S. Epiphane',
S: Augullin, & Philaftre;
Les ACles des Apótrcs
faits
par les Ebionites ;
le Voyage de S . Pierre
fauírement
attribué a S. Clément ;
l'enLevement
, ou
le raviJfe–
ment de S. Paul,
compofé par les Gafanites, & dont
les Gnoíl:iques fe fervoient au1Ii;
les ACles de S. Phi–
lippe
&-
de S. Thomas,
forgés par les Eneratites
&
les
Apoftoliques;
la M émoire des ApiJtres,
compofée par
les Prifcillianites ;
l'IlÍnéraire des Apótres,
qui fut re·
jetté dans le Concile de Nicée,
&
divers autres
dont nous ferons mention, (ous le nom des feétes
qlú les ont fabriqllés.
A Cl. Apojlol.
Hieronim.
tÚ
l/iris
illujlr. c. :J.
Chyroíl:om.
in ACl.
Dupin,
DijJert. Pré.
limo
jiu'
le
N. T.
Ternll1.
de Baptijin.
Epiphan.
heref.
YIlI.
n~.
4:J.
&-
61.
S. Aug.
defide contr. Manich.
&
TraCl. in Joann.
Philaftr.
herif.
48. Dupin
Bi.
bliotlt. des Aut. Ecclif. des 111. prem.jiec!es.
ACTE DE FOI ,
f.
m.
(Hiji. modo
) dans les pays
~
d'Inquifition en Erpagne,
auto dafl,
eíl: un jour (o–
lennel que l'Inc¡uifition affigne pour la punition des
Hérétiques, ou pour l'abColution des aeeufés reeon·
J1US
innocens.
Voye{
INQUISITlON.
L'auto
re fait ordinairement un jour de grande
Fete , afin que I'exéeution fe faíre avec plus de fo–
lennité & de publieité : on choiíit ordinairement un.
Dimanche.
D'abord les crimine1s font amenés
a
l'Eglife , Oll
on lem lit leur fentence ou de condamnation ou
d'abrolution. Les condamnés
11
mort font livrés atI·
Juge féculier par les Inquifiteurs, qlÚ le prient que
tOllt fe paíre fans effufion de fang ; s'ils perféverent
dans leurs erreurs, ils ront brUlés vifs.
(G)
ACTE ,
f.
m. (
Droit
&
Hiji. modo
) fignifie
déela.
X
ralÍon, convention,
011
flipulalÍon,
faite par ou en–
tre des parties , en prélénee & par le miniíl:ere d'Of–
ficiers publics , ou fans leur miniíl:ere,
&
hors de leuT
préfence.
En Angleterre l'expédition des
aéles
fe fait de deux
manieres différentes : ou l'expédition eíl: dentelée,
Oll elle ne I'eíl: pas.
L'expéditioll dmleLée,
efi eelle dont le bord d'en–
ha\)t
QU
dl¡
~9té ~
ea découpé par crans, & qtú efr
















