
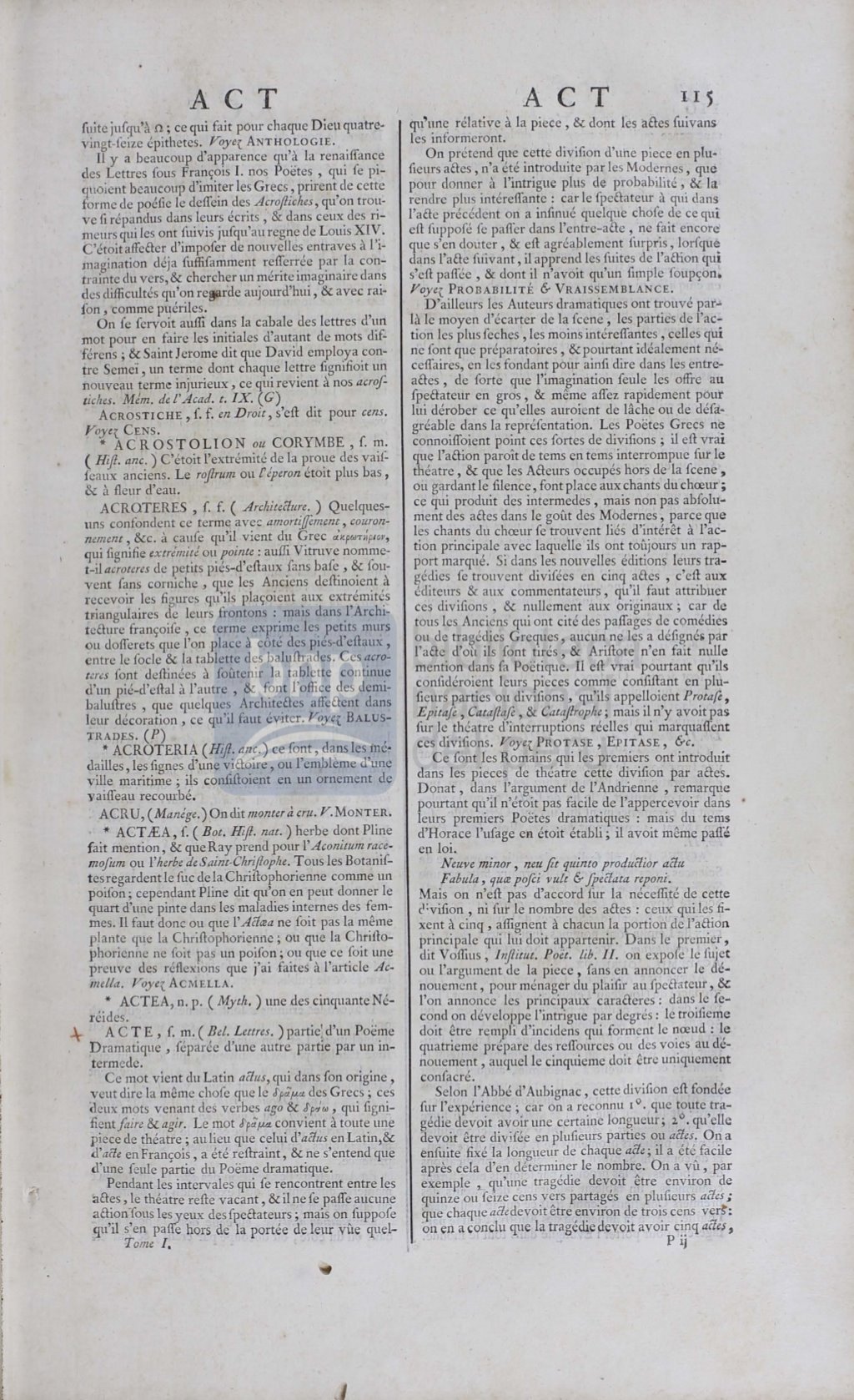
;,
ACT
fuite
jufqu'~
n; ee qui fait pour ehaque Dieu quatre–
vingt-Ceize épithetes.
Voy~{
A THOLOGIE.
II y a heaueoup d'apparenee qu'it la renai/fanee
des Lettres
Cous
Fran~ois
1.
nos Poetes , c¡ui
Ce
pi–
quoient heaueoup d'imiter les Grees, prirent de eette
forme de poélie le de/fein des
AcroJiiclles,
qu'on trou–
ve fi répandus dans leurs écrits ,
&
dans ceux des ri–
meurs (Iui les onr Cuivis jufqu'all regne de Louis XIV.
C'étoitalfeél:er d'impoCer de nouvelles entraves
a
1'i–
magination déja Cuffifarnment re/ferrée par la con–
trainte du vers,& ehereher un mérite imaginaire dans
des difficultés qu'on re¡Jarde aujourd'hui, & avee rai–
fon, comme puériles.
On fe fervoit auffi dans la cabale des lettres d'un
mot pour en faire les initiales d'autant de mots dif–
férens; & SaintJerome dit que David employa con–
tre Semel, un terme dont ehaque lettre lignifioit un
nouveau terme injurieux, ce qui revient
a
nos
acroJ–
tiches. M.!.m. deL'Acad.
t.IX.(G)
ACROSTI CHE,
f.
f.
en Droit,
s'eíl: dit pour
CeTlS.
Voye{
CENSo
*
ACROSTOLION
OU
CORYMBE,
f.
m.
( Htjt.
anc.
)
C'étoit l'extrémité de la proue des vai!:
leaux anciens. Le
roJlrum
ou
féperon
étoit plus has ,
&
a
fleur d'eau.
ACRQTERES ,
C.
f. (
Architeélllre.
)
Quelques–
uns confondent ce term€!
ave~
amortijJement, couron–
mment,
&c.
a
cauCe qu'il vient du Grec
d>.p"''';;pm,
'lui íignifie
extrémité
Ol!
pointe
:
auffi Vitmve nomme–
t-ilacroteres
de
pe~its
piés-d'eíl:aux Cans haCe, & Cou–
vent fans corniche, que les Anciens deilinoient
a
recevoir les figures qu'ils
pla~oieut
amc extrémités
uiangulaires de leurs frontons : mais dans l'Archi–
teél:ure
fran~oiCe
, ce terme exprime les petits murs
Ol! do/ferets que l'on place
a
coté des piés-d'eíl:aux ,
entre le Cocle & (a tahlerte des haluíl:rades. Ces
acro–
t~r"s
Cont defunées a Coutenir la tahlette continue
d'un pié-d'eíl:al
a
l'autre , & font l'office des demi–
baluíl:res , que quelques Architeél:es affeél:ent dans
leur décoration, ce qu'il fam év·iter.
Voye{
BALUS–
¡RADES.
(P)
*
ACROTERIA
(Hijl.
anc.)
ce font, dans les filé·
dailles, les fignes d'une viél:oire, ou l'embleme d'une
ville maritime ; ils confúl:oient en un ornement de
vaiífeau recomhé.
ACRU,
(Manége.)
On dit
monter
a
cm. V.
MONTER.
*
ACT
JEA,
f. (
Bot.
Hijl.
nato
)
herhe dont Pline
fait mention, & queRay prend pour l'
Aconitum mce–
mojitm
ou
l'hube deSaint-Clzrijloplze.
TOllS les Botanif–
tesregardentle fue dela Chriíl:ophorienne comme un
poiCon; cependant Pline dit qu'on en peut donner le
<Iuart d'une pinte dans les maladies internes des fem–
mes. Il faut donc ou que
l'Aéla!a
ne foit pas la m&me
plante que la ChriO:ophorienne ; ou que la Chriíl:o–
phoricnne ne {oit pas un poifon; ou que ce {oit une
preuve des réflexions que j'ai faites
a
l'artiele
Ac–
mella. Voye{
ACMELLA.
*
ACTEA, n. p.
(Mytlz.
)
une .des cinquante Né–
réides.
k
A C TE,
f.
m. (
Bet. Lettres.
)
partie: d'un Poeme
. D ramatique , Céparée d'une autre partie par un in–
termede.
Ce mot vient du Latin
aélus,
qlÚ dans
Con
origine,
veut dire la m&me choCe que le
d'pafW-
des Grecs ; ces
<lcux mots venant des verbes
ago
&
d'p';",
,
C{1ú figni–
fientfoire &
agir.
Le mot
d'pafW-
convient
a
toute une
piece de théatre ; aulieu C{1le celui d'
aélus
en Latin,&
¿'aue
en
Fran~ois,
a été reíl:raint, & ne s'entend que
cl'une fcule partie du Poime clramatique.
Pendant les intervales qui Ce rencontrent entre les
aél:~s,
le théatre reíl:e vacant, &
iI
ne Ce pa/fe aucune
aél:~on
Cous lesyeux des {pcél:ateurs; mais on Cuppo[e
.qn'i1 s'en pa(fe hor5 de la pOltée de leur vlle que!-
Tome
J.
ACT
lIS
C{11'nne rélative it la piece , & dont les aél:es Cuivans
les informeront.
On
préten~ q~l~ ~ette di~ifion
d'une piece en pln–
íieurs aél:es , n a ete II1trodllltc par les Modernes C{1le
pour donner
a
l'intrigue plus de probabilité,'& la
rendre plus intére([ante : car le Cpeél:atem
a
qui dans
l'aél:e précédent on a infU1Ué quelC{1le
choCe
de ce qui:
cíl: {uppoCé fe pa/fer dans I'entre-aél:e, ne fait encore
que s'en douter ,
&
eíl: agréablement furpris, lorfc¡ue
dans l'aél:e Cuivant, il apprend les Cuites de l'ailion qui
s'eO: pa/fée ,
&
dont
iI
n'avoit qu'un íimple Coupc;:on.
I/aye{
PROBABlLITÉ
&
VRAISSEMBLANCE.
D'ailleurs les Auteurs dramatiques 011t trouvé
pat~
la le moyen d'écalter de la fcene, les parcies de l'ac–
tion les plus Ceches , les moins intéreífantes , celles
c¡ui
nc Cont que préparatoires , & pourtant idéalement né–
ce/faires, en les fondant pour ainfi dire dans les entre–
aél:es, de Corte C{1le l'imagination feule les olfre au
Cpeél:ateur en gros,
&
m&me aífez rapidement pOllt
lui dérober ce qu'elles auroi nt de
l~che
ou de déCa–
gréable dans la repréCentation. Les Poetes Grecs ne
connoiífoienr point ces Cortes de divifions;
il
eíl: vrai
C{1le l'aél:ion parolt de tems en tems interrompue Cut le
théatre, & que les Aél:eurs occupés hors de la Ccene ,
ou gardant le Ctlence, font place aux chants du chreur ;
ce C{1li produit des intermedes , mais non pas abfolu–
ment des aél:es dans le gOllt des Modernes, paree que
les chants du chreur Ce trouvent liés d'intéret
a
l'ae–
tion principale avec laC{1lelle ils ont toujours un rap–
port marqné. Si dans les nonvelles éditions leurs tra–
&é~ies
Ce trouvent diviCées en cinq
~él:es
, c'eO: aux
edltellTs
&
anx commentateurs, qtl'¡[ faut attribuer
ces divifions, & nullcment allx originanx; car de
tous les Ancicns qui ont cité des pa/fages de comédies
ou de tragédies Greques, aucnn ne les a défigné, pár
l'aél:e d'oll ils Cont tirés ,
&
Ariíl:ote n'en fait mtlle
mention dans Ca PoetiC{11e.
Ii
eíl: vrai pourtant C{11'ils
coníidéroient leurs pieces comme coníiíl:ant en plü–
fieurs parties 011 divifions, qu'ils appelIoient
Prota(t,
Epitaft
,
CataJlaft
,
&
CataJlroplze;
mais
iI
n'y <;lvoit pas
Cur le théatre d'interruptions réelles qui marC{11aífent
ces divilions.
Voye{
PROTASE, EPITASE,
&c.
Ce Cont les Romains C{1Ü les premiers ont introduit
dans les pieces de théatre cette diviíion par aél:es.
D onat, dans I'arglllnent de l'Andrienne , remarC{11e
pourtant qn'il n'étoit pas facile de l'appercevoir dans
leurs premiers Poetes dramatiC{1lCs : mais du tems
d'Rorace l'uCage en étoit établi;
il
avoit m&me palle
en loi.
Neuve minor,
~eu
jit quinto produClior aélu
Fabula, 'lila! poJci
Vlllt
&
jiJeélata reponi.
Mais on n'eíl: pas d'accord úlr la néceffité de cette
c':viíion , ni fur le nombre des aél:es : ceux (Iuiles
{j–
xent
a
cinq , affignent a chacun la portion de I'aétion
principale C{1IÍ lui doit appartenir. Dans le premier,
dit Voffius,
171jliLUt.
Poil. Lib. Il.
on expo[e le {njet
ou I'argument de la piece, fans en annoncer le dé–
nouement, pour ménager du plai{u' auIpeél:ateur ,
&
I'on annonce les principaux caralteres: dans le fe–
cond on développe l'intrigue par degrés : le troilieme
doit &tre rempli d'incidens qui forment le nreud : le
quatrieme prépare des re/fources 011 des voies au dé–
nouement, auque! le cinC{1úeme doit &tre uniC{11ement
con(acré.
Selon l'Abbé d'Aubignac, cette diviíion eíl: fondée
Cur l'expérience; car on a reconnu
10.
que toute tra–
gédie devoit avoir une certaine longueur;
1
ó.
qu'elle
devoit &tre diviCée en pluíieurs parties ou
aéles.
On a
en[uite lixé la longuellr de chaque
aEle;
il a éié facile
apres cela d'en déterminer le nombre. On a vll, par
exemple , qll'lIne trag¿die devoit &tre environ de
qllinze 011 (eize cens vers partagés en plllfieurs
aéles ;
que chaC{1le
aéledevoit
&tre environ de trois cens
ver~:
en en a condu cIue la tragédiedevoit avoir cinc¡
aéles,
.
,
P
ij
















