
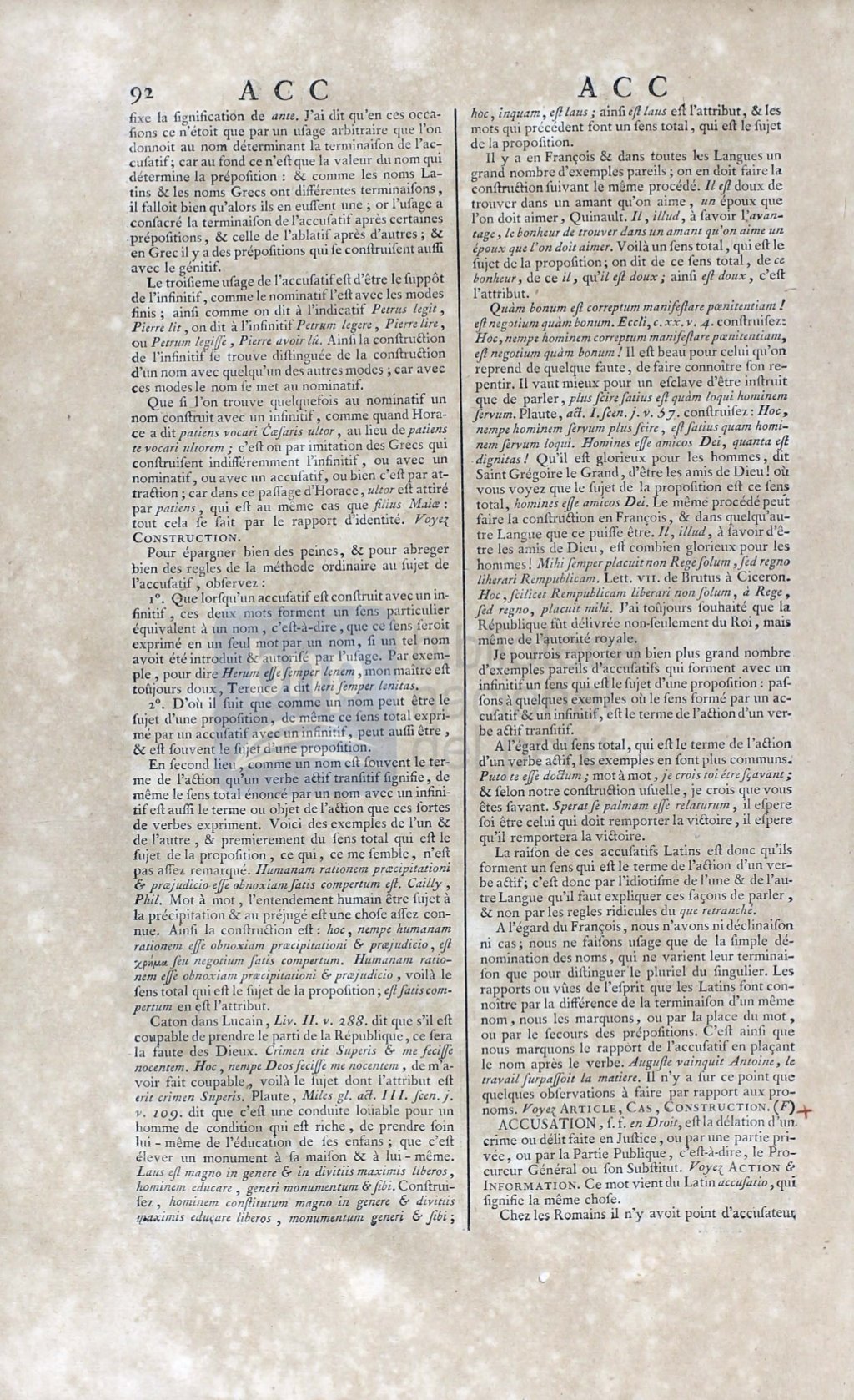
AGC
nxe [a fignificatjon de
ante.
J'ai dit qu'en ces occa–
{¡ons ce n'étoit que par un uCage arbitraire que 1'on
donnoit au nom déterminant la terminaiCon de I'ac":
cufatif; car au fond ce n'eíl: que [a va[eur du nom qui
détermine la prépofition;
&
comme les noms La–
tins
&
les noms Grecs ont différentes terminaiCons ,
il faHoit bien qu'alors ils en eu{[ent une; or 1'ufage a
confacré la terminaifon de I'accufatif apres certaines
.prépofitions,
&
celle de I'ab[atif apres d'autres;
&
en Grec
il
y a des prépofitions qui fe confuuifent auffi
avec le génitif.
Le troifieme ufage de I'accufatifeíl: d'etre le fuppat
de l'infinitif, comme le nominatif1'eíl:avec les modes
finis; ainfi comme on dit a I'indicatif
Petrus Legie,
Pierre lit,
on dit
a
I'infinitif
Punan legere, Pierre tire,
ou
Petrwn legiffe, Pierre ayoir lú.
Ainfi la confuuaion
de I'infinitif
te
trouve diíl:inguée de la confuuélion
d'un nom avec quelqu'un des aun·es modes ; car avec
ces modesle nom fe met au nominatif.
Que fi l'on trouve quelquefois au nominatif un
nom 'coníl:ruit avec un infinitif, comme quand Hora–
.ce a dit
paeiens vocari C:tzfaris ultor,
au lieu de
patiens
te
vocari ultorem;
c'eíl: on par imitation des Grecs qui ,
coníl:ruifent indifféremment l'infinitif, ou avec un
nominatif, Ol! avec nn accufatif, ou bien c'eíl: par at–
traélion; cay dans ce pa{[age d'Horace,
ultor
eíl: attiré
par
patiells,
qui eíl: au meme cas que
filius lt1:ure:
tout cela fe fait par le rapport d'identité.
Voye{
CONSTRUCTION.
Pour épargner bien des peines,
&
pour abreger
bien des regles de la méthode ordinaire au fujet de
l'accu(atif, ob(ervez. ;
1°. Que lorfqu'tm accu(atifeíl: coní1:mit avec un in–
nnitif , ces deux mots forment un fens particulier
équiválent a un nom , c'dl-a-dire, que ce fens íeroit
exprimé en un (eul mot par un nom, fi un tel nom
avoit été introduit
&
autorifé par I'u(age. Par exem–
pIe, pour dire
Herum
effe
femper lenem
,
mon maitre eíl:
tOlljours doux, Terence a dit
herifemper Imitas.
2°.
D'Oll i[ ñút que comme un nom peut etre le
fujet d'une propofition, de meme ce fens total expri–
mé par un accufatif avec un infinitif, peut auffi etre ,
&
eíl: fonvent [e fujet d'une propofition.
En (econd lieu , comme un nom eíl: fouvent le ter–
me de I'ailion qu'un verbe aélif tranfitif fignifie, de
meme le (ens total énoncé par un nom avec un infini–
tifeíl: auffi le terme ou objet de I'aélion que ces fortes
de verbes expriment. Voici des exemples de I'un
&
de l'autre ,
&
premierement du fens total qui eíl: le
fujet de la propoíition, ce qui, ce me femble, n'eíl:
pas a{[ez remarqué.
Humanam ratlonem prrecipitatloni
&
prlZjudicio·eJfe obnoxiamfatis comptrtum
ejl.
Cailly,
Pltil.
Mot 11 mot, I'entendement humain etre fujet
a
la précipitation
&
au préjugé eíl: une chofe aífez. con–
nue. Ainíi la confuullion eíl;
hoc, nempe Itumanam
rationem eJfe oblloxiam prrecipitationi
&
prrejudicio, ifl
XP~p.<Lfeu
negotium fatis comptreum. Humanam ratio–
nem
effi
obnoxiam prlEcipitationi
&
prlZjudicio
,
voi[¡} le
fens total qui eíl: le fujet de la propoíition;
iflfatiscom–
peTtltm
en <;íl I'attribut.
Caton dans Lucain,
Liv.
IJ.
v.
2.88. dit que s'il eíl:
cmlpable de prendre le parti de la République, ce fera
- la faute des Dieux.
Crimm erit Superis
&
me ficiffe
nocentem. Hoc, nempe D eosficiffe me nocentcm,
dem'a–
voir fait coupable" voila [e tiljet dont I'attribut eíl:
trit crimen Superis.
Plaute,
Miles gl. aél. J ¡l. fcen. j.
v.
l09.
dit que c'eíl: une conduite loiiable pom
1m
homme de condition qui eíl: riche, de prendre foin
lui - meme de I'éducation de fes enfans ; que c'eíl:
élever un monument 11 (a maifon
&
a lui - meme.
Laus eJI magno in genere
&
in diviliis maximis liberos,
hominem educare , gener; monumentum
{/
jibi.
Coníl:rui–
fez. , .
/z?minem COlljlitutum magno in genere
&
divitiis
'~/mIS
edl/(are liberos
,
mOllumentitm reneri
&
jibi ;
A
e e ,
hllC,
¡nquam, eJIlaus
;
ainfi
.fllalls
eit I'attribut,
&
les
mots c¡ui précédent font un fens total, qui eíl: le fujet
de [a propofirion.
Il y a en Frans:ois
&
dans toutes les Langues un
grand nombre d'exemples pareils ; on en doit faire la
conftrullion fuivant le meme procédé.
11
eJI
doux de
trouver dans un amant qu'on aime,
un
éponx que
l'on doit aimer, Quinault.
Ji,
illud,
a
(avoir
I:ayan.
lage,
le
bonhellrde trouver dans un amant qu'on aimt un
épcux que
1'011
doie aimer.
Voila un fens total, qui eíl: le
fujet de la propoíition; on dit de ce fens total, de
ce
bonheur,
de ce
il,
qu'
il ifl doux;
ainíi
ifl doux,
c'eíl:
l'atttibut. '
Qllam bonum ifl corrept/lm manifejlare
p~nitt1ltiam
!
ifl
neg~lium
qllam bonum.E
ccJi,~.
xx. v .
4. coníl:rui(ez.:
Hoc,
lIempe
hominem corraptum mallifijlare
p~nitentiam,
ejl negotlum qllam bonwn!
Il eíl: beau pour celui qu'on
. reprend de quelque fante, de faire connoitre fon re–
pentir. II vaut mieux pour un e(c!ave d'etre iníl:ruit
que de parler,
plusfcirefatius
ejl
'luam loqui /zominem
fervum.
Plaute,
aél. l.fcm.j. v.
"J.
conílmifez.;
Hoc,
nempe Itominem fervum plusfeire,
ejl
fatius quam !!Omi–
nem flrvum loqui. Homines e.f!e amicos D ei, qZLanta e{l
.
dignitas!
Qu'il eíl glorieux pour les hommes, dit
Saint Grégoire le Grand, d'etre les amis de Dieu! ou
vous voyez. que le (ujet de la propoíition eíl ce fens
total,
IlOmines efle amicos Dei.
Le meme procédé peút
faire la coníl:nfélion en Frans:ois,
&
dans quelqu'an.
tre Langue que ce puiífe.etre.
JI, illud,
a favoir d'e–
tre les amis de Dien, eíl: combien glorieux pom les
hommes!
Mihifemperplacultnon Regefolum ,fedregno
li/zerar; R empublicam.
Lett.
VII.
de Bmtus 11 Ciceron.
Hoc ,feilicet Rempublicam liberari nonfolum ,
ti
R ege,
fed regno, placult mi"i.
J'ai toújours fouhaité que la
République fí'¡t délivréc non-feulcment du Roi, mai,¡
meme de I'¡¡utorité royale.
J
e pourrois rapporter un bien plus grand nombre ,
d'exemples pareils d'accufatifs qui forment avec un
innnitifun fens qui eíl: le fujet d'une propoíition; pa{.
fons 11 quelques exemples OÜ le fens formé par un ac–
cufatif
&
un infinitif, eíl: le terme de l'aélion d'un
ver~
be alliftranfitif.
A l'égard du fens total,
ql.lieíl: le terme de
1
'aélion
d'un verbe ailif, les exemples en font plus communs.·
Pueo te eJfe doélum;
mot
a
mot,
je crois loi éerefiavant;
&
felon notre confuuélion u(uelle, je crois quevous
etes favant.
Speraefe palmam
effo
relatumm,
il
efpere
foi etre celui c¡ui doit remporrer la viéloire, il efpere
qu'il remportera la viéloire.
La raiíon de ces accufatifs Latins eíl: donc qu'ils
forment un fens qui eíl: le terme de I'aélion d'un ver–
be aélif; c'eíl: donc par I'idiotifme de I'une
&
de I'au–
treLangue qu'il faut expliquer ces fas:ons de
~arler,
&
non par les regles ridicules du
que retranc/ze.
A I'égard dll Frans:ois, nous n'avons ni déclinaifon
ni cas; nous ne faiCons lI(age que de la funple dé–
nomination des noms, qlli ne varient leur terminai–
fon que pour diílinguer"le pluriel du íingl.llier. Les
rapports ou vúes de l'efprit que les Latins font con–
noitre par la di/férence de la terminaifon d'un meme
nom, nous les marquons, ou par la place du mot,
ou par le fecollrs des prépofitions. C'eíl: ainíi que
nous marquons le rappórt de l'accufatif en plas:ant
le nom apres le verbe.
Augujle vainquil Antoine,
l~
travailfurpaffoit la marlere.
Il n'y a fur ce point que
que[ql.les obCervations
a
faire par rappon
al.lxpro–
noms.
Yoye{
ARTICLE, CAS, CONSTRUCTION.
(F)+
ACCUSATION,
C.f.
m
Droie,
eíl:ladélationd'tm.
,rime ou délitfaite en
J
uíl:ice , ou par une partie pri–
vée, ou par la Partie Publique, c'eíl:-a-dire , le Pro–
cureur Général ou fon Subílinlt.
Yoye{
ACT10N {/
INFORMATION. Ce motvientdu Latinaccufaeio,c¡ui
íignifie la meme chofe.
Cbez.les Romains
il
n'y avoit point d'acciúatew;
















