
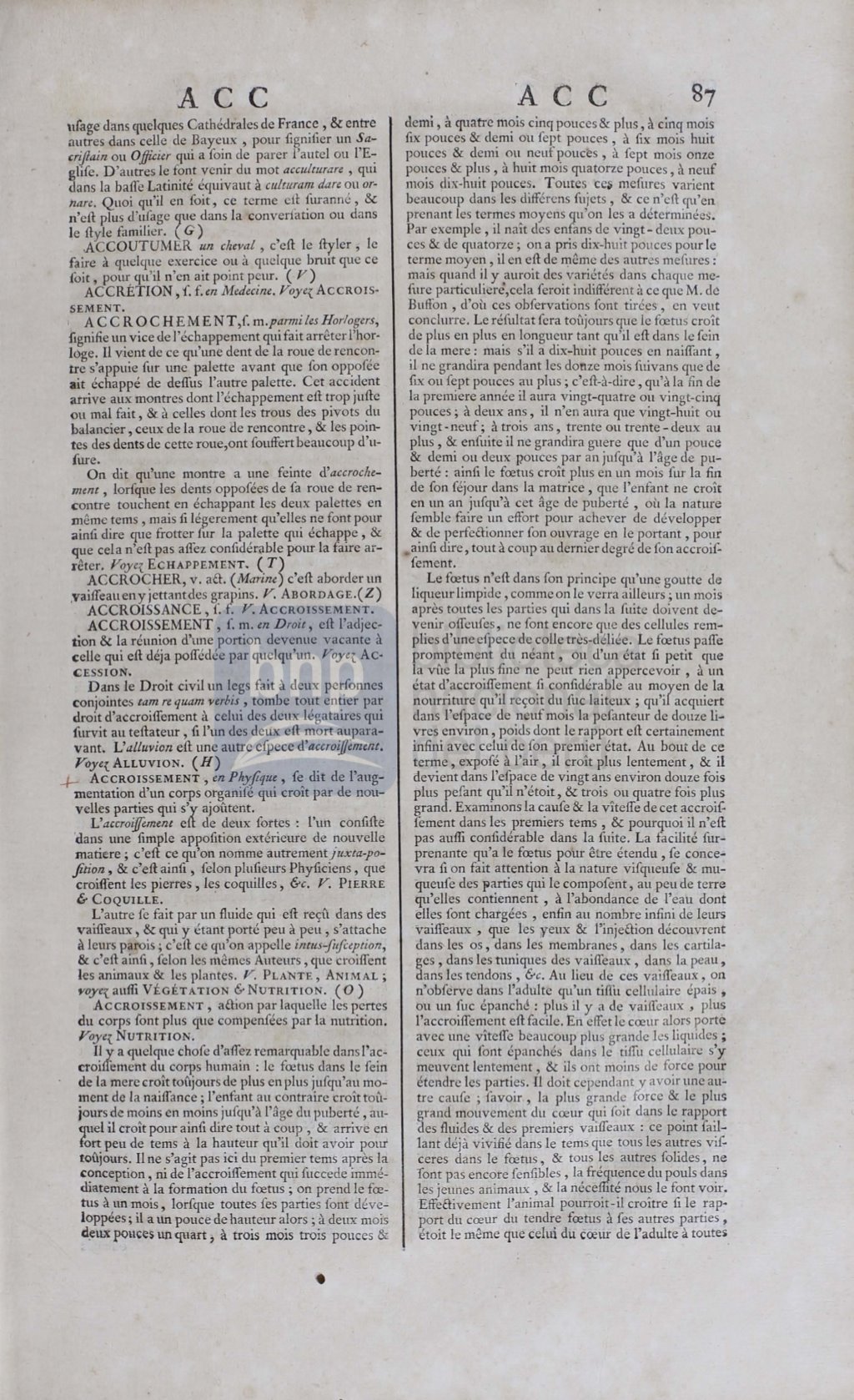
ACC
nfage dans quelques Cathédrales de Franee ,
&
entre
nutres dans celle de Bayeme , pour úgniúer un
Sa–
crijlain
ou
O.fficier
qui a foi.n de parer l'autel ou I'E:
glife. D'alltres le font vemr du mot
acculturare
,
qUl
dans la baífe Lariruré équivaut
a
culturam dare
ou
or–
hare.
Quoi qu'il en foit, ce rerme eíl: furanné ,
&
n'eíl: plus d'tifage
~ue
dans la eonverfarion ou dans
le íl:yle familier. \
G)
ACCOUTUMER
un clleval
,
e'eft le fryler, le
faire
a
qllelque exereice Olt
a
quelque bfUlt que ce
(oit, pour qu'il n'en ait poin! peur.
(r)
ACCRÉTION
,f.
f.
en Medecine. Voye{
ACCROIS–
SEMENT.
, A C C R OC HEMENT,f.
m.parmiles Hor1ogers,
fignifie un vice de]'éehappement quifait arr&rer l'hor–
lóge.
n
vient de ce qu'une denr de la roue de reneon–
tre s'appuie fur une palette avant que fon oppofée
ait éehappé de deífus I'autre palette. Cer aeei.dent
arrive aux monrres dont I'éehappement eft trop Jufte
ou mal fait, &
a
eelles dont les rrous des pivots du
balancier, eeux de la roue de reneontre , & les poin–
tes des dents de eette roue,ont fouffert beaucoup d'u–
Cure.
Ondit qu'une montre a une feinte
d'accroclle–
ment,
lorfque les dents oppofées de fa rone de ren–
contre touehent en éehappant les deux palettes en
meme tems , mals ú légerement qu'elles ne font pour
ainú dire que frotter fur la palette qui éehappe, &
que cela n'eft pas aífez eoníidér<1ble pour la faire
ar–
r&ter.
Voye"
ECHAPPEMENT.
( T )
ACCROCHER,
v.
aél.
(Marine)
e'eft aborderun
,vaiífeauenyjettantdes grapins.
V.
ABORDAGE.(Z)
ACCROISSANCE, f. f.
V.
ACCROISSEMENT.
ACCROISSEMENT, f. m.
en Droit,
eft I'adjee–
tion
&
la rénruon d'une portion devenue vacante
a
celle qui eft déja poífédée par quelqu'un.
Voyet
Ac–
CESSION.
Dans le Droit eivilnn legs fait
a
denx perfonnes
conjointes
tam
re
quam verbis
,
tombe tout entier par
moit d'aceroiífement
a
eelui des deux légataires qui
fnrvit au teftateur , ú l'tm des delix eft mort aupara–
vant. L'
alluvion
eft une autre efpeee d'
accroiflement.
Veye{ALLUVION.
( H)
-l-
ACCROISSEMENT,
en Phyfique,
fe
dit
de l'aug–
mentation d'un eorps organifé qui eroit par de nou–
velles parties qu'i s'y ajoutent.
L'accroiJJement
eft de deux fortes: l'un eonfille
'dans ul1e úmple appoíition extérieure de nouvelle
rnatiere; e'eft ce qu'on nomme
autrementjuxta-po–
fttion
,
& e'eft ainú, felon plllfieurs Phyúeiens, que
croiífent les piertes ) les eoquilles,
&c.
V.
PIERRE
&
COQUILLE.
L'autre fe fait par 1m fluide qlli eft re¡;u dans des
vaiífeaux,
&
qui Y étant porté peu
a
pell , s'attaehe
a
leurs parois; e'eft ce qu'on appelle
intus-jitfteption,
& e'eft ainfi, felon les m&mes Auteurs, que croiífent
les animaux& les plantes.
V.
PLANTE, ANIMAL;
""oye,,
auffi VÉGÉTA.TION
&
NUTRITION.
(O)
ACCROISSEMENT, ailion par laquelle 'les pertes
du eorps font plus qlte eompenfées par la nutrition.
Voye"
NUTRITION.
Il y a quelque chofe d'afi'ez remarquable dansl'ae–
croiífeme'nt du eor13s humain : le fcetus dans le fein
de la mere erol! tOlIjours de plus en plus jufqu'au mo–
ment de la naiífanee; I'enfant au eontraire t:rolttou–
jours de moins en moins jufqu'a I'age du puberté , au–
<{uel
il
eroit ponr ainfi dire tout it coup ,
&
arrive en
f{)rt
peu de tems
a
la hauteur qn'il cloit avoir pou!'
tofijours. II ne s'agit pas iei du premier tems apres la
c?neeption, ni de l'aeeroiífemem qui fueeede immé–
diatement
a
la formation du fcenls ; on prend le fce–
tus
a
1mmois, lorfque toutes fes parties font déve–
loppées; il a un pouee de hautenr alors ;
a
deux mois
d~ux
PQuees
unquart,
a
trois mois trois pouces
&
•
'A
e e
demi ,
a
quatre m?ís einq pouees
&
plus,
a
cinq mois
úx pouees
&
demI OH fept ponces,
a
fu mois huit
pouces & demi ou neufpouees ,
a
fept moís onze
pOl~ees.& pl~ls
,
a
huit mois quatorze pouces ,
a
nenf
Jl101S
dlx-hUlt pouees. Toutes ces mefmes varíent
beaueoup dans les différens fujets , & ce n'eft qu'en
prenanr les termes moyens qu'on les a
déterminée~.
Par exemple, il nait des enfans de v'ingt- deux pou–
ces
&
de c¡uatorze; on a pris dix-huit pouees pour le
terme moyen , il en eft de m&me des autres mefnres :
mais quand il y auroit des variétés dans chaque me–
fme partieulieré,eela feroit indifférent
a
ce que M. de
Btlffon , d'oil ces obfervations font tirées, en vent
eonclUlTe. Le réfultat fera tOltjOlITS que le fcetus erolt
de plus en plus en longueur tant qu'il eft dans le fein
de la mere: mais s'il a dix-huir pouees en naiífant ,
il ne grandira pendant les dome mois fuivans que de
fu ou fept pouees au plus; e'eíl:-a-dire, qu'a la fin de
la premiere année il aura vingt-quatre ou vingt-cinq
pouees;
a
deux ans, il n'en aura que vingt-huit ou
vingt -neuf; a trois ans, trente ou trente - deux au
plus, & enfuite il ne granclira guere que d'un pouee
&
demi ou deux pouces par an jufqu'a I'age de pu–
berté : ainú le fcetus eroit plus en un mois fur la fin
de fon féjom dans la matriee, que l'enfant ne erolt
en un an jufqu'a eet age de puberté , oil la nature
femble faire un elFort pour aehever de développer
&
de perfeélionner fon ouvrage en le portant , pour
ainú dire, tout
a
eoup au dernier degré de fon aeeroif·
fement.
. Le fce.tus
~'eft
dans fon prineipe
q~1'une
goutte de
hqueur hmplde ,eomme on le yerra ailleurs ; un mois
apres toutes les parties qui dans la fuíte doivent de–
venir oífeufes, ne font eneore que des eellules rem–
plies d'uneef¡)eee de eolle
tn~s-déliée.
Le fcenls paífe
promptement du .néant, ou d'un état íi petit que
la ví'te la plus fine ne peut rien appercevoir ,
a
un
état d'aeeroiífement ú eonúdérable au moyen de la
nourrinrre qu'i1 re¡;oit du fue laiteux ; qu'il aequiert
dans l'efpaee de neuf mois la pefanteur de douze
li–
vres environ , poids dont le rapport eft eertainement
infini avee eelui de fon premier état. Au bout de ce
terrne , expofé
a
I'air, il erolt plus lentement,
&
il
devient dans I'efpaee de vingt ans environ dome fois
plus pefant c¡u'iln'étoit,
&
u'ois ou quatre fois plus
grand. Examinons la eaufe
&
la viteífe de eet aeeroif.
fement dans les prerniers tems ,
&
pourqnoí il n'eft
pas auffi eonúdérable dans la fuite. La facilité fur–
prenante qu'a le fcenls pour eU'e étendu , fe eonee–
vra
fi
on fait attention
a
la nature vifqueufe
&
mu–
queufe des
~arties
qui le compofent, au peu de terre
qu'ell'es eontlennent ,
a
l'abondanee de l'eau dont
elles font ehargées , enfin au nombre infini de leurs
vaiífeatu , que les yeux
&
l'injeilion découvrent
dans-les os, dans les membranes, dans les earrila–
ges, dans les tuniques des vaiífeaux, dans la peau,
dans les tendons ,
&c.
Au lieu de ces vaiífeaux , on
n'ohferve dans l'adulte qu'un tifi'u eellulaire épais ,
ou un fue épanehé : plus
il
y a de vaiífeaux , plus
l'aeeroiífement eft faeile. En e/fet le ecem alors porte
avee une viteífe beaueoup plus grande les liquides;
ceux qui font épanehés dans le riífu eellulaire s'y
menvcnt lentement,
&
ils ont moins de force pour
étendre les parties.
11
doit eependant
y
avoir une au–
tre eaufe ; favoir, la plus grande force
&
le plus
grand mouvement du eceur qui foir dans le rapport
des fluides & des premiers vaiífeaux : ce point fail-
1ant déjit vivifié dans le temsque tous les autres vif–
eeres dans le fcetus ,
&
tous les autres folicles , ne
Tont pas eneore feníibles , la fréC¡llence du pouls dans
les jeunes anima11X ,
&
la néceffité nous le font voir.
E/feélivement I'animal pGurroit-il eroitre
fi
le rap–
port du cceur du tendre fcetus
a
fes autres parties .
étoit le m&me que celui du eceur de l'adulte
a
toute~
















