
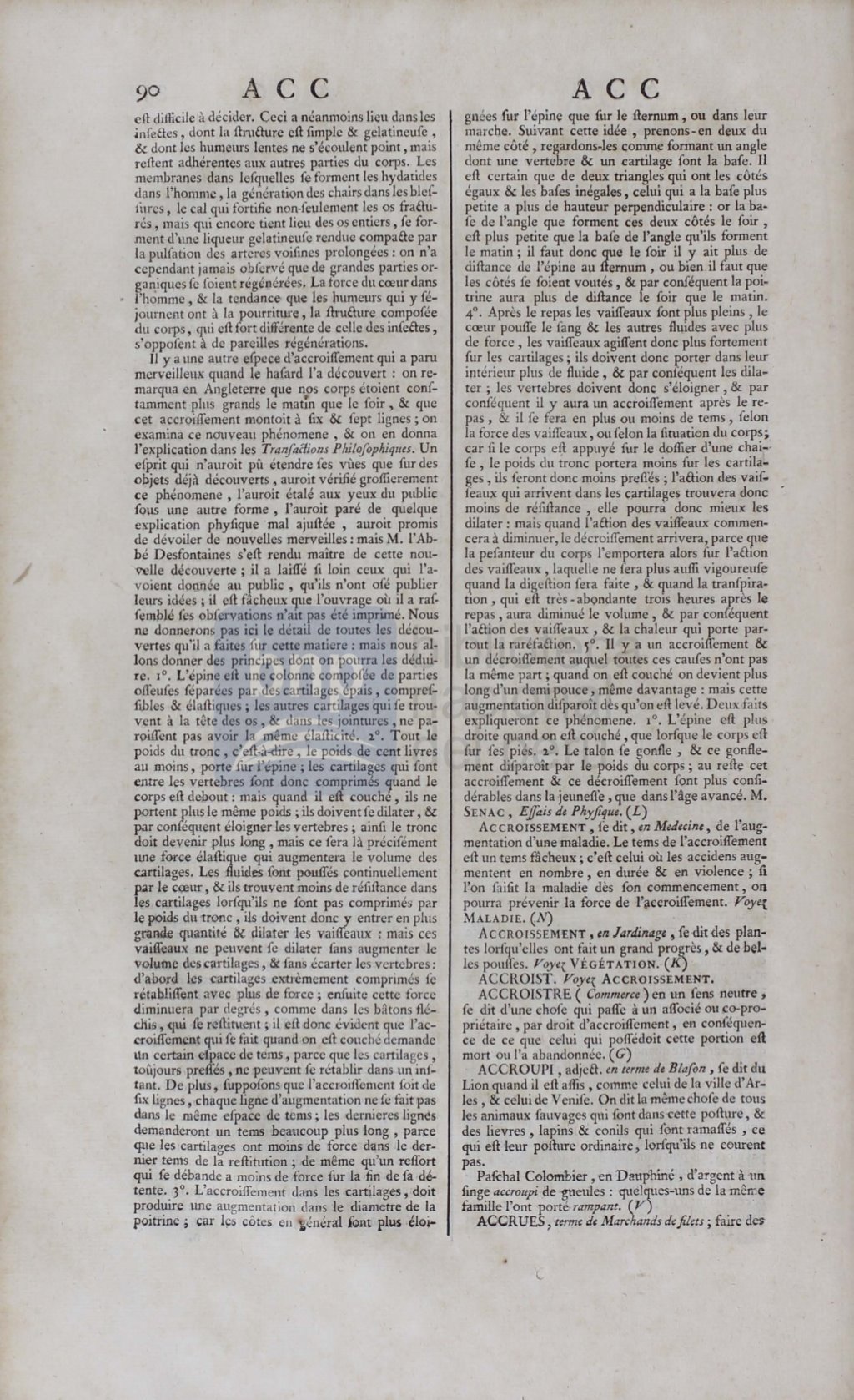
/
ACC
dI:
difficile
a
décider. Ceci a néanmoins lieu dans les
infeétes , dont la ftméture efr f11l1ple
&
gelatinelúe ,
&
dont les humeurs lentes ne s'écoulent point, mais
refrent ad,hérentes aux autres pat1ies du corps. Les
membranes dans lefquelles fe forment les hydaticles
dans l'homme, la génération des chairs dans les blef–
litres, le cal 'lui fortine non-feulement les os fraétu–
rés , mais c¡ui encore tient líeu des os entiers , fe for–
ment d'tlOe liqueur gelatineufe rendue compaéte par
la pulfation des arteres voifines prolongées: on n'a
cependant jamais obf, rvé que de grandes parties or–
ganiques fe foient régénérées. La force du C<Eur dans
I'homme ,
&
la tendance que les hllmeurs qui
y
fé–
jOllrnent ont
a
la pourrinu·e, la frruéture compofée
du COI-ps, qlÚ efrfort différente de celle des infeétes ,
s'oppofent
a
de pareilles régénérations.
Il
ya llOe autre efpece d'accroilfement qui a paru
merveilleux quand
le
hafard I'a découvert : on re–
marqua en Angleterre que nos COl'pS étoient conf–
tamment plus grands le matin que le foir ,
&
que
cet accroilfement montoit a
fu:
&
fept lignes;
011
examina ce nauveau phénomene ,
&
011
en donna
l'explication dans les
TranfaéliolLs
PIU'ofopki'lues.
Un
efprit qui n'auToit pa étendre fes viles que fur des
objets déja découverts, auroit vériJié groilierement
ce phénomene, I'auroit étalé aUl: yeux du public
fous une alltre forme, l'auroit paré de quelque
explication phyíique mal ajufrée , auroit promis
de dévoiler de nouvelles merveilles: mais
M.
l'Ab–
bé Desfontaines s'eft rendu maitre de cette nou–
'Q'eUe découverte ; il a laiíTé íi loin ceux c¡ui I'a–
voient dOllOée au public , qll'ils n'ont ofé publier
leurs idées ; il efr facheux CJne l'ouvrage Oil il a raf.
femblé fes obfervations n'alt pas été imprimé. Nous
ne donnerons pas ici le détail de toutes les décou–
vertes qu'il a faites fur ceHe matiere : mais nous al-
1005 donner des principes dont on pourra les dédui–
Te.
1°.
L'épine efr une colonne compofée de parties
olfeufes féparées par des cartilages épais , compref–
fibles
&
élailiques ; les autres cartilages qui fe trou–
vent
11
la tete des os ,
&
daos les joinnrres , ne pa–
roiíTent pas avoir la
m~me
élailicité.
1°.
Tout le
poids du cronc, c'eíl:-a-dire , le poíds de cent livres
au moins, porte fur I'épine ; les cartilages qui font
entre les vertebres [ont donc comprimés <¡uand le
corps efr debollt : mais quand il efr couche, ils ne
portent plus le meme poids ;
ils
doivent fe dilater ,
&
par conféquent éloigner !.es vertebres; ainíi le tronc
doit devenir plus long, Dlais ce fera la précifément
tlOe force élafiique qui augmentera le volume des
cartilages. Les
fluides
fcm pouífés c:ontinuellenlent
par le c<Eur,
&
ils trouvellt moins de réfifrance dans
les cartilages lor(qu'ils ne {ont pas comprinlés par
le
poids
du
none ,
ils doivent done y entrer en plus
gr.lnde quantité
&
dilater les vai/feaux : mais ces
vai/feaux ne peuvent fe dilater fans augmenter le
volume des cartilages ,
&
fans écarter les vertebres:
d'abord les carrilages .e1Gtremement comprimés fe
rétahliífenc avec plus
de
force; enfuite cette force
diminuera par degrés , comme dans les batons
fié.–
chis, <lui
fu
reíl:ituent ; il eft donc évident que l'ac–
croilfement qui fe fait quand on eft cOllché demande
ltn certain efpace de tems, parce que les cartilages ,
tolljOurS pIe/fés , ne 'Peuvent fe rétablir dans un inf–
tanto De plus, fuppo[ons que l'accroiifement foit de
fix lignes. chaque Iigne d'augmentation ne fe fait pas
daos le meme efpace de tems; les derruereslignés
demanderont un tems bea1lCOllp plus long,
par.ce~le
les cartilages ont moins de force dans le der–
ruer tems de la refrinrtion ; de meme qu'un relfort
Cjlú fe débande a moins de force {ur la fin de fa dé–
tente.
.3°.
L'accroilfement dans les cartilages, doit
prodUlre une augmentation dans le diametre de la
poitrine;
~ar 1~6
cotes en ¡:énénrl f¡¡¡nt plll$ élo¡"
ACC
gnées fur l'épine que fur le fremum, ou dans leuT
marche. Slúvant cette idée , prenons-en deux dl1
meme coté, regardons.les ¡;onune formant un angle
dont une vertebre
&
un cartilage font la baCe.
Il
efr ccrtain que de deux triangles CjlIÍ ont les cotés
égaux
&
les bafes inégales, celui Cjlli a la baCe plus
petite
a
plus de hauteur perpendiculaire : or la ba–
fe de I'angle Cjlle forment ces deux cotés le foir ,
efr plus petite que la bafe de I'angle qu'ils forment
le matin ; il faut donc que le foir íl
y
ait plus de
difrance de I'épine au fremum , ou bien il fallt que
les cotés fe foient voutés ,
&
par conféCjllent la poi–
trine aura plus de difrance le foir que le matin.
4°.
Apres le repas les vai1feaux font plus pleins , le
C<Eur pouíTe le fang
&
les autres fluides avec plus
de force, les vai/feaux agilfent donc plus fortement
fur les cartilages; ils doivent donc porter dans leur
intérieur plus de fluide ,
&
par conféCjllent les dila–
ter; les vertebres doivent donc s'éloigner,
&
par
confécjuent il y aura un accroilfement apres le re–
pas,
&
il fe fera en plus ou moins de tems, felon
la force des vailfeaux, ou felon la íituation du corps;
car íi le COl-pS e\J: appuyé fur le doffier d'une chai.·
fe , le poids du tronc portera moins fm les cartila·
ges , ils feront donc moins prelles ; l'ailion des
vai{–
leaux qui arrivent dans les cartilages trouvera done
moins de réftfrance , elle pourra donc mieux les
dilater: mais Cjlland I'aaion des vaiífeaux commen–
cera
a
diminuer, le décroilfement arrivera, parce CJue
la pefanteur du corps I'emportera alors fu! l'ailion
des vaiífeaux , laCjllelle nI! fera plus auffi vigourelúe
quand la digeltion {era faite,
&
Cjlland la tranfpira–
uon , qui eft tres -abondante trois heures apres le
repas , aura diminué le volume,
&
par conféquent
I'aétion
de~
vaiíTeaux ,
&
la chaleuT Cjlli porte par–
tout la raréfaétion.
5°.
II Y
a \ln accroilfement
&
un décroiífement auquel toutes ces caufes n'ont pas
la meme part ; quand on efr couché on devient plus
long d'un demi pouce , meme davantage : mais cette
augmentation difparoit des qu'on elt levé. Deux faits
ell.'pliqueront ce phénomene.
1°.
L'épine efr plus
droite Cjlland on elt couché ,que lorfque le corps efr
fur fes piés.
1°.
Le talon fe gonfle
>
&
ce gonfle–
ment difparoit par le poids du corps ; au refie cet
accroilfement
&
ce décroilfement font plus coníi–
dérables dans la jeunelle ,que dans l'fige avancé.
M.
SENAC,
Effais de Pkyjique. (L)
Ac CROI&8EMENT , fe dit,
en
Medecim,
de I'aug–
mentation d'une maladie. Le tems de I'accroilfement
efr un tems facheux; c'efr celui ou les accidens aug–
mentent en nombre, en durée
&
en violence ;
fi
I'on f1iíit la maladie des fon commencement, on
pourra prévenir la f{)rce de l'accroilfement.
Voye{
MALADJE.
(N)
ACCROISSEMENT, en
Jardinage
,
fe dit des pian–
tes jorfqll'elles ont fait un grand
pro~re~,
&
de bel–
les poulfes.
Voye{
VÉGÉTA'fION.
(K)
ACCROIST.
Voye{
AccRoISSEMENT.
ACCROISTRE (
Commerce)
en un fens neutre,
fe dit d'une chofe Cjlli paíTe
11
un alfocié 011 eo-pro-
priétaire, par droir d'accroilfement, en conféCjllen–
ce de ce que celui qui poifédoit cerre portion eft
mort ou I'a abandonnée.
(G)
ACCROUPI , adjeét. en
mme
de
Blafon
,
fe dit du
Lion Cjlland il efr affis ,cornme celui de la ville d'Ar–
les,
&
celui de Venife. On dit la meme chofe de tous
les animaux fauvages qlli font dans cette pofrllTe,
&
des lievres , ¡apins
&
conils Cjlli iont ramalfés
>
ce
Cjlli efr lem pofrllre ordin<j.ire, 10rfCjlI'ils ne cottrent
paso
Pafchal Colombier , en Dauphíné
>
d'argent
a
un
finge
accroupi
deguel1les : Ql1el911es-nns de la merr·e
famille I'ont porté
rmnpant.
(V)
ACCRUES,
tmne
de
Marckands defi'ets
;
faire
de~
















