
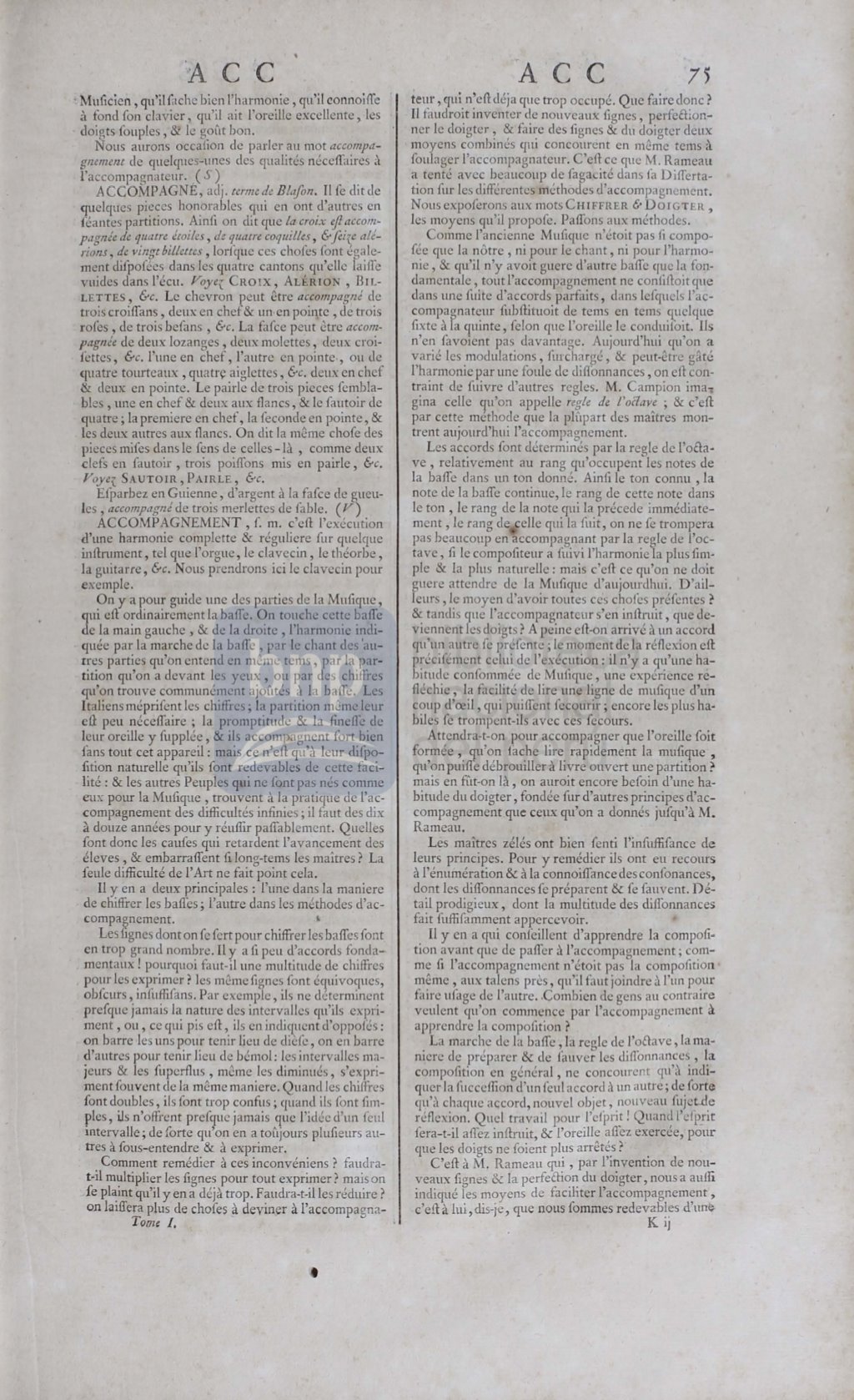
':A
e e
.Mulicien, qu'ilf.lche bien l'harmonie , qu'il connoilfe
a
fond fon clavier, qu'il ait l'oreille excellente, les
doigts fouples ,
&
le goftt bon.
Nous aurons occalion de parler au mot
accompa–
gnemmt
de quelqucs-unes des qualités nécelTaircs
¡\
I'accompagnateur.
(S)
ACCOMPAGNÉ, adj.
termedeBl"Jon.
II
fe ditde
qllel'lues pieces honorables qui en ont d'autres en
féantes partitions. Ainli on dit que
la cro¿r: ejiaccol/l"
p,lgn¿e de q/latre Jtoiles, de 'l/latre coquilles,
&
fcize alé–
riam, de vinfftbillmts,
lorf'lue ces chofcs (Ollt égale–
ment Mpofées dansles quatre cantons 'lu'elle lailTe
vllides dans l'écu.
Voye,-
CROIX, AÜ.RION ,
BIL–
LETTE ,
&c.
Le chevron peut erre
accompagné
de
trois croilTans , deux en chef
&
un·en poillte , de trois
rofes , de troi befans,
&c.
La fa(ce peut etre
accol/l–
pagn.Jede deux lozanges , deux molettes, deux croi–
[etres ,
&c.
l'une en chef, I'aurre en pointe., ou de
<lllatre tourteaux , 'luatr\! aiglcttes,
&c.
delL"\: cn chef
&
dcux en pointe. Le pairlc de trois pieces fembla–
bles , une en chef
&
deux aux flancs,
&
le fautoir de
quatre; la premiere en chef, la (econde en pointe,
&
les dem: mitres aux flancs. On dit la mame chofe des
pieces mires dansle fens de celles -Id. , comme deux
clefs en (autoir , trois poilTons mis en pairle,
&c.
Voye{
SAUTOIR, PAIRLE,
&c.
Efparbez en Guienne, d'argent
a
la fafce de
~ueu
les, accol/lpagni
de trois merlettes de (able.
(V)
ACCOMPAGNEME
T,
r.
m. c'efi l'exécution
d'une harmonie complette
&
réguliere fur quelqlle
inamment, tel que l'orgue, le c1avecin, le théorbe,
la guitarre,
&c.
Nous prendrons ici le c1avecin pour
exemple.
On y a pour guide une des pal"tÍes de la Mufi'lue,
qui efi ordinairement la balTe. On touche cette baífe
de la main gauche )
&
de la droite , I'harmonie indi–
quée par la marche de la balfe , par le chant des 'au–
[res parties 'lu'on entend en méme tems, par la par–
tition qu'on a devant les yeux, ou par des chi/fres
qu'on trouve communément ajofltés
a
la balfe. Les
Italiens méprifentles chilfres; la partirion
m~me
leur
ea peu néceífaire ; la promptitude
&
la finelle de
leur oreille y (upplée ,
&
ils accompagnent fort bien
fans tout cet appareil: mais ce n'ea 'lu'a leur di(po–
útion narurelle qu'ils (ont redevables de cette faci–
lité:
&
les autres Peuples qui ne (ont pas nés comme
enx
pour la Muli'lue, trouvent a la pratic)ue de I'ac–
compagnement des difficultés infinies; il faut des dix
a
douze années pour y réuífu palfabl mentoQuelles
(ont donc les caufes qui retardent l'avancement des
éleves ,
&
embarralTent
íi
long-tems les maitres? La
feule difficulté de l'Art ne fait point cela.
Il y en a deux principales: I'une dans la maniere
de chifI'rer les balles; l'autre dans les méthodes d'ac-
compagnement.
1
Les fignes dont on fe (ert pour chi/frerles balfes (ont
en trop grand nombre.
Il
y a fi peu d'accords fonda–
mentaux! pour'luoi faut-ilune multitude de chifl-res
pour les exprimer? les mcmefignes font
éc~uivoques,
ob(curs, infuffifans. Par exemple, ils ne determinent
pref'lue jamais la nature des intervalles qu'ils expri–
ment, ou, ce qui pis eí!:, ils enindiquent d'oppo!cs:
on barre les uns pour tenir Ijeu de diere, on en barre
d'autres pour tenir lieu de bémol: les intervalles ma–
jeurs
&
les fuperflus , mcme les diminués, s'expri–
ment (ouvent de la meme maniere. Quand les chilfres
font doubles, ils font trop confus; quand ils font fim–
pies, ils n'olfrent
pre(~ue
jamais que l'idée cl'un (cul
intervalle; de (orte qu on en a tOlljours plulieurs au–
tres
a
(ous-entendre
&
a
exprimer.
Comment remédier
a
ces inconvéniens? faudl'a–
t-1l multiplier les fignes pour tout exprimer? maison
fe
pl~int
qu'ilyena déja tropo Faudra-t-illes réduire?
on ¡alífera plus de chofes
a
deviner a !'accompagna-
Tome
J.
75
teu!', qui n'eficléja que trop occupé. Que fairedonc?
Il
faudro~t
inventer
(~e
nouveallX fignes, perfeélion–
ner le dOlgter,
&
f.11re des fignes
&
du doigtcr deux
moyens combinés qui concourent en mcme tems
a
foulager I'accompagnateur. C'efi ce que M. Rameau
a tenté avec bcaucoup de (aga.:iré dans (a DilTerta–
tion fur les di/férentes méthodes d'accompagnement.
Nous expoferons aux mots CHIFFRER [,. DOIGTER ,
les moyens qu'il propo(e. Paífons aux méthocles.
Comme I'ancienne Muíique n'étoit pas fi compo–
(ée que la notre , ni pour le chant, ni pour I'harmo–
nie,
&
qu'i1 n'y avoit guere d'autre balTe Cjue la fon–
damentale, tout l'accompagnement ne coníifioit 'lue
dans une {¡lite d'accords parfaits, dans lefquels I'ac–
compa~nateur
fubilituoit de tems en tems CJ.uclque
line a la quinte , (elon que I'oreille le condui!oit. Ils
n'en favoient pas davantage. Aujourd'hui qu'on
a
varié les modulations, fUl'chargé,
&
peut-etre gaté
I'harmonie par une foule de dilTonnances, on efi con–
traint de (uivre d'autres regles. M. Campion ima–
gina celle cju'on appelle
regle de l'orlave
;
&
c'eí!:
par ceHe methode 'lue la plflpart des ma'itres mon–
trent aujourd'hui I'accompagnement.
Les accords (ont déterminés par la regle de I'oél:a–
ve , relativement au rang qu'occupent les notes de
la balTe dans un ton donné. Ainli le ton connu , la
note de la balTe continue, le rang de cette note dans
le ton, le rang de la note qlli la précede immédiate–
ment, le rang de celle qui la (uit, on ne (e trompera
pas beaucoup en accompagnant par la regle de I'oc–
tave, fi le compoliteur a fuivi I'harrnonie la plus úm–
pie
&
la plus naturelle: mais c'efr ce qu'on ne doit
guere attendre de la Muficlue d'aujomdhui. D'ail–
feurs, le moyen d'avoir tomes ces choles pré(entes
?
&
tandis que I'accompagnateur s'en infiruit, que de–
viennent les doigts? A peine efi-on amvé a un accord
qu'un autre (e prélente; le moment de la réflexion eí!:
précj(ément celui de l'exécution : il n'y a 'lu'une ha–
bitude con(ommée de Mulique , une expérience re–
fl
'chie, la facilité de lire une Iigne de mufi'lue d'un
coup d'reil, qui puilTent (ecourir ; encore les plus ha–
biles (e trompent-ils avec ces (ecours.
Attendra-t-on pour accompagner que I'oreille (oit
formée, qu'on lache lire rapidement la mufique ,
qu'on puilTe débrouiller a Iivre ouvert une partition?
mais en ñtt-on
Ul,
on auroit encore be(oin d'une ha–
bitude du doigter, fondée fur d'autres príncipes d'ac–
compagnement que ceux qu'on a donnés jufqu'a M.
Rameau.
Les maitrcs zélés ont bien (enti I'irúilffifance de
lems principes. Pour y remédier ils ont eu recours
a l'énumération
&
a la connoi1Tancedes con(onances,
dont les diífonnances (e préparent
&
(e fauvent. Dé–
tail prodigicux, dont la multitude des di1Tonnances
fait (uffi(amment appercevoir.
. Il Y
en a qui conleillent d'apprendre la compoú–
tlOn avant que de palTer a l'accompagnement; com–
me fi l'accompagnement n'étoit pas la compofition
meme , aux talens pres, qu'il faut joindre
a
l'un pour
faire u(age dc I'autre. .Combien de gens au contraire
veulent C]u'on commence par I'accompagnement
a
apprendre la compofition ?
La marche ele la balfe , la regle de I'oél:ave, la ma–
niere de préparer
&
de fauver les dilfonnances, la
compofition en général, ne concourent qu'a indi–
quer la (ucceiTion d'un (eul accord
a
un autre ; de (orte
qu'a chaque accord, nouvel objet, nOliveau
(ujet.deréflcxion. Quel travail pour l'eljJTit! Quand l'dÍ'rit
fera-r-il alrez infintit,
&
I'oreille alTez exercée, pour
que les doigts ne foicnt plus an-etés ?
C'efi
¡\
M. Rameau 'lui , par l'invention de nou–
veaux Ii"'nes
&
la perfeél:ion du doigter, nous
a
aulli
indiqué les moyens de faciliter I'accompagnement ,
c'eí!:a lui,dis-je, clue nous (ommes redevables
d'un~
Kij
















