
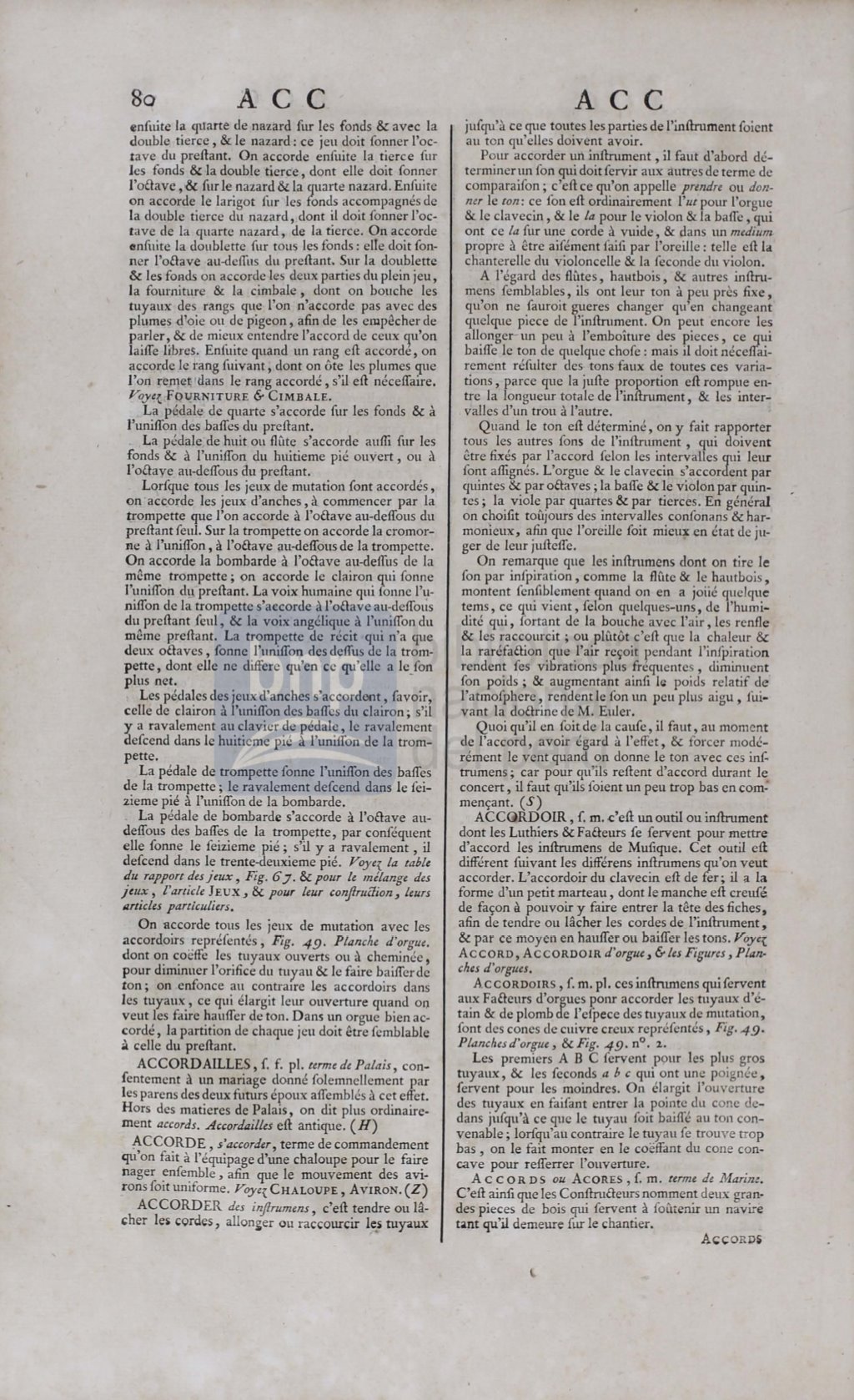
80
ACC
enfiute la qtrarte de nazard [ur les fonds
&
avec la
double tierce,
&
le nazard: ce ¡en doít (onner I'oc–
tave du preíl:ant. On accorde enfuite la tierce (ur
les fonds
&
la double tierce, dont elle doit (onner
l'oaave
,&
[ur le nazard
&
la qtIarte nazard. Enfuite
on accorde le larigot [ur les fonds accompagnés de
la double tierce du nazard, dont il doit fonner I'oc–
tave de la qnarte nazard, de la tierce. On accorde
cmfilite la doublerte fur touS les fonds : elle doit [on–
ner I'oaave au-de(fus du preíl:ant. Sur la doublerte
&
les foads on accorde les deux parties du plein jeu,
la fomniture
&
la cimbale, dont on bouche les
tuyaux des rangs que I'on n'accorde pas avec des
plumes d'oie ou de pigeon, afin de les empecher de
parler,
&
de míeux entendre I'accord de ceux CfI'on
lai{[e libres. Enfuite qtland un rang eíl: accorde, on
accorde le rang [uivant, dont on ote les plumes que
1'0n remet dans le rang accordé , s'il eíl: nécelTaire.
Voye{
FOllRNITURE
&
CIMBALE.
La pédale de quarte s'accorde [ur les fonds
&
a
l'uni{[on des ba{[es du preíl:ant.
La pédale de huit 011 flltte s'accorde auffi [ur les
fonds
&
a
I'unj{[on du hnitieme pié ouvert, ou
a
l'oaaye au-delTous au preíl:ant.
Lor(que tous les jeux de mutation [ont accordés,
on accorde les jeux d'anches
,a
commencer par la
tromperte que I'on accorde a l'oaave au-de{[ous du
preíl:ant fenl. Sur la trompette on accorde la cromor–
Re
a
I'uni{[on,
a
I'oaave au-delTous de la trompette.
On accorde la bombarde a I'oaave au-de{[us de la
mcme trompette; on accorde le clairon qtli [onne
!'uni{[on du prefiant. La voix humaine qui fonne I'u–
ni{[on de la trompette s'accorde al'oaave au-de{[olis
du preíl:ant [enl,
&
la voix angéliqtle
a
I'uni{[on du
meme preíl:ant. La tromperte de récit qllÍ n'a qtle
deux oaaves, (onne l'unilTon des deífus de la trom–
pette, dont elle ne diJfere qu'en ce qu'elle a leJon
plus neto
Les pédales des jeux d'anches s'accordeot , [avoir,
celle de c1airon
a
I'uniífon des baífes du clairon; s'il
y
a ravalement au clavier de pédale, le ravalement
de[cend dans le huitieme pié a I'uniífon de la trom–
pette.
La pédale de trompette [onne I'uni{[on des baífes
de la trompette; le ravalement de[cend dans le [ei–
zieme pié a I'uniífon de la bombardeo
La pédale de bombardc s'accorde
a
l'oaave au–
deífous des baífes de la trompe¡te, par con[éqtLent
elle [onne le [eizieme pié; s'il y a ravalement , il
de[cend dans le trente-deuxieme pié.
Voye{ la lable
du rapport des jeux, Fig.
67.
&
pour le mt[ange des
jeux,
['article
JEux,
&
pour leur conftruéljon, leurs
Ilrlicles particuljers.
On llccorde tous les jeux de mutation avec les
accordoirs repré[entés,
Fig.
-49.
Planche d'orgu,.
dont on coeff'e les nlyaux ouverts ou a cherninée,
pour diminuer I'orifice du nlyau
&
le faire baiíferde
ton; on enfonce au contra.lTe les accordoirs dans
les tuyaux , ce qui élargit leur ouverture quand
01).
veut les faire hauífer de ton. Dans un orgue bien ac–
cordé, la partition de chaque jeu doit etre [emblable
a
celle du preíl:ant.
ACCORDAILLES,
f.
f. pI.
terme de Palais,
con–
fentement a un mariage donné [olemnellement par
les parens des deux funus époux alTemblés
a
cet eff'et.
Hors des matieres de Palais, on dit plus ordinaire–
ment
accords. Accordailles
eíl: antique.
(H)
ACCORDE,
s'accorder,
terme de commandement
qu'on fait
a
I'équipage d'une chaloupe pour le faire
nager enfemble,
afin
que le mouvemem des avi–
rons [oit uniforme.
Voye{
CHALOUPE , AVIRON.
(Z)
ACCORDER
des injlrumens,
c'eíl: tendre ou la–
,her lei cordes,
al1on~er
ou raccourcir le.s tuyaux
ACC
ju[qu'a ce qtte toutes les porties de I'inll:rument [oient
au ton qu'elles doivent avoir.
Pour accorder un irillmment , il faut d'abord dé–
tenninerun ron qui doít (ervir aux autres de terme de
comparauon; c'efi ce qu'on appelle
prmdre
ou
don–
ner
le
con:
ce foo efi ordinairement
l'm
pour I'orgue
&
le clavecin,
&
le
la
pour le violon
&
la baife, qtti
om ce
la
[ur une corde
a
vuide,
&
dans un
medium
propre
a
etre ai[ément faiú par l'orcille : telle eíl: la
chanterellc du violoncelle
&
la [econde du violon.
A I'égard des flutes, haHtbois,
&
autres ínll:ru–
mens femblables, ils oot leur ton
a
peu pres nxe,
qu'on ne fauroit gueres changer qu'en changeant
qtlelqtle picce de I'irillrument. On peut encore les
allonger un peu
a
I'embolnlre des pieces, ce qui
baiífe le ton de qtlclquc chofe : mais il doit néce1fai–
rement ré[ulter des tons faux de toures ces varia–
tions, paree que la jufte proportion efi rompue en–
tre la longlleur totale de I'inll:rument,
&
les inter–
valles d'un trou a I'autre.
Quand le ton eíl: déterminé, on y fait rapporter
tOllS les autres [ons de I'inftmment, qui doivent
etre fixés par I'accord felon les intervalles qtli leur
[Ont affignés. L'orgue
&
le clavecin s'aeeordent par
qtúntes
&
par oaaves ; la baífe
&
le violon par qllin–
tes; la viole par quru-res
&
par tierees. En généraJ
on ehoilit tolljOurS des intervalles eon[onans
&
har–
monieux, afin que I'oreille [oit mieux en état de ¡u–
ger de leur jufieífe.
On remarque que les iníl:mmens dont on tire
le
ron par in[piration, comme la flí'tte
&
le hautbois,
montent [enliblement qtland on en a joiié quelque
tems, ce qui vient , (elon qtlelques-uns, de I'humi–
dité qui, [ortant de la bouche avee I'air, les renfle
&
les raecourcit ; ou pllltOt c'eíl: qtle la chaleur
&
la raréfailion que l'air
re~oit
pendant I'infpiration
rendent [es vibrations plus freqttentes , diminuent
fon poids ;
&
augmentant ainfi le poids relatif de
I'atmo[phere, rendent le ron un peu plus aigu, fui.
vant la doarine de M. Elúer.
Quoi qu'il en foitde la eaufe, il faut, au moment
de l'aeeord, avoir égard
a
l'eff'et,
&
foreer modé–
rément le vent quand on donne le ton avee ces
inf..
mlmens; car pour qu'ils refient d'accord durant le
coneen, il faut qtl'ils
[oient
un peu trOp bas en com–
men~ant.
(S)
ACCORDOIR, [. m. <:'eíl: un outíl ou inftrument
dont les Luthiers
&
Faaeurs [e [ervent pOllT mettre
d'aecord les iníl:mmens de Mulique. Cet outil eíl:
diJférent [uivant les diff'érens infirumens qu'on veut
aceorder. L'accordoir du clavecin eíl: de fer; il
a
la
forme d'un petit marteau, dont le manche eíl: cretúé
de
fa~on
a
pouvoir
y
faire entrer la tete des fiches,
afin de tendre ou Hicher les cordes de l'infirument,
&
par ce moyen en hauífer 011 bailTer les tons.
Voye:¡:
ACCORD, ACCORDOIR
d'orgue,
&
les Figures, Plan–
ches d'orglles.
A.CCORDoIRS,
f.
m. pI. cesinfimmens qui[ervent
aux Faaeurs d'orgues ponr accorder les nlyaux d'é–
tain
&
de plomb de l'efpeee des nlyaux de mutation,
[ont des cones de euivre erel1X repréfentés,
Fig. -49.
Planchesd'orglle,
&
Fig.
-49. na.
2.
Les premiers A
B
C [ervent pour les plus gros
ntyaux,
&
les [econds
a
b
e
qui ont une poignée,
[ervent pour les moindres. On élargit I'ouverture
des nlyaux en fauant entrer la pointe dll cone de–
dans jufqtl'a ce que le nlyau [oit bailTé au ton con–
venable; 10nqtt'al1 eontraire le tuyau [e trom'e trop
bas, on le fait monter en le eoe/filnt dll cone con–
cave pour reíferrer I'ouvemlre.
A CCORDS
ou
ACORES,
f.
m.
terme
de
Marim.
C'eíl: ainú qtle les Confrruaeurs nomment deux gran–
des pieces de bois qui ferveot a [olttenir tUl navire
tant
qu'i!
demeure [ur le chantier.
















