
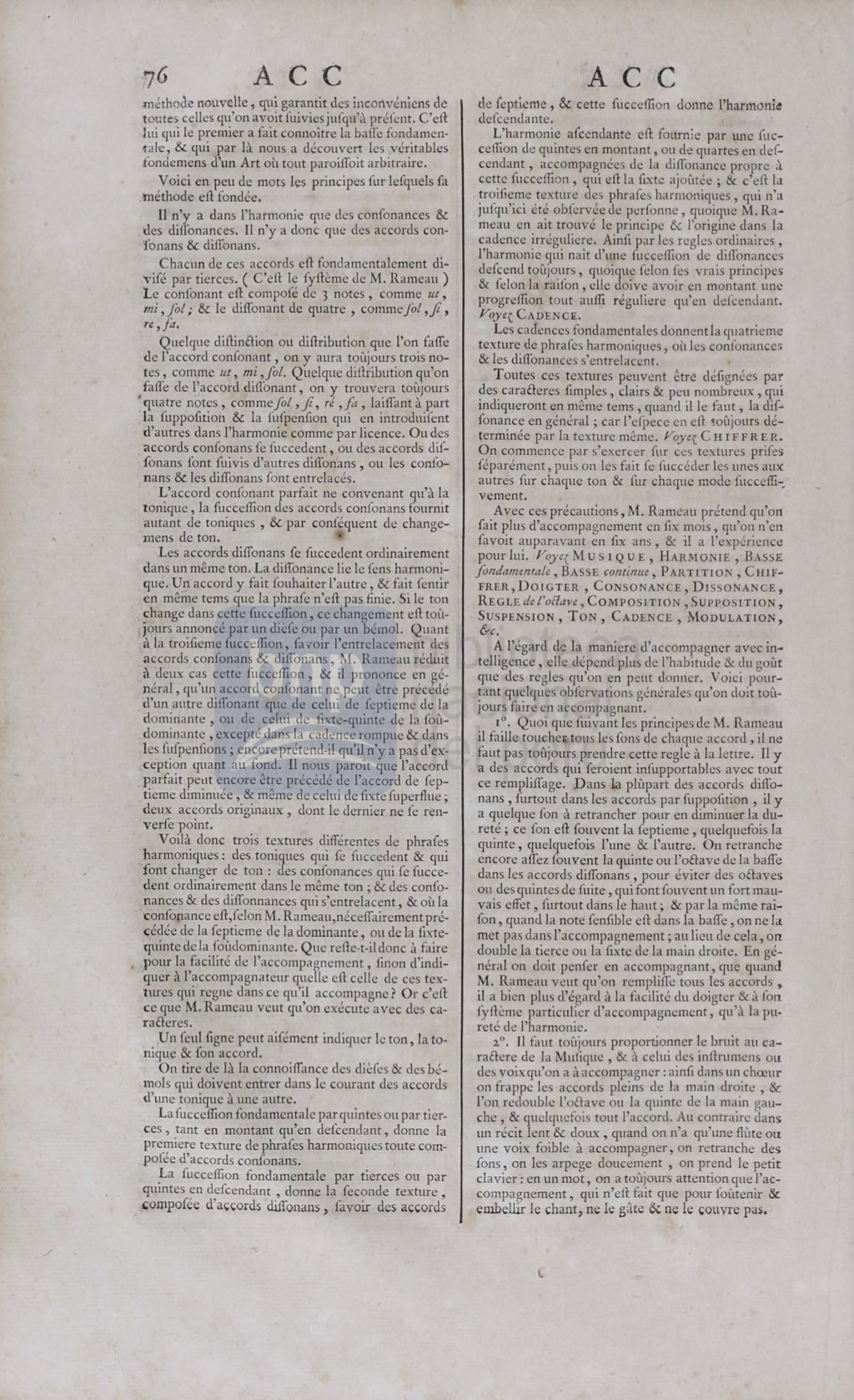
ACC
rnéthode nouvell-e , qtlÍ garantit des ínconvéniens
de
tOtHeS
celles qu'on avoit Iwvies juCqu'a préfent. C'eíl
lui qui le premier a fait connoltrc la baífe fondamen–
tale,
&
qui par la nous a découvert les véritables
fondemens d'un Art Ol! tout paroiífoit arbitraire.
Voici en peu de mots les principes (ur le(quels (a
méthode eíl fondée.
Il n'y a dans l'hartnot1ie que des con(onances
&
des diílonances. II n'y a done que des accords con–
fonans
&
diífonans.
Chacl1n de ces accords eíl fondamentalement di–
viCé par tierces. ( C'eít le fyíteme de M. Rameau )
Le conConant eíl compo(é de 3 notes, comme
ut,
mi, jol;
&
le diífonant de quatre ,
commejol,ji ,
ro,Ja.
Quelque dillinétion ou difuibution que 1'0n faífe
de I'accord con[onant , on y aura tOlljOurS trois no–
tes, comme
ut, mi ,fol.
Quelque diílribution qu'on
faífe de l'accord dillbnant, on y trouvera tolljours
.quatre notes,
commefoL, ji,
ti
,fa,
laiífant
a
part
la [uppoútioh
&
la úl[penfion qui en introduilent
d'autres dans l'harmonie comme par licence. Ou des
accords con(onans (e Cuccedent , ou des accords diC–
{onans (ont (uivis d'autres dillonans , ou les confo–
nans
&
les diífonans (ont entrelacés.
L'accord conlonant parfait ne convenant qu'a la
tonique, la (ucceilion des accords confonans fournit
autant de toniques ,
&
par eonféc[Uent de change-
mens de ton.
•
Les accords diífonans (e (uccedent ordinairement
dans un
m~me
ton. La diífonance lie le [ens hamlOni–
que. Un accord y faít [ouhaiter I'autre,
&
fait [entir
en meme tems que la pillare n'eíl pas finie. Si le ton
change dans cette [ucceilion, ce changement eíl tou–
jours annoncé par un diere ou par un bémo\. Quant
a
la troiúeme (ucceilion, [avoir l'entrelacement des
accords confonans
&
dillonans, M. Rameau rédl.lit
a
deux cas cette (ucceilion,
&
il prononce en ¡;é–
néral , c[U'un accord confonant ne peut
~tre
précedé
u'un
autre diífonant que de eelui de [eptieme de la
dominante, ou de celui de lixte-quinte de la
1011-
dominante, excepté dans la cadence rompue
&
dans
les fu(penlions; encoreprétend-il qu'il n'y a pas d'ex–
ception quant au fonel.
I1
nous parolt que l'accord
parfait pellt encore etre précédé de I'accorel de fep–
tieme diminuée,
&
m~me
ele cellli ele fixte fuperflue;
deux accords originaux, dont le demier ne (e ren–
ver(e point.
Voila done trois textures différentes de pilla(es
harmoniques: des toniques qui fe fuccedent
&
qtÚ
font changer de ton: des confonances qui fe fucce–
dent ordínairement dans le
m~me
ton;
&
des confo–
nances
&
des diífonnances qui s'entrelacent,
&
otila
confonanee eíl,felon M. Rameau,néceífairementpré–
cédée ele la feptieme ele la elominante, on ele la lirte–
t{uinte dela foudominante. Que reíle-t-ildonc
a
faire
pour la facilité ele I'accompagnement, finon d'indi–
quer a I'accompagnateur quelle eíl celle de ces tex–
htreS qtÚ regne dans ce qu'il accompagne? Or c'eíl
ce que M. Rameau veut qu'on exécute avec des ca–
raaeres.
Un [eul figne peut aifément indiquer le ton, la to–
nique
&
Con accord.
On tire de la la connoiífance eles dieres
&
des bé–
mols qui doivent entrer dans le cottrant des accords
d'une tonique
a
une autre.
La (ucceilion fondamentale parquintes ou par tier–
ces, tant en montant qu'en defcenclant, donne la
premiere texture de pillares harmoniques toute com–
pofée d'accords con[onans.
La [ucceffion fondamentale par tierces ou par
quintes en defcendant , donne la [econele texture,
compofee d'accords cliJ[onans) (avoir des accords
ACC
de tepticme ,
&
cette (ucceilion donne l'harmoníc
defcenelante.
L'harmonie a(cendante eíl fomnie par une (uc–
ceilion de qllintes en montant, ou de quartes en def–
cenelant, accompagnées ele la eliílonance proprc il
cette (ucceilion, qui eílla flXte ajolltée ;
&
c'eílla
troifieme texture des pilla(es harmoniques , qui n'a
jtúqu'ici eté ob(ervée de per[onne, quoique M. Ra–
meau en ait trouvé le principe
&
I'origine dans la
cadence irréguliere. Ainli par les regles ordinaires ,
I'harmonie qui nalt d'tme fucceffion ele dillonances
de(cenel tOlljours, quoique [elon (es vrais principes
&
(elon la rai[on , elle doive avoir en montant une
progreilion tout auili réguliere qu'en ele[cendant.
Voye{
CADENCE.
Les cadences fondamentales donnentla quatrieme
texture de phrafes harmoniclues, oh les con(onances
&
les diífonances s'entrelacent.
T outes ces textures peuvent étre délignées par
des caraaeres fimples, clairs
&
peu nombreux , qui
ineliqueront en m&me tems , quand ille faut, la dif–
[onance en général ; car I'efpece en eíl wujours dé–
terminée par la texture meme.
Voye{
C
H 1
F
F
RER.
On commence par s'exercer filr ces textures pri(e9
[éparément, lmis on les fait fe fuccéder les \mes aux
autres (ttr chaque ton
&
(ur chaque mode (ucceili-,
vement.
I
I
"
Avec ces precautlOns,
M.
Raméau pretend
C¡U
on
[ait plus d'accompagnement en lix mois, clu'on n'en
(avoit auparavant en lix ans,
&
il a l'expérience
pour lui.
Voye{
M u SI
Q
u E , HARMONIE , BASSE
fondalllentaLe,
BASSE
continuo,
PARTlTION, CHIF–
FRER, DOIGTER , CONSONANCE, DISSONANCE,
REGLE
deL'oaavo,
COMPOSITION ,SUPPOSITION,
SUSPENSION, TON, CADENCE , MODULATION,
&c.
A l'égard de la maniere d'accompagner avec in
4
telligence, elle elépend plus de I'habitude
&
elu gout
que des regles c¡u'on en peut elonner. Voici pour–
tant quelques ob(ervations générales c¡u'on doit toll–
jours faire en accompagnanr.
l°.
Quoi que fiúvant les principes de M. Rameati
il faille touchet tous les [ons de chaque accord , il ne
faut pas tolljours prenelre cette regle
a
la
lettre.
I1
y
a des accords qui (eroient in[upportables avec tout
ce rempliifage. Dans
la
plupart des accords diIlo–
nans, Cmtout elans les accords par [uppolition , il Y
a quelqlle (on a retrancher pour en diminuer la du–
reté; ce (on eíl [ouvent la [eptieme , quelquefois la
c¡uinte, c¡uelc¡uefois I'une
&
l'autre. On retranche
encore aífez [ouvent la qtúnte ou l'oétave de la baífe
dans les accords diífonans , pour éviter des oaaves
01\
des Cf\úntes de [uite, qui font [ouvent un fortmau–
vais effet, [urtout elans le haut;
&
par la meme rai–
(on, quand la note [enfible eíl dans la baífe , on ne la
met pas dans I'accompagnement; aulieu de cela,
011
double la tierce ou la (IXte de la main droite. En gé–
néralon doit penfer en accompagnant, que quand
M. Rameau veut qu'on rempliíre tous les accorels ,
il a bien plus eI'égard
a
la facilité elu doigter
&a
fOI1
(yll:i:me particulier d'accompagnement, Cfu'a la pu–
reté de l'harmonie.
2,0.
11 faut tofljours proportionner le bnút au ca–
raaere ele la Mulic¡ue ,
&
a
ce!tú eles inílrumens Otl
des voixc¡u'on a
a
accompagner :ainli dans un chceur
on frappe les accorels pleins de la main droite ,
&
I'on redouble l'oaave ou la c¡uinte de la main gau–
che,
&
quelquefois tout I'accord. Au contraire elans
un récit lent
&
dOtlX , quand on n'a qu'une flltte ou
une voix foible
a
accompagner, on retranche eles
[ons, on les arpege doucement , on prend le petit
clavier: en un mot, on a tOlljOurS attention que l'ac–
compagnement, c¡ui
n'eí~
fait que pom fOlltenir
&
embellir le chant, ne le gate
&
ne le couvre pas.
















