
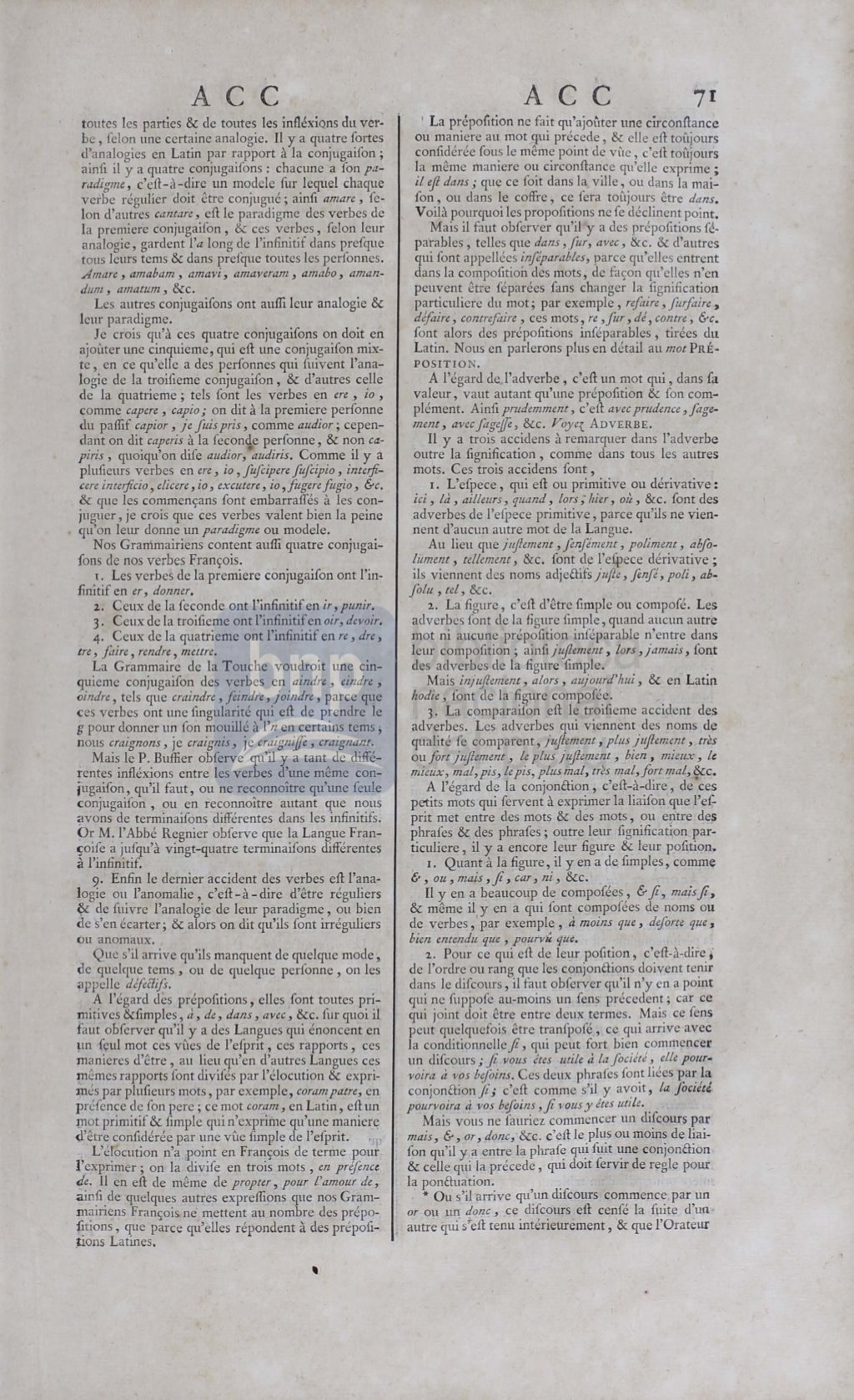
ACC
toutes les parties & de toutes les infléxiQns du ver–
be, (elon une certaine analogie.
II
ya quatre (Oltes
d'analogies en Latin par rapport a la conjugai(on ;
ainfi il y a quatre conjugai(ons : chacune a ron
pa–
rtldigme,
c'efr-a-dire un modele
(m
lequel chaque
verbe réglllier doit etre conjugué; ainfi
amare,
[e–
Ion d'autres
cantare,
efr le paradigme des verbes de
la premiere conjugai(on, & ces verbes, [elon leur
analogie, gardent
I'a
long de I'infinitif dans pre(ql1e
tous leurs tems & dans pre
(cp.letoutes les per[onnes.
Amare, amabam, amayi, amayeram, amabo, aman–
d/lm, amatum,
&c.
Les autres conjugai[ons ont auffi leur analogie &
leur paradigme.
Je crois qu'¡\ ces cp.latre conjugai[ons on doit en
ajotiter une cincp.úeme, qui efr une conjugai(on
mix–
te, en ce qu'elle a des perfonnes
cp.li(l1ivent I'ana–
logie de la troifieme conjugai(on, & d'autres celle
de la c¡uatrieme; tels (ont
les
verbes en
ere, io,
comme
capere, capio;
on dit
a
la
premiere per(onne
du paffif
capior, je fuis pris
,
comme
audior
;
cepen–
dant on dit
caperis
a
la (econcle per(onne, & non
ca–
piris ,
quoiqu'on dife
audior, ·audiris.
Comme il
y
a
pluiieurs verbes en
ere, jo, fufcipere fufcipio
,
intedi–
cere intedicio, ,licere, io, excutere, io, fugue fugio, &c.
&
que les
commen~ans
(ont embarraífés
a
les
con–
jl1guer, je crois que ces verbes valent bien
la
peine
cp.l'on lem donne un
paradigme
ou modele.
Nos Granlmairiens content auffi quatre conjugai–
fons de nos verbes
Fran~ois.
t.
Les verbes de la premiere conjugai(on ont
l'in-
finitif en
u,
donner.
2.
Ceux de la (econde ont l'infilútifen
ir, punir.
3.
Ceux de la troiíieme ont l'infinitifen
oir, deyoir.
4.
Ceux de la cp.latrieme ont l'infirútifen
re, dre,
tre, foire, rendre, meure.
La Grammaire de la Touche voudroit une cin-
9uieme conjugaifon des verbes en
aindre, eindre ,
oindre,
tels
cp.lecraindre, feindre, joindre,
paree que
ces verbes ont une (mgularité qui efr de prendre le
g
pom donner un (on mouillé a
l'n
en certains tems,
nous
craignons,
je
craignis,
je
craignijJe, craignant.
Mais le P. Buffier ob(erve qu'il y a tant de diffé–
rentes infléxions entre les verbes d'une mcme con–
jugai(on, qu'il faut, on ne reconnoitre qu'tme [elúe
conjugai(on , on en reconnoltre autant
cp.lenous
avons de terrninai[ons dilférentes dans les infinitifs.
Or M. l'Abbé Regnier ob(erve c¡ue la Langue Fran–
~oi(e
a ju(qu'a vingt-quatre terrninai(ons différentes
a
l'infinitif.
9. Enfin le dernier accident des verbes efr l'ana–
logie ou l'anomalie, c'efr-a-dire d'etre régllliers
~
de (uivre l'analogie de
lem
paradigme, ou bien
de s'en écarter; & alors on dit
c¡u'ils
(ont irrégliliers
ou anomaux.
Que s'il arrive qu'ils manquent de
cp.lelcp.lemode,
de quelqlle tems, ou de quelc¡ue per(onne, on les
appelle
défeaifs.
A I'égard des prépofitions, elles (ont toutes pri–
mitives &fimples,
a,
de, dans, ayec,
&c. (ur quoi
il
faut ob(erver cp.l'il y a des Langues qui énoncent en
un
{eul
mot ces vúes de l'e(prit, ces rapports, ces
manieres d'etre , au lieu
~u'en
d'autres Langues ces
memes rapports (ont divifes par l'élocution & expri–
més par plufieurs mots, par exemple,
corampatre,
en
pré(ence de (on pere ; ce mot
eoram,
en Latin , efr 1m
mot primitif& fimple qui n'exprime cp.l'une maniere::
d'etre confidérée par une vfte funple de l'e(prit. "
L'élocution n'a point en
Fran~ois
de terme pour
l'exprimer ; on la divi(e en trois mots ,
CIl
préfence
de.
Il en efr de meme de
propter
,
pour
L'
amour de,
ain~
.de quelcp.les autres expreffions que nos Gram–
m?mens
Fran~ois
ne mettent au nombre des prépo–
~tlOns,
que parce qu'elles répondent
a
des prépofi–
~ons
Latmes.
ACC
, La prépolition ne fait cp.l'ajollter une cÍJ"con!l:ance
ou
ma~i,;re
au
mot ~ui pré~ede, ~
elle eíl tOlljoms
confideree fous le meme pomt de vue ,
c'ea
tOlt}ours
la meme maniere
Ol~
circoníla";ce qu'elle exprime;
d
ejl
da/lS;
que ce {Olt dans la ville, ou dans la mai–
{on, ou dans le colfre, ce (era tOtljOurS etre
dans.
Voila pourcp.loi les propofitions ne (e déclinent point.
Mais il faut ob(erver qu'il
y
a des prépofitions
(é–
pa'rables, telles
cp.ledans ,fur, ayec,
&c.
&
d'autres
qui (ont appellées
inflparables,
parce qn'elles entrent
dans la compofition des mots, de
fa~on
qu'elles n'en
peuvent erre féparées fans changer la fignification
particuliere du mot; par exemple ,
refoire, JiLrfaire ,
dJfoire, contrefoire
,
ces mots,
re ,fur
,
di, COlltre,
6·c.
(ont alors des prépoíitions in[éparables, tirées du
Latin. Nous en parlerons plus en détail au
mot
PRÉ.
POSITION.
A l'égard de l'adverbe ,
c'ea
1m mot
cp.li,dans {a
valeur, vaut amant cp.l'une prépofition
&
(on com–
plément. Ainfi
pmdemmem,
c'
ea
avee pmdence, fage.
mem, avecfogeffi,
&c.
Voye{
ADVERBE.
Il
y a
trois
accidens
á
remarcp.ler dans l'adverbe
outre la fignification, comme dans tous les 3utres
mots. Ces trois accidens (ont,
l.
L'e(pece, qui
ea
ou primitive ou dérivative:
iei, la, ailleurs, qlland, lors; hier,
Oll.,
&c. (Ont des
adverbes de l'e(peee primitive, paree qu'ils ne vien–
nent d'aueun autre mot de la Langue.
Au lieu que
juflement ,fe'ifément, poliment, alfo–
/ument , tellement,
&c. (ont de l'eípece dérivative ;
ils viennent des noms adjetl:ifs
jufi~,
fenfl, poli, abo
jolu
,
tel,
&c.
2.
La figure, c'efr d'etre fimple ou compo(é. Les
aclverbes (ont ele la figure íimple, quand aucun autre
mot ni aucune prépofition in(éparable n'entre dans
lem compofition ;
ainftjujlemem, lors ,jamais,
font
des adverbes de la figure funple.
Mais
injuflunent , alors, aujourd'hui,
& en Latin
¡zodie,
(ont de la
fi¡~ure
compo(ée.
3.
La comparaiton
ea
le troifieme accident des
adverbes. Les adverbes glÚ viennent des noms de
qualité (e comparent,
jujlement, plus juflement, tres
ou
jort j '1feme/lt, le plus j uflement , bien, mieux,
le
mieux, mal, pis,
le
pis, plus mal, treS mal, jort mal,
/?le.
A l'égard de la conjontl:ion, c'ea-a-dire, de ces
petits mots c¡ui (ervent a exprimer la liai(on c¡ue l'ef-.
prit met entre des mots & des mots, ou e!ltre des
phra(es & des phra(es ; outre lem fignification par–
ticuliere,
il
Y
a encore leur figure
&
leur poíition.
l.
Qllant
a
la figure, il yen a de funples , cornme
&,
ou,mais,ji, car, ni,
&c.
Il y en a beaucoup de compo(ées,
&
ji, maisji,
& meme
il
y en a qui [ont compofées de noms ou
de verbes,'par exemple,
a moins que, diforte que,
bien entendu que, pOUfYU que.
2.
Pour ce qui
ea
de leur pofition, c'ea-¡\-dire,–
de l'ordre ou rang que les conjonfuons doivent tenir
dans le di(cours, il faut ob(erver qu'il n'y en a point
qui ne filppo(e au-moins un (ens précedent; car ce
qui joint doit etre entre deux termes. Mais ee (ens
peut quelquefois etre tran(po(é, ce 'luí arrive avec
la conditionnelle
ji,
qui peut fort bien commencer
un di(cours;
ji YOllS étes mile a la jociéc.!, elle pour–
voira
ti.
vos bifoins.
Ces deux phra(es font liées par la
conjonfuon
ji;
c'eíl comme s'il y avoit,
la joeiitf.
pourvoira
ti.
vos bifoillS ,jivousy étes utite. .
Mais vous ne [auriez commencer 1m difcours par
mais,
&,
or, done,
&c. c'efr
le
plus Ol!
moins
de liai–
(on qn'il y a entre la phraÚ: qu.i ftút une conjonfuon
&
celle c¡ui la précede,
qru
dOlt (ervtr de regle pour
la pontl:uation.
*
Ou s'il arrive qu'un cli(cours commence par un
or
on 11n
dOIlC ,
ce di(cours efr cen(é la (uite d'un
autre qtÚ
s~eíl:
tenu intérieurement, & que l'Orateur
















