
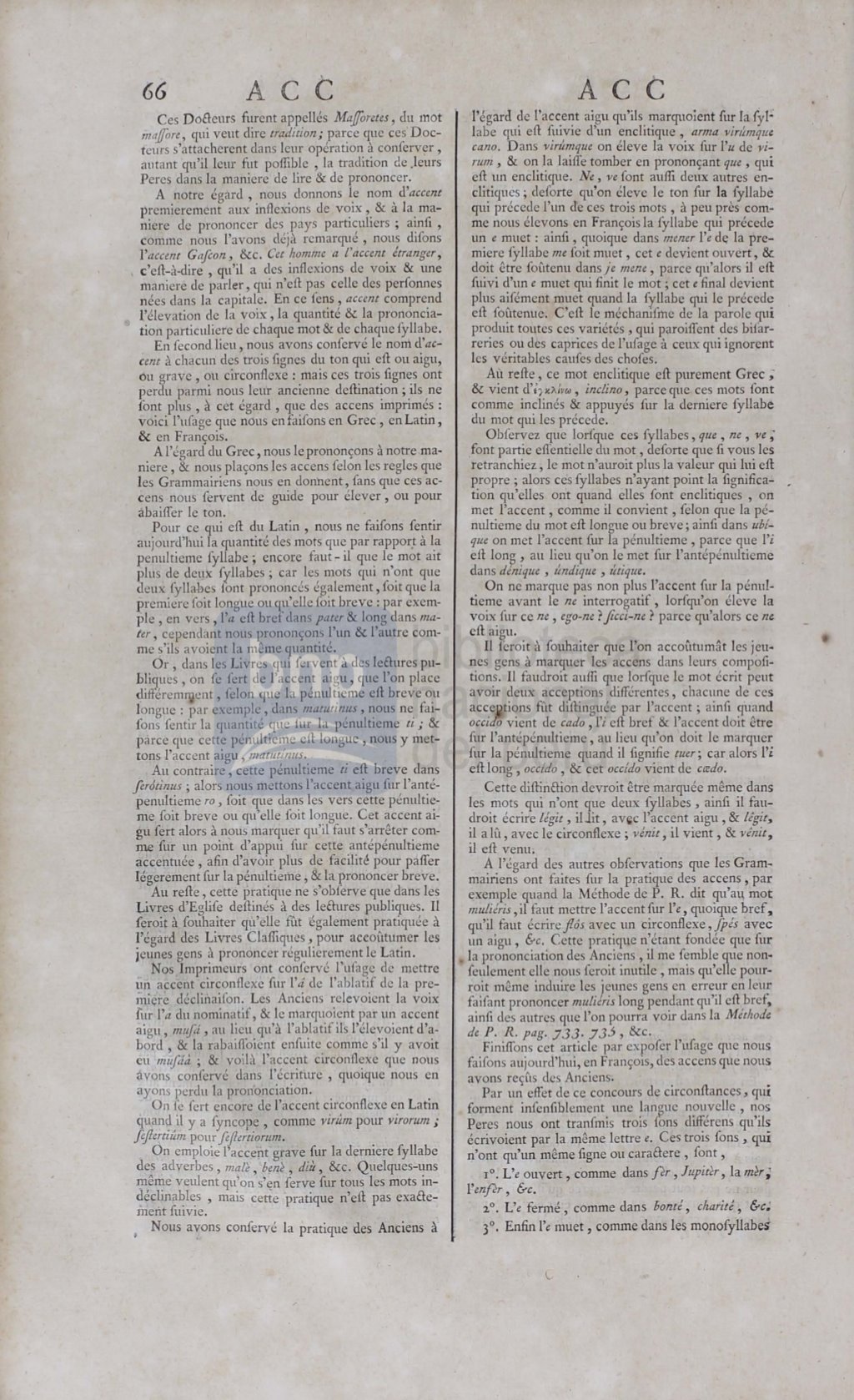
66
Act
Ces Doé1:eurs nlrent appellés
Ma./foretes,
du mot
rna./fore,
'luí veut dire
tradiúon;
parce que ces Doc–
teurs s'attacherent dans leur opération a conferver ,
autant qu'illem nn poffible , la tradition de .leurs
Peres dans la malúere de lire
&
de prononcer.
A notre égard, nous donnons le nom
d'aceent
premierement aux ínlle;\-ions de voix,
&
a la ma–
niere de prononcer des pays particuliers ; ainíi ,
comme nous I'avons déja remarqué, nous difons
l'aceent Gafton, &c.
Ca
IlOmllle a ['aceem étranger,
e'eíl:-a-dire , qu'il a des inllexions de voix
&
une
maniere de parler, qui n'eíl: pas celle des per{onnes
nées dans la capitale. En ce {ens ,
a"em
comprend
l'élevation de la voix, la quantité
&
la prononcia–
tion particuliere de chaque mot
&
de chaque fyllabe.
En fecond lieu, nous avons con(ervé le nom
d'ac–
cent
a ehacun des trois íignes du ton qui eíl: ou aigu,
ou grave, ou circonllexe : mais ces trois íignes ont
perdu parnü nons leur ancienne deílination ; ils ne
{ont plus, a cet égard , que des accens imprimés :
voici l'túage que nons en faifons en Crec , en Latin,
&
en
Fran~ois.
A l'égard du Crec , nous le
pronon~ons
a notre ma–
niere ,
&
nous
pla~ons
les accens felon les regles que
les Crammairiens nous en donnent, fans que ces ac–
eens nous [ervent de guide pour élever , ou pour
ábaiffer le ton.
Pour ce qni eíl: du Latin , nous ne fai(ons [entir
aujourd'hlli la c¡uantité des mots que par rapport a la
penultieme (yllabe; encore faut - il que le mot ait
plus de deux (yllabes; car les mots qui n'ont que
del1x {yllaaes lont prononcés également , [oit que la
premiere (oit longue ou qn'elle (oit breve: par exem–
pIe, en vers , l'
a
eíl: brefdans
pater
&
long dans
ma–
ter,
cependant nous
pronon~ons
l'un
&
l'autre com–
me s'ils avoient la meme quantité.
Or , dans les Livres c¡ui (ervent a des lefrures pu–
blic¡ues, on (e (ert de l'aeeent aigu, que l'on place
différemllJent , {elon que la pénultieme eíl: breve ou
longue : par exemple , dans
matutinus,
nous ne fai–
[ons (entir la c¡uantité que fur la pénultieme
ti;
&
párce que cette pénultieme eíl: longue , nous y met–
tons l'accent aigu ,
l1lamtÚllts.
Au contraire , cette pénultieme
ti
eíl: breve dans
firóúnllS
;
alors
1I0US
mettons l'<tecent aigu fur l'anté–
penultieme
ro
,
{oit que dans les vers cette pémtltie–
me (oit breve ou c¡u'elle (oit longue. Cet accent ai–
gu (ert alors a nous marquer qu'il faut s'arreter com–
me fur un point d'appui (m eeHe antépénultieme
accennlée , afin d'avoir plus de facilité pour paffer
légerement (ur la pénultieme ,
&
la prononcer breve.
Au reíl:e, cette pratique ne s'obferve que dans les
Livres d'Egli(e deíl:inés a des lefrures publiques. Il
(eroit a fouhaiter qu'elle fUt egalement pratic¡uée a
l'égard des Livres Claffiques, pour accolltumer les
¡eunes gens a prononcer régulierement le Larin.
Nos
Imprimeurs ont confervé l'u(age de mettre
un accent circonflexe fm 1'4 de l'ablatif de la pre–
iniere déclinailon. Les Anciens relevoient la voix
fur
1'a
du nonúnatif,
&
le marc¡uoient par un accent
aigu,
muftí,
au lieu c¡u'a l'ablatif ils l'élevoient d'a–
bord ,
&
la rabai/Joient enfuite comme s'il y avoit
eu
mllfád
;
&
voilá l'accent circon/lexe que nous
avons con(ervé dans l'écrinlTe , quoique nous en
ayons perdu la prononciation.
On
le
(ert encore de l'accent circonflexe en Latín
quand il y a fyncope , comme
virilm
pOllT
yiromm ;
fej!ertiúm
pour
fejlatiorrun.
On emploie 1accent grave fur la derniere fyllabe
des adverbes ,
mal"J , ben"J
,
diu, &c.
Quelc¡ues-uns
meme veulent qu'on s'en (erve (ur tous les mots in–
déclina~l~s
, mais cene pratique n'eíl: pas exaé1:e–
ment fUlvle.
• Nous avons confervé la pratique des Aneiens
a
Act
l'égard de l'accent aigu ql1'ils marquoient
Útr
la (yl–
labe qui eíl: (uivie d'un enclitique,
arma virúmqut
cano.
Dans
vintmqlle
on éleve la voix
(UT
l'u de
yi–
mm,
&
on la laiffe tomber en
pronon~ant
que,
qui
efi un enclitique.
Ne, ye
font auffi deux autres en–
clitic¡ues; deforte qu'on éleve le ton (ur la (yllabe
c¡ui précede l'un de ces trois mots , a peu pres com–
me nous élevons en
Fran~ois
la fyllabe qui précede
un e muer: ainü, quoique dans
mener
l'e de la pre–
miere fyllabe
me
foit muet , cet
e
devient ouvert,
&
doit etre fOlltenu dans
je mene,
parce qu'alors
il
eíl:
fuivi d'un
e
muet qui linit le mot; cet
t
final devient
plus ai(ément muet quand la (yllabe qui le précede
efi {outenue. C'eíl: le mécham[me de la parole c¡ui
produit toutes ces variétés , c¡ui paroiffent des bilar–
reries ou des caprices de l'u[age a cellX c¡ui ignorent
les vérirables caufes des chofes.
Aii reíl:e, ce mot enclitique efi purement
Cree;
&
vient d'i¡úl.w,
inclino,
parce que ces mots (ont
comme inclinés
&
appuyés [ur la derniere fyllabe
du mot (Iui les précede.
Ob(ervez que lorfc¡ue ces fyllabes,
que, m
,
ve;
font partie effentielle du mot , deforte que íi vous les
retranchiez, le mot n'auroit plus la valetlT qui lui eíl:
propre; alors ces fyllabes n'ayant point la íignilica–
tion qu'e][es ont quand elles font enc1itiques , on
met l'accent, comme il convient , [elon que la pé–
nultieme du mot eíl: longue ou breve; ainíi dans
ubI–
que
on met l'accent [ur la pénultieme , parce que l'i
eíl: lon
p ,
au lieu c¡u'on le met fur l'amépénultieme
dans
denique
,
úndif/ue
,
útique.
On ne marque pas non plus l'accent (ur la pénul–
tieme avant le
ne
interro&atif, lorfc¡u'on éleve la
voix
{ur ce
ne
,
ego-m?
¡LeCl-ne
?
parce qu'alors ce
ne
eíl: aigu.
Il 1eroit a (ouhaiter que I'on
aceotltum~t
les jeu–
nes gens a marquer les accens dans leurs compoíi–
tions. 11 faudroit auffi que lorfque le mot écrit peut
avoir deux acceptions différentes, chacune de ces
accelltions
Ah
difiinguée par l'accent ; ainíi quand
oeciJo
vient de
cado,
l'i
eíl: bret
&
l'accent doit etre
fur l'antépénultieme, au lieu qu'on doit le marquer
fllT la pénultieme quand il íignilie
mer;
car alors l'i
eíl: long,
oceido
,
&
cet
oceIdo
vient de
credo.
Cette diíl:inilion devroit etre marc¡uée meme dans
les mots qui n'ont que deux fyllabes , ainíi il fau–
droir écrire
légit,
i!Jit,
av~c
l'accen! aigu,
&
¡¿git,
il alu, avec le circonflexe ;
vénit,
il vient ,
&
yenú,
il eíl: venu.
A l'égard des autres obfervations que les Cram–
mairiens ont faites fur la pratique des accens, par
exemple c¡uand la Méthode de P. R. dit c¡u'au mot
muliéris,
il fau! mettre I'accent fur l'e, quoic¡ue bref,
qu'il faut écrire
Jlos
avec un circonflexe,
'/pés
avec
un aigu,
&c.
Cette pratique n'étant fondée que fur
la prononciation des Anciens , il me (emble que non–
feulement elle nous feroit inutile , mais qu'elle POllT–
roit meme induire les jellJ1es gens en erreur enleur
faifant prononcer
nmlieris
long pendant qu'il eíl: bref,
ainíi des autres c¡ue l'on pourra voir dans la
M¿thod,
de
P. R.
pago
733. 73J ,
&c.
Finiffons cet amele par expo(er l'ufage que nous
faifons aujourd'hui, en
Fran~ois,
des accens que nous
avons
re~fts
dcs Ancien,.
Par un effet de ce concours de circoníl:ances, qU!
forment infeníiblement une languc nOllvelle, nos
Peres nOllS ont tran(mis trois {ons différens qll'ils
écrivoient par la meme lettre
e.
Ces trois [ons ,
qui
n'ont qu'un meme figne ou caraétere , font,
1
0.
L'
e
ouvert , comme dans
flr
,
Jllpit~r
,
la
m~r
»
1'enflr, &c.
2°.
L'e fermé, comme dans
hond, charité,
&c~
3°. Enfin l'e muet, eomme dans les monofyllabes
















