
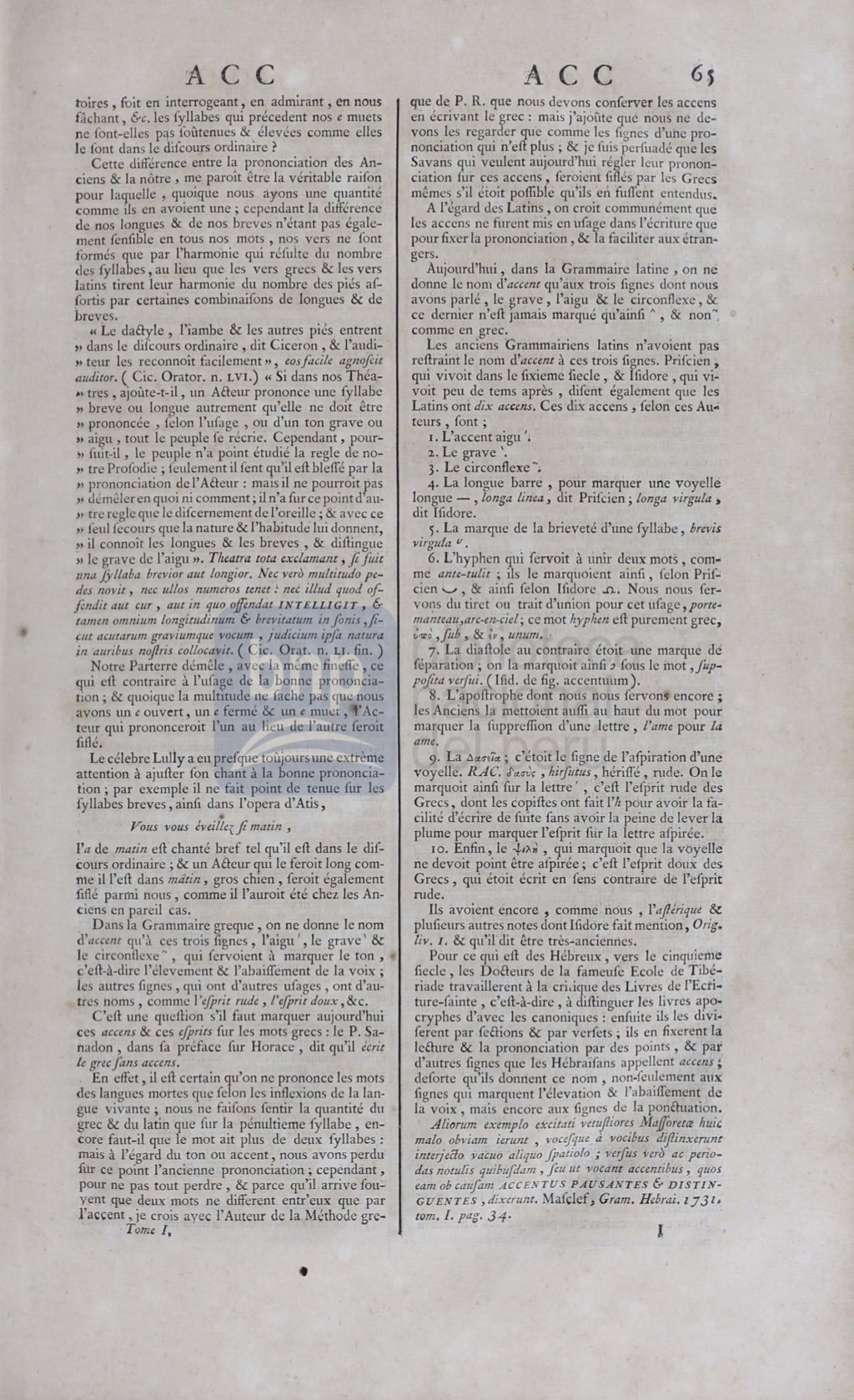
ACC
mires, foit en interrogeant, en admirant, en nous
filchant,
&c.
les fyllabes
qui
précedent nos
e
muets
ne font-elles P'ls !outenues & élevées comme elles
le (ont dans le di(cours ordinaire
?
Cette différence entre la prononciation des
An–
ciens & la norre , me paro1t &tre la véritable raifon
pour laquelle , quoique nous ayons une quantiré
comme ils en avoient une; cependant la différence
de nos longues & de nos breves n'étant pas égale–
ment (enlible en tous nos InOIs, nos vers ne (ont
fonnés que par l'harmonie qtÚ ré(ulte du nombre
des (yllabes , au lieu que les vers grecs.
&
les vers
latins tirent leur harmonie du nombre des piés af–
(ortis par certaines combinaifons de longues
&
de
breves.
" Le daétyle, l'iambe
&
les autres
pi~s
entrent
" dans le di!Cours ordinaire , dit Ciceron , & I'audi–
" teur les reconnolt facilement",
eosfacile agnqfcit
auditor.
(
Cic. Orator. n.
LVI.)
"Si dans nos Théa–
•• tres, ajoute-t-il , un Aaeur prononee tille fyllabe
" breve ou longue autrement qu'elle ne doit &tre
), prononcée , felon l'ufage , ou d'un ton grave ou
.. aigu , tout le peuple fe récrie. Cependant, ponr–
), (uit-il, le peuple n'a point étudié la regle de no–
" tre Profodie ; ü!ulement il fent qu\il eíl: bleífé par la
" prononciation de l'Aaeur : mais il ne pOUIToit fas
" démeleren quoi ni comment; iln'a [urce pointd au–
" tre regle que le di[cernementdel'oreille; & avec ee
,) (eul [eeoms que la natme
&
I'habitude lui donnent,
" il eonnoit les longues & les breves, & di!lingue
" le grave de l'aigu ".
Tlteatra tota exclamant
,Ji
fuit
una .fYllaba brevior aut longior. Nec yero multitudo pe–
des
novit, nec ¡tilos numeros tenet
.'
net
illud quod
01-
findit aut cur, aut in quo offindat
lNTELLlGlT
,
&
tamen omnium longitu.dinum
&
brevitatum in fonis ,ji–
cut acutarum graviumque vocum
,
j
udicium ipJa natura
inaItribus nojlris collocavit.
(
Cie. Orat. n.
LI.
fin. )
Notre Parterre démele , avec la meme fineífe , ce
c¡ui eíl: contraire
a
I'ufage de la bonne prononcia–
tion;
&
quoique la multitnde ne Cache pas que nous
avons un
e
ouvert, un
e
femlé
&
un
e
muer,
i'
Ae–
teur qui prononceroit l'un au lieu de I'autre [eroit
fiflé.
Le célebre Lully a en pre[que toftjours une extreme
attention a ajuíl:er Con chant a la bonne prononcia–
tion ; par exemple il ne fait point de tenue [ur les
[yllabes breves, ainfi dans I'opera d'Atis,
Vous vous éveíllc{ji matÍn ,
l'a de
matin
eíl: chanté bref tel qu'il eíl: dans le di[–
cours ordinaire ;
&
un Aaeur qui le feroit long com–
lÚe ill'eíl: dans
mátin,
gros chien , [eroit également
fiflé parmi nous, comme ill'auroit été chez les An–
ciens en pareil caso
D ans la Grammaire greque , on ne donne le nom
d'
acceTlt
qu'a ces trois fignes, l'aign ' , le grave \
&
le circonflexe
~,
qui fervoient
a
marquer le ton,
c'eíl:-a-dire l'élevement
&
l'abaiífement de la voix ;
les autres fignes , Cj11i ont d'autres ufages , ont d'au–
tres homs, comme
l'eJPrít rude, l'eJPrit doux,
&c.
C'eíl: une ql1eíl:ion s'il fant marquer aujourd'hui
ces
accens
& ces
efprits
[ur les mots grecs : le P. Sa–
nadon , dans [a préface [ur Horace, dit qu'il
écrít
le grecJans accens.
En effet,
il
eíl: certain qu'on ne prononce les mots
des langlles mortes que felon les inflexions de la lan–
gue vivante; nous ne fartons fentÍr la Cj11antité du
grec
&
du latin que [ur la pénultieme fyllabe, en–
core faut-il que le mot ait plus de deux [yllabes :
mais a l'égard du ton on accent, nous avons perdu
fur ce point l'ancienne prononciation; cependant,
pour ne pas tout perdre ,
&
paree qll'il arrive fon–
yent que deux mots ne different entl"eux Cj11e par
l'accent , je crois ayec l'Allteur de la Méthode gre-
Torne
l.
•
ACC
que de P. R. que nous devons conferver les accens
en écrivant le grec: mais j'ajoi'tte Cj11e nous ne de–
vons les regal'der Cj11e comme les flgnes d'uhe pro–
nonciation qui n'eíl: plus;
&
je [uis per[uadé Cj11e les
Savans gui veu.lent aujourd'hui régler lem pronon–
ciation fur ces accens , [eroient finés par les Grecs
memes s'il
~toit
poffible qu'ils en fit1fent entendus.
A l'égal'd des Latins , on croit communément (Itle
les accens ne furent ni..is en túage dans l'écriture que
pour fixer la prononciation ,
&
la faciliter aux étran-
gers.
.
Aujourd'htú, dans la Grammaire latine, on ne
donne le nom d'
accent
qu'aux trois fignes dont nous
avons parlé. le grave, I'aigu
&
le
circonflexe,
&
ce dernier n'eíl: jamais marqué qll'ainfi
A,
& non",
comme en greco
.
Les anciens Grammairiens latins n'avoient pas
refiraint le n0111 d'
accent
a ces trois fignes. Pri[cien;
qui vivoit dans le fixieme ueele, & lfidore , Cj11Í
vi–
voit peu de tems apres , difent également Cj11e les
Latins oni:
díx a"ens.
Ces dix accens , [elon ces
All~
tems , [ont ;
1.
L'accent aigu "
2.
Le grave '.
3. Le
circonflexe~.
4. La longue barre, pour marCj11er une voyelle
longue - ,
langa linea,
dit Prifcien;
longa vírgula,
dit Ifidore.
5. La marCj11e de la brieveté d'tine [yllábe,
brevís
virgula" .
6. L'hyphen qui [ervoit
a
unir deux mot5 , com–
me
ante-tulit
;
ils le marquoient ainfi, felon Pri[–
cien
'-J
,
&
ainfi [elon Ifidore
.!,l..
Nous nous [er–
vons du tiret ou trait d'union pour cet u[age
,porte–
ma~llealL,arc-eTlrciel;
ce mot
Ityphen
eíl: pttrement grec,
~rz¡rd
,[ub
,
&
:v ,
UllUlll. '
7. La diaíl:ole au contraire étoit une marCj11e dé
[éparation; on la marCj1lOit ainfi
~
[ous le mot
,JUP–
pofitd
verJili.
(I{¡d. de fig. accentuum).
8. L'apoíl:rophe dont nous nOtls [ervons encore;
les Anciens la mettoient auffi au haut du mot ponr
marCj11er la fuppreffion d'une lettre,
l'ame
pour
la
ame.
9. La
ll<Lt",,,,;
c'étoit le figne de l'a[piration d'uné
voyelle.
RAe.
ta.,J~
,
húfutus,
hériffé , rude. On le
marquoit ainfi fm la lettre ' , c'eíl: I'ef¡)rit mde des
Grecs, dont les copiíl:es ont fait l'lt pour avoir la fa–
cilité d'écrire de [uite fans avoir la peine de lever la
plume pour marquer l'e[prit [ur la lettre a[pirée.
10.
Enfin, le
+'A~
,
qui marquoit que la vbyelle
ne devoit point etre a[pirée; c'eíl: l'efprit doux des
Grecs, Cj11Í étoit écrit en [ens contraire de I'e[prit
mde.
Ils avoient encore , comme nóus ,
l'ajUrique
&
plufieurs autres notes dont lfidóre faitmention,
Orig.
liv.
l.
&
Cj1t'il dit etre
tres-anciemi.es.
Pour ce qui eíl: des Hébreux, vers le cinqüieme
fieele , les Doaeurs de la fameufe Ecole de Tibé–
riade travaillerent a la cri,ique des Livres de l'Ecti–
tme-[ainte , c'eíl:-a-dire, a difunguer les Ilvres apo·
cryphes d'avec les canoniques : enlilÍte ils les divi.
[erent par [eaions
&
par ver[ets ; ils en fixerent la
leaure
&
la prononciation par des points ,
&
par
d'autres fignes que les Hébrai[ans appellent
accellS;
de(orte Cj1l'ils donnent ce nom , non-feulement aux
fignes Cj11Í marquent l'élevation & I'abaiífement de
la voix, mais encore aux fignes de la portfulation.
Aliorum exemplo excitati vetufliores MafforulZ Ituíé
malo obviam ierant
,
vocifque a vocibus dijlínxerunt
ímujeélo vaCllO aliquo ftatiolo
;
verj'us .yero ac perio–
das nomlis quibufdam, ¡e/lut vocam accentih/ls, <juos
eam ob cauJam
ACCENTVS PAVSANTES
&
DlSTIN–
GVENTES
,dixerunt.
Mafdef,
Gram. Hebrai.
z:;3l .
tom.
l.
pago
34'
















