
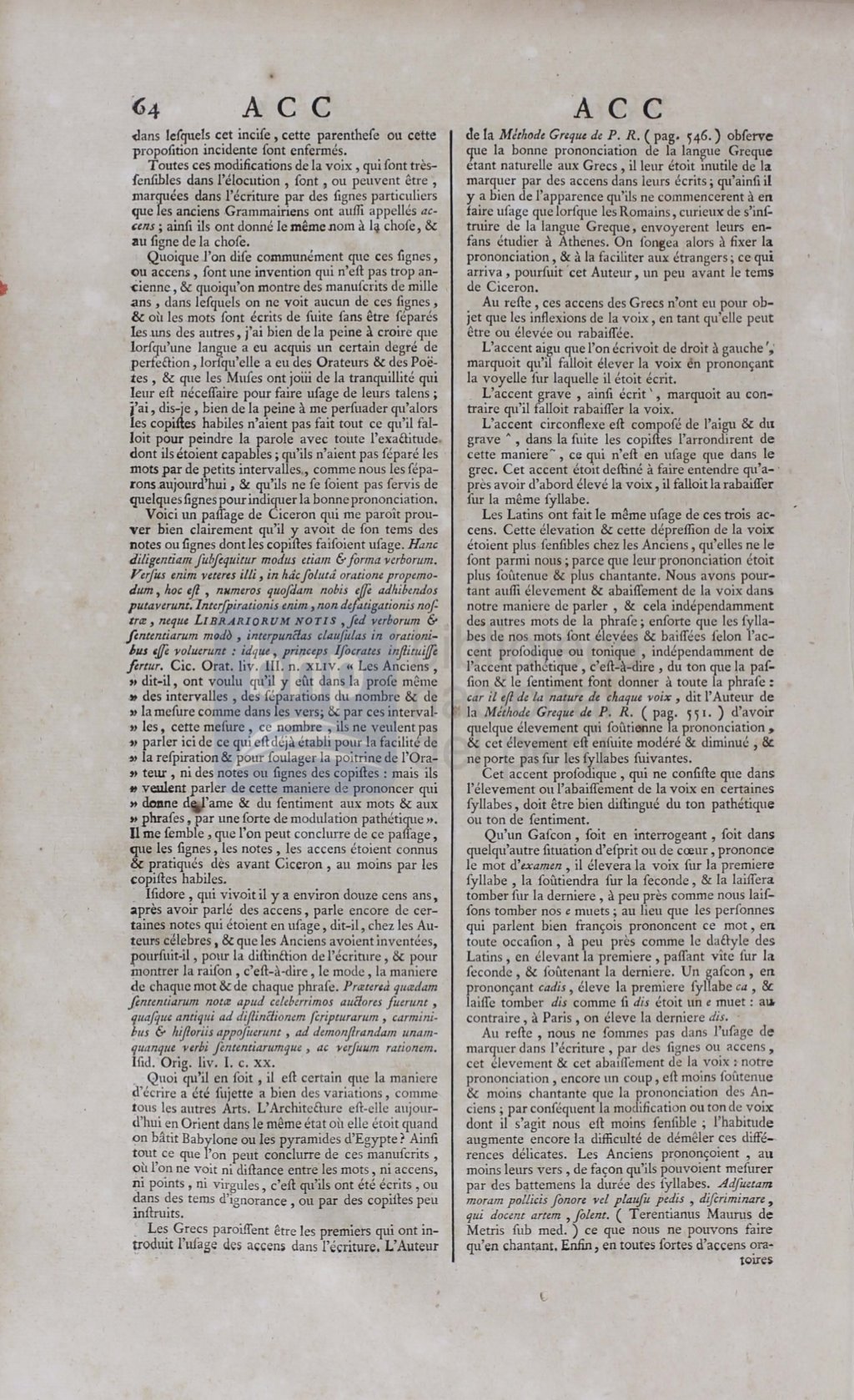
ACC
<lans le(quels cet inci(e ,cette parenthe(e ou cette
propoíition incidente (ont enfermés.
Toutes ces moditications de la voix , qui (ont tres–
fenfililes dans l'élocution , (ont , ou peuvent etre ,
marquées dans l'écriture par des íignes particuliers
que les anciens .Grammairiens ont aufTi appellés
ac–
cms
;
ainíi ils ont donné le meme
nom
a
l~
chofe, &
au figne de la chofe.
Quoique
1'00
dife communément que ces íignes,
ou acceru , (ont une invention qui n'efi pas trop
an–
.¿ienne, & quoiqu'on montre des manufcrits de mille
ans , dans lefquels on ne voit aucun de ces fignes,
&
011 les mots (ont écrits de (uite fans etre féparés
les
.lUlS
des autres, j'ai bien de la peine
a
croire que
lorfqu'une langue a eu acquis un certain degré de
perfeélion, 10rfqu'elle a eu des Orateurs & des Po
e–
tes, & que les Mufes ont joiii de la tranquillité qui
leur efi néceífaire póur faire mage de leurs talens ;
i'ai, dis-je , bien de la peine
a
me perfuader qu'alors
les copiftes habiles n'aient pas fait tout ce qu'il fal–
loit pour peindre la parole avec toute l'exaélitude
dont ils étoient capables ; qu'ils n'aient pas féparé les
mots par de petits intervalles., comme nous les fépa–
rons.aujourd'hui •
&
qu'ils ne (e foient pas fervis de
quelquesíignespourindiquer la bonne prononciation.
Voici un paífage de Ciceron qui me parolt prou–
ver bien clairement qn'il
y
avoit de fon tems des
notes ou lignes dont les copifies faifoient ufage.
Hane
Jiligenaam fubjequitur modus etiam
&
forma yerborum.
rerfus enim Yeleres illi
,
in hacfo/mi oratione propemo–
Jum, hoe
eJ!.
,
nI/meros quofdam nobis e(fo adhibendos
putayerum.7nterfPirationis enim
,
non depuigationis no}
trIE,
neque
LIB/i.A/
i.IO/i.UMNOTIS
,jed y"borum
&
flntentiarom modo
,
interpunaas cLaufu/as in orationi–
hus
e.f{e
yo/ueront
:
idque, princeps Ifocrates infiicuiffo
fmur.
Cic. Orat. liv. IIl. n.
XLIV. "
Les Anciens ,
" dit-il, ont voulu qu'il y eilt dans la profe meme
" des intervalles , des féparations du nombre & de
" la me(ure comme dans les vers; & par ces interval–
" les, cene mefure, ce nombre , ils ne veulent)Jas
~,
parler ici de ce
qui
efidéja établi pour la facilite de
." la refpiration
&
pour foulager la poitrine de I;Ora–
" telU' , ni des notes on íignes des copifies : mais ils
" :veulent
parler de cette maniere d'<: prononcer qui
" donne d l'ame
&
du fentiment aux mots & aux
t,
phrafes, par une forte ¿e modnlation pathétique
11.
n
me femble, que l'on peut conclnrre de ce paífage,
que les fignes, les notes, les accens étoient connus
&
pratiqués des avant Ciceron , au moins par les
copifies habiles.
líidore , qui vivoit il y a environ dome cens ans,
apres avoir parlé des accens , parle encore de cer–
taines notes qui étoient en ufage, dit-il, chez les Au–
teurs célebres. & qne les Anciens avoient inventées,
.{>ourfuit-il, ponr la difrinélion del'écriture, & pour
~ontrer
la raUon,
c~efi-a-dire,
le mode, la maniere
de chaque mot &de chaque phrafe.
PrlEteretl quadam
fintentiarum nota apud celeberrimos am70res fuemnt ,
t¡uafque antiqui ad dijlinaionem fcriptrtrarum, earmini–
Ims
&
¡tifioriis
app~temnt
,
ad demo/lfirandam unam–
f/Ilanque yerbi fententiarumque, ae yeifllum rationem.
ICld. Orig. liv.
1.
c. xx.
. Quoi qu'il en (oit ,il efi certain que la maniere
d'écrire a été (ujene a bien des variations, comme
10US les autres Arts. L'Architeélnre efi-elle aujom–
d'hui en Orient dans le meme état on elle étoit quand
~n
batit Babylone ou les pyramides d'Egypte?
Ainfi
tout ce que I'on peut conclurre de ces manufcrits ,
olll'on oe voit ni diaance entre les mots, ni accens,
ni points • ni vir.gules, c'efi ql.l'ils ont été écrits , ou
~ans ~es
tems d'ignorance , ou par des copules pen
¡nfinuts.
.
Le~
Grecs paroiífent etre les premiers ql.l.i ont in–
trodmt l'ufage des accen5 dans l'éninlre. L'Auteur
ACC
de la
Mltlzode GW¡ue de P. R.
(pag. 546.) ob(erve
c¡ue la bonne prononciation de la
lan(~ue
Grequc
etant naturelle aux Grecs , illeur étoit mutile de la
marquer par des accens dans leurs écrits; qu'ainíi il
y a bien de l'apparence qu'ils ne commencerent a en
taire ufage que lorfque les Romains, curieux de s'inf–
tmire de la langue Greque, envoyerent leurs en–
fans étudier
a
Athenes. On fongea alors a tixer la
prononciation,
&
a
la faciliter aux étrangers; ce qui
arriva,
pourfu.it'cet Auteur, un peu avant le tems
de Ciceron.
Au refie , ces accens des Grecs n'ont eu pour ob–
jet que les inflexions de la voix, en tant qu'elle peut
etre ou élevée ou rabailI'ée.
L'accent aigu que I'on écrivoit de droit agauche';
marquoit qu'il falloit élever la voix en
pronon~ant
la voyelle (m laquelle il étoit écrit.
L'accent grave , ainíi écrit \, marquoit au con–
traire qu'il falloit rabaiífer la voix.
L'accent circonflexe efi compofé de l'aígu & dll
grave
A ,
dans la (uite les copifies l'arrondirent de
cette maniere- , ce qui n'ea en u(age que dans le
greco Cet accent étoit deiliné
a
faire entendre qu'a- .
pres avoir d'abord élevé la voix , il falloit la rabaiífer
fur la meme (yllabe.
Les Latins ont fait le meme ufage de ces trois ac–
censo Cette élevation & cette dépreffion de la voix
étoient plus fen(ililes chez les Anciens , qu'elles ne le
font parmi nous ; parce que leur'Prononciation étoit
plus (olltenue
&
plus chantante. Nous avons pour–
tant auffi élevement & abaiífement de la voix dans
notre maniere de parler ,
&
cela indépendamment
des autres mots de la phrafe; en(orte que les fylla–
bes de nos mots (ont élevées & baiífées (elon l'ac–
ceot
profodi~ue
ou touique , indépendamment de
l'accent pathctique , c'efi-a-dire , du ton que la pa(–
íion & le fentiment font donner
a
toute la phra(e :
ear
i/
efl de La nature de ehaque yoix,
dit l'Auteur de
la
Méthode Greque de P. R.
(pag.
SS
l. )
d'avoir
quelque élevement qui foinioone la prononciation ,.
& cet élevement efi enfuite modéré
&
diminué ,
&
ne porte pas fur les fyllabes fuivantes.
Cet accent profodique , quí ne coníille que dans
l'élevement oul'abaiífement de la voix en certaines
(yllabes, doit etre bien dillingué du ton pathétique
ou ton de (entiment.
Qu'un Gafcon , (oit en interrogeant , {oit dans
quelqu'autre íimation d'efprit ou de creur , prononce
le mot
d'examen,
il élevera la voix fur la premiere
fyllabe , la foutiendra fur la feconde,
&
la laiífera
tomber (ur la derniere , a peu pres comme nous laif–
(ons tomber nos e muets ; au lieu que les per(onnes
qui parlent bien
fran~ois
prononcent ce mot, en
toute occaíion,
a
peu pres comme le daélyle des
Latins , en élevant la premiere , paífant vlte fur la
(econde, & fOlltenant la derniere. Un gafcon, en
pronon~ant
eadis
,
éleve la premiere fyllabe
ca
,
&
laiífe tomber
dis
comme fi
dis
étoit un e muet : a\1o
contraire,
a
Paris , on éleve la derniere
dis.
Au reae , nous ne fommes pas dans 1'1I(age de
mar~uer
dans l'écrinlre , par des íignes ou. accens ,
cet elevement
&
cet abaiírement de la V01X
¡.
notre
prononciation, encore un coup, efi
r:t0~ns
(olltenue
& moins chantante que la prononClatlOn des An–
ciens ; par conféquent la modification ou ton de.voix:
dont il s'agit nous efi moins (eníible ; I'habltude
au"mente encore la difficwté de démeler ces dilfé–
regces délicates. Les Anciens
pronon~oient
, au
moins leurs vers , de
fa~on
qu'ils pOllvoient mefurer
par des battemens la durée des fyllabes.
Adj'uetam
moram poLLieis Jonore yd plaufu pedis
,
difcriminare,
qui doeent artem ,Jolent.
(
Terentianus Maums de
Metris (ub medo ) ce que nous ne pouvons faire
qu'en chantan!. EnJin, en toutes (ortes d'accens <;>ra-
tOlTe5
l
















