
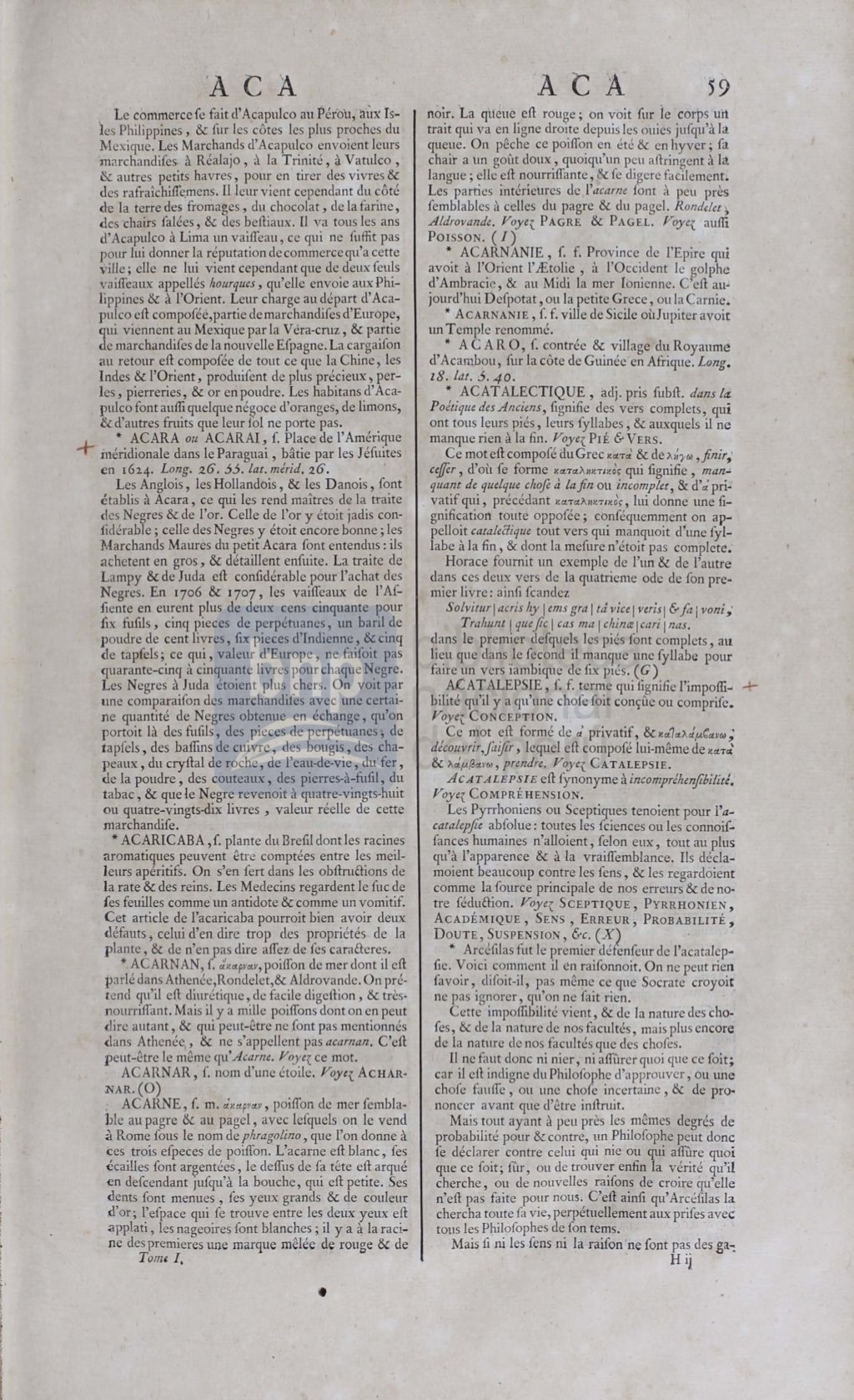
'A
e
A
Le commerce{e faitd'Acapulco au Pé{o'l1,
~Ull: Is~
~es
Philippines,
&
{ur les cotes les plus proches du
Mexique. Les Marchands d'Acapulco envoient leurs
marchandifes a Réalajo, a la Trinité, a Vatulco ,
&
autres petits havres, pour en tirer des vivres
&
des rafraichilfe.mens. IIlcur vient cependant du coté
dc la terre des fromages, du chocolat, de la farihe,
ces 'Chairs falées,
&
des belliaux.
II
va tous les ans
d'Acapulco
a
Lima un vaiífeau, ce qui ne fuffit pas
pour lui donner la réputation decommercequ'a cette
vilJe; elJe ne lui vient cependant que de deux {euls
vailfeaux appellés
hourques,
qu'elle envoie aux Phi–
Iippincs
&
a 1'0rient. Leur charge au départ d'Aca–
pulco eft compo{éé,partie demarchandifes d'Europe,
qui viennent au Mexique par la Vera-cmz,
&
paTtie
de marchandifes de la nouvelle Efpagne. La cargaifon
au retour eft compo{ée de tout ce e¡ue la Chine, les
Indes
&
l'Orient, produifent de plus précieux} per–
les, pierreries,
&
or en poudre. Les habitans d'Aca–
pulco font auíIi quelque négoce d'oranges, de limons,
&d'autres fruits e¡ue leur {ol ne porte paso
*
ACARA
Olt
ACARAI, f. Place de l'Amérique
..... méridionale dans le Paraguai ,
b~tie
par les Jé{uites
en
162.4.
Long.
26.
jj.
lato mérid.
26.
Les Anglois, les Rollandois,
&
les Danois, {ont
établis
a
Acara, ce qui les rend maltres dfi: la traite
des Negres
&
de I'or. Celle de I'or y étoit jadis con–
íidérable; celle des Negres y étoit encore bonne; les
Marchands Maures du petit Acara {ont entendus : ils
achetent en gros,
&
détaillent enCuite. La traite de
Lampy & de Juda eft confidérable pour I'achat des
Negres. En
1706
&
1707,
les vaiífeaux de l'Af–
llente en eurent plus de deux cens cine¡uante pour
íix fufus, cine¡ pieces de perpétuanes, un baril de
poudre de cent livres, [¡x pieces d'Indienne , & cinq
ce tap{els; ce qui, valeur d'Europe, ne fai{oit pas
<[uarante-cinq
a
cinquante livres pOtlT chaque Negre.
Les Negres
a
Juda étoient plus chers. On voit par
une comparai{on des marchandi{es avec une certai–
ne quantité de Negres obtenue en échange, qu'on
portoit la des ftúlls, des pieces de perpétuanes; de
tapfels, des baíIins de cuivre, des bougis, des cha-
1Jeaux, du cryftal de roche, de l'eau-de-vie, du fer,
ce la poudre, des couteaux, des pierres-a-ftl[¡l, du
tabac, & que le Negre revenoit a cJ1latre-vingts-huit
ou quatre-vingts-dix livres , valeur réelle de cette
marchandi{e.
*
ACARrCABA, f. plante du Bre[¡l dont les racines
aromatiques peuvent etre comptées entre les meil–
leurs aperitifs. On s'en fert dans les obftructions de
la rate & des reins. Les Medecins regardent le {uc de
fes feuilles comme un antidote & comme un vomitif.
Cet article de l'acaricaba pourroit bien avoir deux
défauts, celui d'en dire trop des propriétés de la
plante, & de n'en pas dire aífez de {es caracteres.
*
ACARNAN, {.
¿"Cl.p"Cl.V,
poiífon de mer dont il eíl:
parlé dans Athenée,Ronde!et,& Aldrovande. On pré–
tend qu'il eíl: diurétique, de facile digeíl:ion , & tres'
nourriffant. Mais
il
y a mille poiífons dont on en peut
("lire autant, & qui peut-etre ne (ont pas mentionnés
cans Athenée., & ne s'appellent pas
acaman.
C'eíl:
peut-etre le meme
qu'Aeame. Poye{
ce moto
ACARNAR,
f.
nom d'une étoile.
Voye{
ACHAR–
NAR.(O)
ACARNE,
f.
m.
dy.<f.pva.v,
poiífon de mer fembla–
ble au pagre & au pagel, avec lefcJ1le!s on le vend
aRome fous le nom de
phragolino,
que l'on donne
a
ces trois efpeces de poiífon. L'acarne eíl: blanc, {es
écailtes {ont
ar~entées,
le de/rus de fa téte eíl: arqué
en defcendant jufqu'a la bouche, qui eft petite. Ses
¿ents font menues , fes yeux grands & de couleur
.o'or; l'efpace qui fe trouve entre les deux yeux eft
applati, les nageoires font blanches ; il ya
a
la raci–
ne despremieres une marque melée de rouge & de
Tome
l.
•
AtA
59
noir. La qUeue eft rouge; on voit fur ie corps
un
trait qlli va en ligne droite depuis les ouies jufcp/a la
Cj1leue. On peche ce poiífon en été & en hyver; fa
chair a un goíh doux.. quoiqu'un
p~u
aíl:ringent a la
langue; elle eíl: nournífante,
&
{e digere facilement.
Les parries intéríeures de
l'acame
font
a
peu pres
(emblables
a
celles du pagre & dn pagel.
Rondelet,
Aldrovande. Poye{
PAGRE & PAGEL.
Voye{
auíIi
POISSON.
(1)
*
ACARNANIE,
f.
f. Province de l'Epire cJ11i
avoit a l'Orient I'JEtolie ,
a
l'Occident le golphe
d'Ambracip. ,
&
au Midi la mer Ioruenne. C'eft au–
jourd'hui Defpotat, ou la petite Grece, oula Carnie.
*
ACARNANIE,
f.
f. ville de Sicile ollJupiter avoit
un Temple renommé.
*
A C ARO,
f.
contrée & village du Royallmé
d'Acambou, {urla cote de Guinée en Afrique.
Long.
18. lato
j.
40.
*
ACATALECTIQUE, adj. pris fubíl:.
dans
IIZ
PoétiqlledesAllciens,
[¡grufie des vers complets, cJ11i
ont tous leurs piés , leurs fyllabes, & auxquels il ne
manque rien a la fin.
Voye{
PIÉ &VERS.
Ce moteíl: compo{é du Grec
~CI.'T<1.'
& de
A':'Y<oI
,finír;
eeffir,
d'ol! {e forme
Y.CI.'TCl.AIIY.'TIY.~~
Cj1IÍ íignifie,
man–
quant de quelqlle
e/LOfo
ti
lafin
Ol!
ineomplet,
&
d'
el
pri–
vatifqui, précédant
Y.
<1.TCl.AI)l<'TIY.d~,
lui donne une [¡–
gnification toute oppofée; conféquemment on ap–
pelloit
cataleRique
tout vers Cj1IÍ manCj1loit d'une fyl–
labe
a
la fin,
&
dont la mefure n'étoit pas complete.
Rorace fournit un exemple de l'un & de I'autre
dans ces deme vers de la Cj1latrieme ode de (on pre–
mier livre: ain[¡ fcandez
Solviwr
I
acris hy
I
ems gra
I
la
yice
I
veris
I
&
fa
¡
yoní,-
Tra/umt
I
quefe
I
cas ma
I
c!zinaq eari
I
nas.
dans le premier de{que!s les piés font complets, all
lieu que dans le fecond il manque une fyllabe pour
faire un vers lambicJ1le de fIX piés.
(G)
ALATALEPSIE,
f.
f.
terme Cj1IÍ figniñe l'impoffiJ
-l–
bilité Cj11'il y a qu'llne chofe {oit
con~fle
ou comprife.
Voye{
CONCEPTION.
Ce mot eíl: formé de
el
privatif, &
Y.Cl.7a.Ad¡.<CCl.v<ol;
déeouyrir,¡;lifir,
leque! eíl: compofé hlÍ-meme de
y.Cl.Tc1
&
Ad¡.<~"'v<ol,
premire. Poye{
CATALEPSIE.
ACATALEPSIE
eíl: fynonyme a
ineomprihuifibilité.
Voye{
COMPRÉHENSION.
Les Pyrrhoniens on Sceptiques tenoient pour
l'a–
eatalepfe
ab{olue: toutes les fciences ou les connoiC–
{ances humaines n'alloient, {elon eux, tout au plus
qn'a l'apparence & a la vraiilemblance. Ils décla–
moient beaucoup contre les fens , & les regardoient
comme la fource principale de nos erreurs & de no–
tre fédllélion.
Voye{
SCEPTIQUE, PYRRHONIEN,
ACADÉMIQUE, SENS , ERREUR, PROBABILITÉ,
DOUTE, SUSPENSION,
&e.
(X)
*
Arcé[¡las fllt le premier dé{cn{eur de l'acatalep–
[¡e. Voici comment il en raifonnoit. On ne peut ríen
{avoir, difoit-il, pas meme ce cJ11e Socrate croyoit
ne pas ignorer, qu'on ne {ait rien.
Cette impoíIibilité vient, & de la nantre des cho–
fes, & de la nature de nos facllltés, mais plus encore
de la nature de nos facultés que des chofes.
Il ne fam donc ni nier, ni aífftrer quoi que ce foit;
car il eíl: indigne du Philofophe d'approuver, ou tme
chofe fauífe, ou une chofe incertaine, & de pro–
noncer avant que d'etre inftmit.
Mais tout ayant
a
peu pres les memes degrés de
probabilité pour
&
contre, un Philofophe peut done
{e déclarer contre celui Cj1lÍ nie ou qui aífUre Cj1lOi
Cj1le ce {oit; fllr, ou de trouver enfin la vérité qll'il
cherche, Oll de nOllvelles raifons de croire 'fu'elle
n'eft pas faite pour notls. C'eft ain[¡ Cj11'Arcéfilas
la
chercha toute (a vie, perpétuellement aux prifes aveC'
tOllSles Philofophes de fon tems.
Mais [¡
JÚ
les {ens ni la fai{on ne {ont pas des ga-:
.
}{ ii
















