
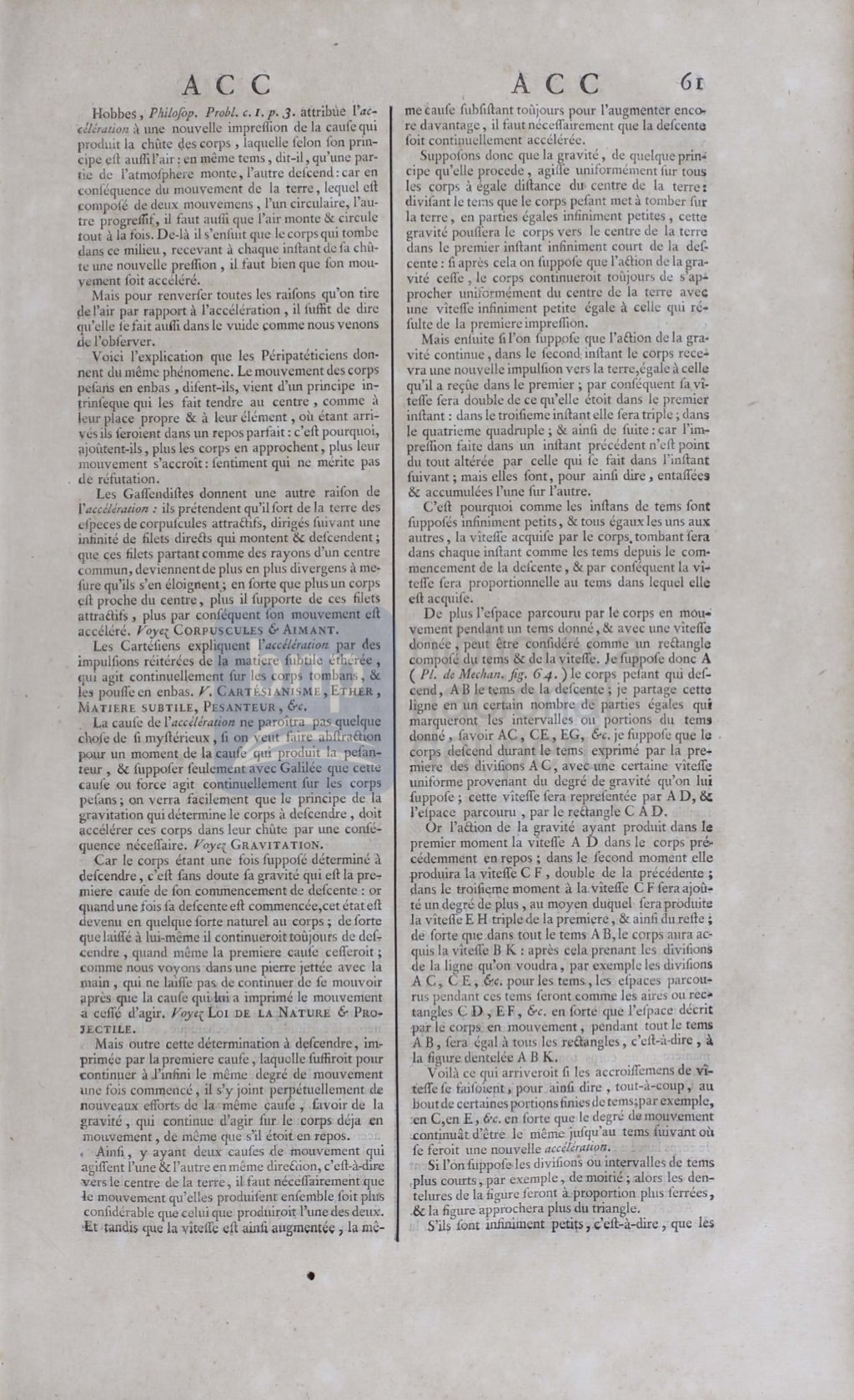
ACC
Hobbes,
PIz¡Iofop. ProM. c.I.p.3.
attribtie
l'ae–
cétJration
a
une nouvelle impre/lion de la caufe qui
produit la chllte des corps , laqllelle felon fOJl prin–
cipe eft auffil'air: en meme tems, dit-il, qu'une par–
tic de l'atmofphere monte, l'autre defcend: cal" en
conféquence du mouvement de la terre, lequel
dI:
j:ompofé de deux mouvemens , l'un circulaire, l'au–
tre progreRif,
iI
faut auffi que I'air monte
&
circule
tout a la
fois.
De-la
iI
s'enliut que le corps qui tombe
dans ce milielL, recevant achaque iníl:ant de fa Chtl–
te tille nouvelle preffion , il faut bien que fon mOll–
yement foit accélere.
Mais pour renverfer toutes les raifons qu'on tire
de l'air par rapport
a
l'accelération , il fuffit de dire
qll'elle
fe
fait auffi dans le V\úde comme nous venons
dc l'obferver.
Voici l'explication que les Péripatéticiens don–
nent du meme phenomene. Le mouvement des corps
pc(ans cn enbas , diúmt-ils, vient d'un príncipe in–
trinfeque qui les fait tendre au centre, comme
¡\
[em place propre
&
a
leur elément , Oll étant arri–
vés
iIs
feroient dans un repos parfait: c'eíl: pourquoi,
í1jofttent-ils, plus Les corps en approchent, plus lem
mouvement s'accroit: fenciment qui ne mérite pas
. de réfutation.
Les Galfendifles donnent une autre raifon de
l'accét.fraúon
:
ils prétendent qu'i1 fort de la terre des
c(peces de corpu(cuJes artrafrifs, dirigés fuivant une
intinité de füets direéls qui montent
&
de(cendent;
quc ces füets partant comme des rayons d'un centre
commun, deviennentde plus en plus divergens a me–
(ure qu'i1s s'en éloignent.; en forte que plus un corps
efl proche du centre, plus il fupporte de ces füets
attraélifs, plus par conféquent Ion mouvement eft
accélere.
Voye{
CORPUSCULES
&
AIMANT.
Les Cartéíiens expliquent
l'accéUration
par des
impuJúons réitérées de la matiere fubtile éthérée ,
qUl agit continuellement fur les corps tombans,
&
les poulfeen enbas.
V.
CARTÉSIANISME,ETHER,
MATIERE SUBTlLE, PESANTEUR,
&c.
La caufe de
l'accJlération
ne paroitra pas quelque
chofe de fi myflérieux , fi on veut faire abflraélion
pour un moment de la cauCe qtÚ produit la pe(an–
teur ,
&
filppofer feuJement avec Galilée que ceHe
caufe OH force agit contínuellement fur les corps
pefans; on yerra facilement que l€ príncipe de la
gravitation qui détermine le corps
a
defcendre , doit
¡¡ccélérer
ces
corps dans leur chtlte par ll11e cOlúé–
quence néceffaire.
Voye{
GRAVITAnON.
Car le corps étant une fois (uppofé determiné a
defcendre, c'eft fans doute fa gravité qui efl la pre–
miere caufe de fon cornmencement de defcente :
ox
qm:ndune fois fa defcente efl cornmencee,cet étateíl:
devenu en quelque forte naturel an corps; deforte
que laiífé
a
lui-meme
iI
contínueroit toujours de
def~
cendre, quand meme la premiere caufe eeíferoit;
comme nous voyons dans une pierre jettée avee la
lIIaín , qui ne biffe pas de continuer de fe mouvoir
í1pres
~e
la
caufe quil.l1i a imprimé le mouvement
,¡¡
ce1f\! d'agir.
Voye{LOI
DE LA NATURE
&
PROT
:JECTrLE.
Mais outre oette déterrnination a defcendre, iJIlr
primée par la premiere caufe , laquolle fuffiroit pour
continuer
a
l'infini le meme degré
de
mouvement
une fois commencé, il s'y joint perpétuellement
de
nouveaox efforts de la meme caufe, favoir de la
gravité, qui continue d'agir fuI' le co.tps déja en
mOlLVement , de m@me que s'i1 etoit en reposo
. Ainft, y ayant deux caufes de mouvement quí
agifI'ent l'une
&
l'autre en meme direCcion, c'eft-a-dir.e
vers le centre de la terre,
iI
faut nécelfairement que
le mouvement qu'elles produi(enr enfemble (oit phf5
coníidérable que celui que produiroit l'une des deux.
-it tandis (lue la VltefI'e efl
amfl
augmenfée , la
me-
•
ACC
6r
me caufe fubflflant tOlljours pour l'augmentet enco.
re davantagc, il faut nécefI'airement que la defcenta
foit continuellement accélérée.
Suppofons done que la gravité, de quelque prin":
cipe qu'elle procede, agi/l'e uniformément (ur tous
les corps a égale diflance du centre de la terre:
divi(ant le tems que le corps pefant met a tomber (ur
la tcrre, en partíes égales infinirnent petites, cette
gravité poulfera le corps vers le centre de la terre
dans le premier inftant infiniment court de la def.
cente : íi apres cela on fuppo(e que l'aélion de la gra–
vité cefI'e , le corps continueroit
tOfljOllf~
de s'ap–
procher uniformément du centre de la terre avec
une vltefI'e inliniment petite égale
a
celle 'lui ré–
fulte de la premiereimpreffion.
Mais enfuite ft l'on fuppofe que l'aélion de la gra–
vité continuc, dans le (econd iníl:ant le corps rece–
vra une nouvelle impulfion vers la terre,égaJe
¡\
celle
qu'i1 a res:ue dans le premier ; par con(équent (a vi–
teffe fera double de ce qu'elle étoit dans le premier
inflant: dans le troifieme inflant elle fera triple; danlO
le quatrieme quadruple ;
&
ainíi de fuite: car l'im–
preffion faite dans un inflant précédent n'cfl poínt
du tout altérée par celle qu..i fe fait dans l'infiant
fuivant ; mais elles font, pour ainíi dire, entalfées
&
accumulées l'une fur l'autre.
Cefl pourquoi comme les inflans de tems (ont
fuppofés infiniment petits,
&
tous égaux les UJlS aux
atltres, la vitelfe acqui(e par le corps. tombant fera
dans chaque inftant comme les tems depuis le com–
mencement de la defcente,
&
par conféquent la vi..
telfe fera proportionnelle au tems dans lequel elle
efl acc¡uife.
De plus l'efpace parcouflI par le corps en
mOll~
vement pendant un tems donné,
&
avec une vitefI'e
donnée , peut erre coníidéré COrnme un reélangle
compofé du tems
&
de la vitefI'e. Je fuppofe done A
(
PI. de Mec!trlll. fig.
64.)
le corps pefant c¡ui def–
cend, A
B
le tems de la defcente ; je partage cette
Jigne en un certain nombre de parties égales quí
marqueront les intervalles Oll portions du tems
donné, favoir AC, CE, EG,
&c.
je fuppo(e que le
corps defcend durant le tems exprimé par la pre–
miere des divifions A C, avee une certaine vlteiI'e
uniforme provenant du degré de gravité qu'on lui
fuppo(e; cette vltefI'e [era reprefentée par A D,
&
l'efpace parcouru , par le reélangle CAD.
Or l'aélion de la
~ravité
ayant produit dans
le
premier moment la vltefI'e A D dans le corps prb–
cédcmment
en
repos ; dans le íecond moment elle
prodllÍra la vltefI'e C
F ,
double de la précédente ;
clans le
troiíi~J1le
moment a la.vlteífc C
F
(era ajon...
té un degré de plus, au moyen duquel fera produite
la vitefI'e E H triple de la premil:re ,
&
ainftdu refle ;
de forte que dans tout le tems A
B,
le corps aura ac–
quis la v1teffe
B K :
apres cela prenant les diviúons
.de la ligne qu'on voudra, par exemple les divifions
A
C, CE,
&c.
pour les tems, les efi)aees parcou–
rus pendant ces tems [eront comme les aires ou reciO
tangLes C D , E
F,
&c.
en forre que l'e(pace décrit
'Par le corps en mouvement, pendant tout le tems
A
B,
fera egal
¡\
tous les reélangles, c'efr-a-dire ,
el
la figure dentclee A
BK.
Voila ce c¡ui arriveroit íi les accroiffemens de
vi–
teife
(e
fujfoiept; pour ainíi dire , tollt-a-coup, au
boutde certaines portions liniesde tems;par exemple,
en C,en E,
&c.
en forte que le degré de mouvement
..continllatd'etre le meme jtúqu'au tems fuivant Oll
fe feroit une nOllvelle
accéU",ti(J(I.
Si.l'onnlppo[c les divifions ou intervallcs ele tems
plus courts , par exemple, de moitié ; alors les den–
telures de la figure (eront
a.
proporti.onplus terrées,
.&
la figure approchera plus du triangle.
S'ils
[ont
Í1lfinimcnt
petits, c'dl:-a-dire ,
que les
















