
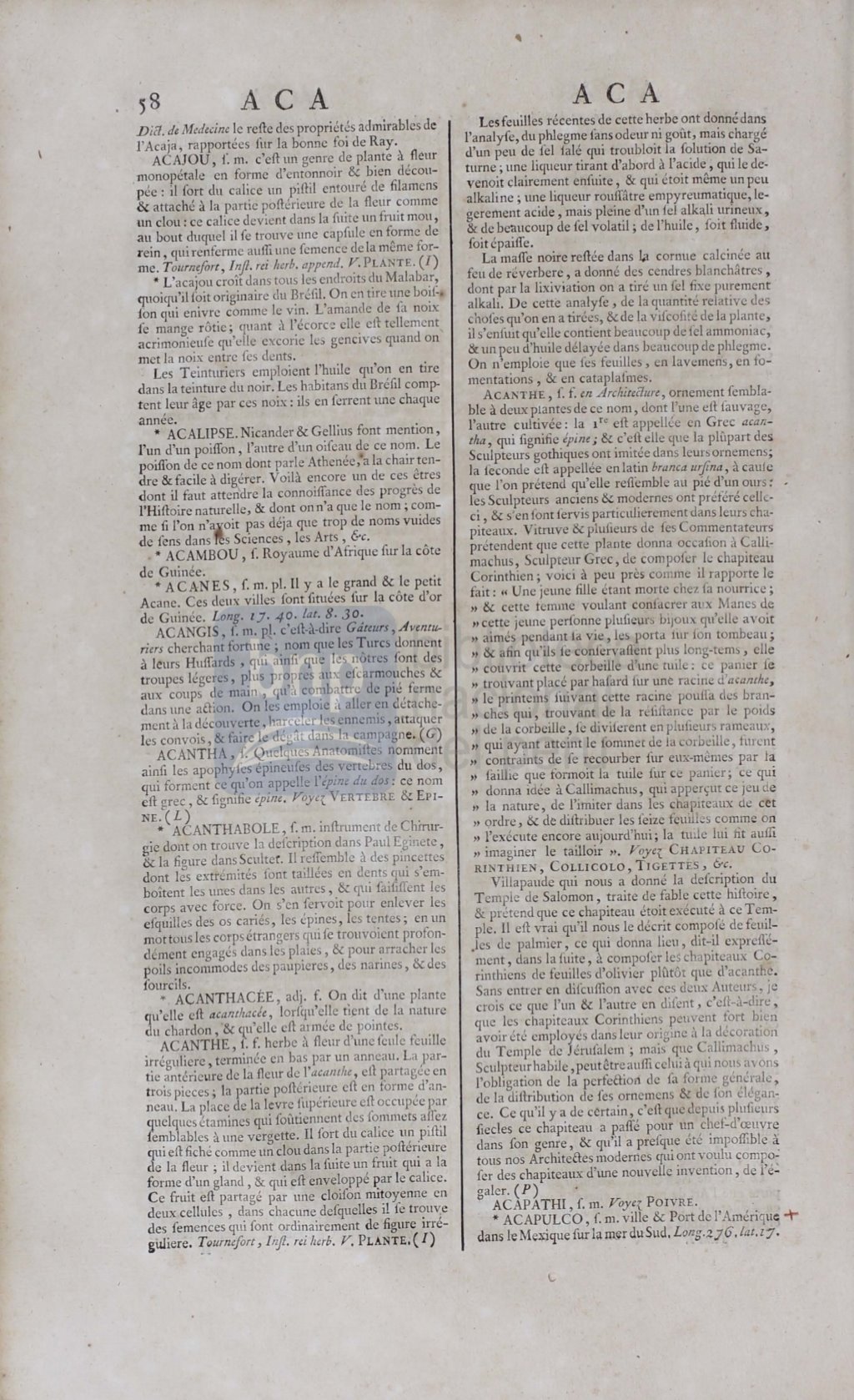
ACA
DiEl. de Mededne
le refre des propriétés admirables de
l'Acaja, rapportées fm la bonne foi de Ray.
ACAJOU,
J:
m. c'cl!: un genre de plante
a
flem
monopétale en forme d'emonnoir & bien décou–
pée : il fort du calice un pil!:il entouré de filamens
&
attaché a la partie pol!:érieure de la fleur comme
lill dou : ce calice devient dans la fuite un fmit mou,
au bout duquel il fe trouve une cap(ule en forme de
rein, qui renfenue auffi une (emence de la meme for–
me.
Tournefort,
111ft.
rei
f¿crb. append.
V.
PLANTE.
(1)
"L'acajou crolt dans tous les endroits du Malabar,
quoiqu'il (oit originaire du Bréfil. On en tire une boif..
fon qui enivre comme le vino L'amandc de (a noix
fe mange rotie; quant ;\ l'écorc_ elle e11: tellement
acrimonieu(e (¡u'elle excorie les gencives quand on
mer la noix entre fes dcnts.
Les Teinturiers emploient I'huile qu'on en tire
dans la teinture du noir. Les habitans du Bréfil comp·
tent leUT age par ces noix: ils en ferrent 1ille chaque
année.
" ACALIPSE. Nicander & Gellius font mention,
l'un d'un poiífon , l'autre d'un oi(eau de ce nomo Le
poiílon de ce nom dom parle Athenée;a la chair ten–
dre
&
facile
a
digérer. Voila encore un ele ces etres
dont il faut attendre la connoiífance eles progres de
I'Hil!:oire naturelle,
&
elom on n'a que le nom ; com–
me fi l'on n'a oir pas déja que trop de noms vuides
de (ens dans s Sciences , les Arts ,
&c.
" ACAMBOU , f. Royaume d'Afriqlle (UT la cote
de GlIinée.
"ACAN ES,
f.
m. pI.
Il Y
a le grand & le petit
Acane. Ces deux villes (ont fituées
(ur
la cote d'or
de Guinée.
Long. l:J. 40.
lato
8.
JO .
ACANGrS,
f.
m. pI. c'el!:-a-dire
Gáteurs,
Aventu–
riers
cherchant fortune ; nom que les T mcs donnent
a
leurs Huifards , qui ainfi que les Horres (om des
troupes légcres, plus propres aux c(carmouches &
aux COllpS de main , qu'a combattrc de pié ferme
dans une aEtion. On les emploie
a
aller en détache–
ment
a
la découverte , harccler les ennemis , attaquer
les convois,
&
faire le dégat dan's la campagne.
(G)
ACANTHA, f. Quelques Anatomií1:es nomment
ainú les apophyfes épineufes des vert bres du dos,
qui forment ce 9u'on appelle
I'¿pine da dos:
ce nom
efr grec, & figrufie
épine.
Voye{
VERTEBRE & EPI–
NE.
(L)
" ACANTHABOLE,
f.
m. iní1:rllmcnt de Chi-rur–
gie dont on trollve la eleleription dan Paul Eginete ,
& la figure dans Scultec. Il reífemble
a
des pincettes
dont les extrémités (om taillées en dents c¡ui s'em–
bOltent les unes dans les autres, & qui (aifiíIent les
corps avec force. On s'en feryoit pour enlever les
e(quilles des os cariés, les epines, les rentes; en un
mor tous les corps étrangers qui (e trouvoient profon–
dément engages dans les plaies , & pour arracher les
poils incommodcs des paupiercs, des narines,
&
des
fourcils.
'" ACANTHACÉE, adj. f. On dit d'une plante
qu'elle
el\:
acantltacée,
lorfe¡u'elle t1.ent de la nature
du chardon, & '{tl'elle el!: almee de pointes.
ACANTHE,
1.
f. herbe
a
fleur d'une (enle fcuille
irreguliere, terminée en bas par un anneau. La par–
tie antérieme de la fleur de
l'acallllte,
efr partagée en
trois pieces; la partie pofrérieure el!: en forme d'an–
neau. La place de la levre litpérienre el!: occupée par
Cjuelqucs étamines qui (olltiennent des (ommets alfez
femblables
a
une vergette. I1 fort du calice un pill:il
qui el!: fiché comme un d ou dans la partie pol!:éricure
ele la fleur ; il devient daos la fuite un fruit qui a la
forme d'un gland ,
&
qui el!: enveloppé par le calice.
Ce fmit el!: partagé par une doi(on mitoyenne en
deux cellules , d.ans chacl1ne de(ql1elles il fe trouve
des (emences qm (ont orclinaircment de figure irré–
gUliere.
~()urmfort,
IlIji.
rú herb. V.
PLANTE. (
1)
,
ACA
Les feuilles récentes de cette herbe ont donne dans
l'analy(e, du phlegme fans odenr ni gOllt, mais chargé
d'llI1 peu de fel jalé c¡ui tro1lbloit la folution de Sa–
turne; une liqueur tirant d'abord
a
l'acide , qui le de–
veno.itclairem:nt enfuite ,
A&
Cjl1i éroít mem: un pen
alkaltne; un.e ltqueur rouífatre empyreumatIque, le–
gerement aClde , mais pleine d'un lel alka,li urineux ,
&
de beaucoup de fel volatil; de l'huile, foit fluide,
foitépaiífe.
La maífe noire rel!:ée dans
lp
cornue caIcinée al!
fen de
r~verbere
, a donné des cendres blanchatres
dont .par la lixiviation on a tiré 1m fel fixe
puremen~
alkall. De cette analyfe, de la quantité relative des
~h?fes qu'o~
en a tiré:s, &de la vIfcofité de la plante,
il s enflllt Cju elle contlent beaucoup de fel ammoniac
&
un peu d'huile délayée dans beaucoup de phlegme:
On n'emploie que les feuilles, en lavemens en fo-
mentations ,
&
en cataplafmes.
'
ACANTHE, f.
f.
en
Archileallre,
ornement fembla–
~le
a
deux
p.la~tes
de ce nom, dom !'une el!: fauvage,
1
autre cultIvee: la
1
r.
el!: appeUee en Grec
acan–
tha,
CJlti fignifie
épine ;
& c'eft elle que la plupart des
Sculpteurs gothiques ont imitée dans leursornemens–
la {econde el!: appellée en Latin
branca llrjna
a
caul~
que 1'0n prérend qu'elle refiemble au pié
d'~n
onrs:
lesSculpteurs anciens & modernes ont préteré celle–
ci, & s'en [om {ervis partlc1uierement dans leurs cha–
piteaux. Vitruve & plufieurs de fes CommentateuTS
prérendent que cette plante donna occafion
a
Calli–
machus, Scnlpteur Grec, de compoler le chapiteau
Corinthien; voici
a
peu pres comme il rapporte le
fa ir :
1<
Une jeune filie étant morte chez (a nourrice'
" & cette temme vOluant confacrer al'X Manes
d~
"cette jeune per(onne
plufieur~
blJOUX qu'elle avoit
" aimés pendant la vie, les porta
lUr
{on tombeau -
" & afin qu'ils fe conlervafiem plus Long-rems,
el1~
" couvrit cette corbeille d'un(; tuue: ce pamer fe
" trouvant placé par ha(ard
1ur
uné racine
d'acantf¿e,
" le printems fluvant cette racine pouifa d.:s bran–
" ches qni, trouvant de la r li11:ance par le pOlds
)/ de .Ia corbeille.' fe cliviíerent en plulieurs rameaux,
" qm
a~m
attemt le fommet de la corbeille,
tmcnt
"
c~nt:ramts
d_c fe
~courber
fur eux-memes par la
" íailhe que tOnuOlt la tUlle litr ce panier; ce c¡ui
" elonna Idée
a
Callimachus, qui appcrs;ur ce Jeu de
" la nature, de l'imirer dans les chaplteaux
de
cet
" ordre, & de clifrribuer les íiúze fcuilles comme on
" l'exécnte encore aujourd'hui; la tuJe lui tit auffi
"imaginer Le tailloir ".
Voye{
CHAPITEAU Co–
RINTHIEN, COLLI COLO, TIGETTES,
&c.
Villapaude qlli nous a donné la dcfcription du
Temple de Salomon, traite de fable cette hiil:oire ,
&
prétend que ce chapiteau étoit exécuté
a
ce Tem–
ple. Il el!: vrai CJlI'il nous le decrit
compoCé
de fe1ul–
.les de palmier, ce qui donna lieu, dit-il exprefie–
ment, dans la luite,
a
compoler leSchapiteaux Co–
rinthiens de feuilles d'olivier plutot que d'acanthe.
Sans entrer en c\i(cuffion avec ces denx Auteurs, je
crois ce que l'un
&
l'autre en clifent, c'eft-a-dire,
CJlle les chapiteaux Corintlúens peuvent tort bH;!n
avoir été employés dans Leur origine
á
la décoration
du Temple de Jérufalem ; mais CJlle Callimachus ,
SClllpteurhabile,peutetreauffi ccllii
a
qui nom a"ons
l'obligation de la perteébofl dc fa fOlllle généralc,
de la clifuibution de fes ornemcns
&
de ion élegan–
ce. Ce qu'il ya de certain, c'el!: que depuis pluficms
ficeles ce chapiteau a pafie pour un chcf·d'reuvre
dans fon genre, & Cju'il a pre(que été impoffible
a
tous nos ArchiteEtes modernes c¡ui om voulu compo:
fer des chapiteaux d'tU1e nouveUe invention, de
I'é~
gaLer. (P)
ACAPATHr,
f.
m.
Voye{
POIVRE.
*
ACAPULCO,
f.
m. ville
&
Port de l'Amériquc
+
dans leM
~ique
furlam.erduSlld.
L~ng.2:J6.
!(/l.l7·
















