
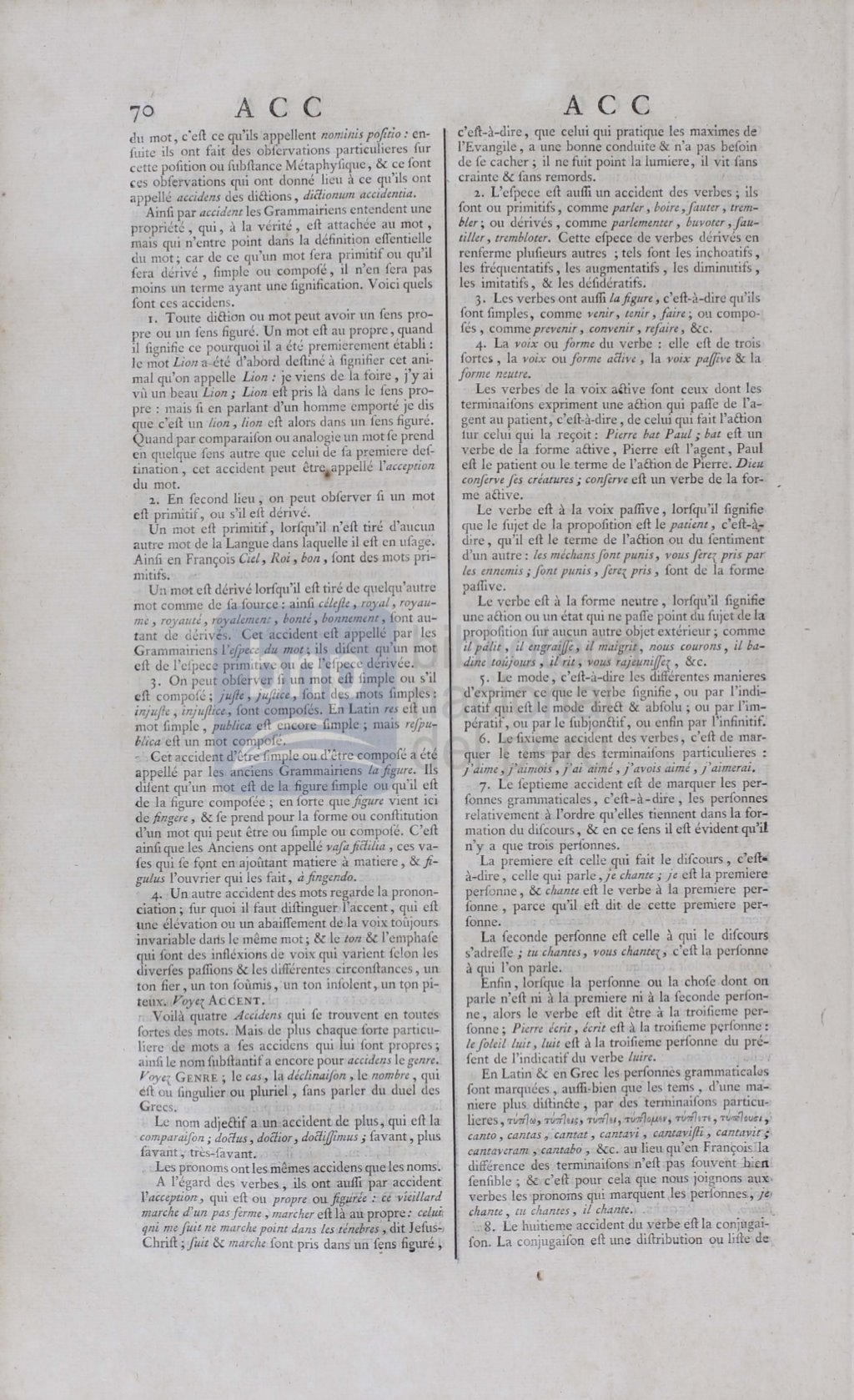
ACC
du mot, c'eíl: ce qu'ils appellent
nOn/inis poJitio:
en–
[uite ils ont fait des obrervations particulieres [m
cette pofition ou [ubíl:ance Métaphyfic¡ue, & ce font
ces obfervations qtú ont donné lien
a
ce qu'ils ont
appellé
accidms
des diUiollS,
d¡aionum accidentia,
Ainfi par
accident
les Grammairiens entendent une
propriété, qui,
¡'¡
la vérité, eíl: attachée au mot ,
mais qui n'enlTe point dans la définition clfentielle
du mot; car dc ce c¡u'un mot [era primitif ou qu'il
fera dérivé , fimple on
comp~fé,
!l n'en rera pas
moins un terme ayant une figmficatlOn, VOICI c¡uels
font ces accidcns,
1.
TOllte diilion ou mot peut avoir un fens pro–
pre ou un [ens figuré. Un mot eíl: an propre, quand
il fignific ce pourc¡uoi il a été premicrcment établi :
le
mot
Lion-a-été
d'abord deíl:iné
a
fignifier cet ani–
mal qu'on appelle
Lion:
je viens de la foire , j'yai
Vtl un beau
Lion ; Lion
eíl: pris la dans le fens pro–
pre : milis fi en parlant d'un homme emporté je dis
que c'eíl:
un
!ion , !ion
eíl: alors dans un [ens figuré.
Qlland par comparaifon ou analogie un mot fe prcnd
en quelc¡ue [ens alltre que celui de fa premiere def–
tination, cet accident pent etrc appellé
l'acception
du moto
2..
En fecond lieu, on peut obferver fi un mot
eíl: primitif, ou s'il eíl: dérivé.
Un mot
ea
primitif, lorfc¡u'il n'ea tiré d'aucun
autre mot de la Langue dans laquelle il
ea
en u[1ge.
Ainíi en Fran<;ois
Cid, Roi, bon,
font des mots pri–
mitifs.
Un mOl eíl: dérivé lorfqu'il
ea
tiré de quelc¡u'autre
mot comme de fa fource : ainíi
célifle , royal, royau–
me, roy aucJ, royalemem, bond, bonmment,
font au–
tant de dérivés. Cet accident ea appellé par les
Grammairiens
l'1Pece du mot;
ils difent qu'un mot
ea de I'cfpccc primitive ou de l'efpece dérivée.
3.
On peut obferver fi un mOr eíl: úmple 011 s'il
eíl: compofé;
juJle , juJlice,
font des mots fimples:
injufte; injllftice,
font compofés. En Latin
res
eíl: un
mot fimple ,
publica
eíl: encore fimple; mais
reJPu–
blica
eíl: un mot compofé.
- Cet accident d'etre fimple Ol! d'etre comporé a été
appellé par les anciens Grammairiens
la jigure.
Ils
dilent qu'un mot eíl: de la figure fimple ou qu'il eíl:
de la figure compofée; en forte
quejigllre
vient ici
de
/inget'e ,
& fe prend pour la forme 011 conaitution
d'un mot qui peut etre ou fimple ou compole.
C'ea
ainfiql.leles Anciens ont appellé
vafajifIilia,
ces va–
fes qui fe f<,mt en ajolttant matiere a maticre,
&ji–
gulliS
l'ouvrier c¡ui les fait,
djingendo.
4.
Un autre accident des mots regarde la pronon–
eiation; {ur quoi il faut diaingucr l'accent, qui
ca
une élévation ou un abaiífement de la voix tolijours
invariable darts le meme mot; & le
ton
& ['empha{e
qui {ont des infléxions de voix qui varient fclon les
diverres paffions & les différentes circoníl:ances, un
ton fier, un ton follinis, un ton infolent, un tpn pi–
teux.
Voyez AcCENT.
Voila quatre
Accidens
qui fe trouvent en toutes
fortes des mots, Mais de plus chac¡ue forte particu–
lierc de mots a fes accidens qui lui font propres;
ainu le nom fubaantif a encore pour
acádens
le
genre,
Voyez
GENRE ;
le
cas,
la
déclinaifon,
le
nombre,
ql1i
eíl: ou fingulier ou pluriel , fans parler du duel des
Grccs.
Le nom adjeétif a un accident de plus, qui eíl: la
comparaiJon; dofIus, dofIior, dofIiffimus
j
favant, plus
favant, tres-ravant,
Les ptonoms ont les m@mes accidens que les noms,
A
l'~garcl
dcs verbes , ils ont auffi: par accident
!'acceptLOll,
qui eíl: ou
propre oujigwée
:
ce vieillard
ma:elle d'
~1Il
pas firme, marcher
eíl: la au propre:
celui
qlll
~Je
fiat m marche point dans les témores,
dit
J
efus–
Chnil: ;
filit
&
marche
font pris dans un
f~ns
figuré,
ACC
c'etl:-a-wre, que celui qui pratique les maximes ele
l'Evangile, a une bonne conduite
&
n'a pas befoin
de re cacher; il nc fuit point la ltlmiere, il vit fans
crainte & fans remorels,
2..
L'efpece eíl: auffi un accident des verbes . ils
{011t
ou primitifs, comme
parler, boire ,jmuer, t:em–
b~er;
ou dérivés , comme
parlementer, buvoter, fau–
tdter, trembloter.
Cette erpece de verbes dérivés en
renferme plufieurs autres ; tels font les inchoatifs ,
les fréCfllentatifs, les augmentatifs , les diminutifs ,
les imítatifs,
&
les défidératifs.
~.
Les verbes ont auffi
la jigure,
c'ea-a-dire c¡u'ils
font fimples, comme
venir, tenir, faire;
0\1
compo–
fés , comme
prevenir, convenir, refaire,
&c.
4-
La
voix
ou
forme
du verbe : elle
ca
de trois
fortes, la
voix
ou
forme aaive,
la
voix paffive
&
la
[orille neUlre.
Les verbes de la voix a!live font ceux dont les
terminaifons expriment une aétion qui palfe de I'a–
gent au patient, c'eíl:-a-dire, de cehu (fui fait I'ailion
lur cehú qui la re<;oit:
Piure bat Paul; bat
eíl: un
vcrbe de la forme ailive, Pierre ea I'agent, Pau!
ea le patient ou le terme de I'ailion de Pierre.
D ieu
conflrve fes créatures; confln'e
ea tm verbe de la for–
me ailive.
Le verbe eíl: a la voix paffive, 10rfCfll'il fignifie
Cflle le fujct de la propofition eíl: le
patiem,
e'eíl:-il.–
dire, Cfll'il
ea
le terme de l'ailion ou du fentiment
d'un autre :
les méchansjont punis, VOIiS flrez pris par
les umemis; jont punis
,
flrez pris,
font de la forme
paffivc.
Le vcrbc eíl: a la forme ne\ltre, !orfqu'il fignifie
une aétion ou un état 'luí ne palfe point du fujet de la
propofition fur aucun autre objet extérieur; comme
¡¡
palit, il wgraiffe, ilmaigrit, noliS courons, il ba–
dine toltjours, il rú, VOIiS rajeuniffez ,
&c.
5.
Le mode, c'eíl:-a-dire les différentes manieres
d'exprimer ce Cflle le verbe fignifie, ou par l'indi–
eatif qui eíl: le modc direét
&
abrolu ; ou par
I'im–
pératif, ou par le fubjonétif, ou enlln par I'infinitif,
6.
Le fixieme accident des verbes,
c'ea
de mar–
Cfller le tems par des terminaifons particulieres :
j 'aúlle, j'ninlOis ,j'oi aimé, j'avois aimé ,j'aimerai.
7. Le feptieme accident eíl: de marCfller les per–
fonnes grammaticales, c'eíl:-a-dire, les perronnes
relativemcnt a l'ordTe Cfll'elles tiennent dans la for–
mation du dircours, & en ce fens il
ca
évident
qu'il
n'y a Cflle trois perfonnes.
La premiere eíl: celle qui fait le difcours, c'eit.
a-dú'e, celle qui parle
,je chante; je
cíl: la premiere
pCrfOl1Jle, &
ellame
eíl: le verbe
a
la premiere per–
fonne, paree Cfll'il
ea
dit de cette premiere per–
foone.
La feconde perfonne eíl: celle a qui le difcours
s'adrelfe;
tIt
chantes, vous chante{>
c'eíl: la perionne
a
qui I'on parle.
Enfin , lorfc¡ue la per{onne ou la chofe dont on
parle n'eíl: ni a la premiere ni
a
la feconde per{oll–
ne, alors le verbe eíl: dit etre
a
la troifieme per–
fonne;
Pierre écrú, écrú
ea
a
la troifieme pcrfonne:
le
Joleil luit, lllit
eíl:
a
la troifieme perfonne du pré–
(ent de l'indicatif du verbe
lllire,
En Latín & en Grec les perfonnes grammaticallls
fOllt marquécs , auffi-bien que les tems , d'une ma–
niere plus dillinéte, par des temúnairons p31"tÍeu–
lieres,
rrunllAJ)
7J'iTIEI~,
'TtJ7Tlt¿l,
'Tu7r1o¡.ttv,
7U7T1':Tt,
7JtG:'fOtJtrl,
canto, cantas. cantat, cantavi, MntaviJli, calltavir;
cantaveram, cantabo,
&c. au lien qu'en Fran<;ois la
difftrence des terminaifons n'eíl: pas {ol1vent bien
{enfible ;
&
c'eíl: pour cela que nOlls joignons al1X
verbes les pronoms qui marCfllent les perfonnes ,
je.
cllanle,
t1t
e/lames , il dlallte.
8. Le huitieme accident du verbe eíl: la conjugai–
fonoLa conjugaifon eíl: une difuibution ou liHe de
















