
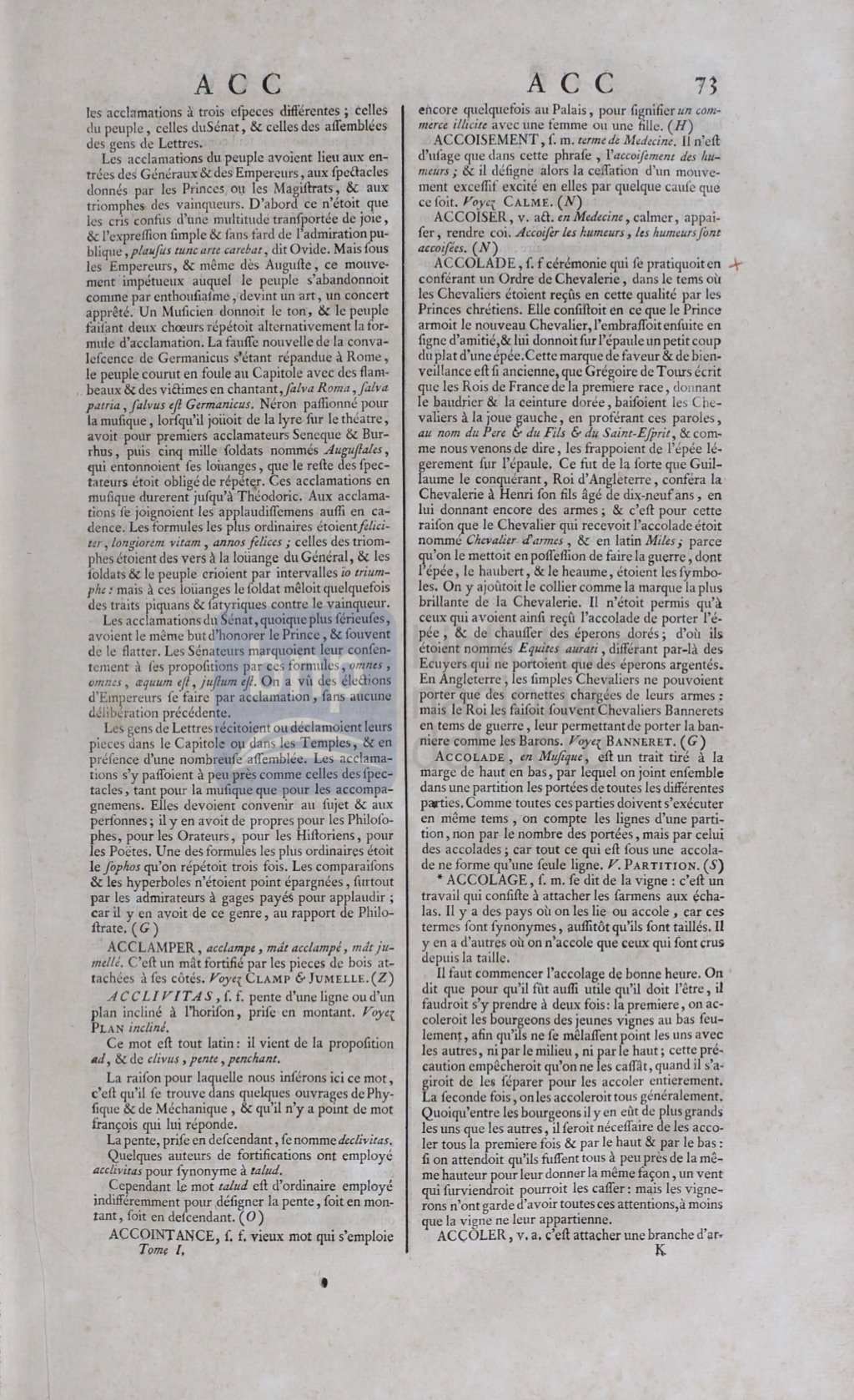
ACC
les aeclamations
a
troís efpeees différentes ; éelles
du peuple, celles duSénat,
&
eelles des alfemhlées
des gens de Lettres.
Les aeclamations <lu pcmple avoient lieu aux en–
trées des Généraux
&
des Empereurs, aux fpeaacles
donnés par les Princes, ol.l les Magi1l:rats,
&
ame
triomphes des vainqueurs. D'abord ce n'étoit que
les eris connls c\'une multitude tranfportée de joie,
&
l'expreffion funple
&
fans fard de l'admiration pu–
blique,
plalLfus tune arte carebat,
dit Ovide. Mais fous
les Empereurs,
&
meme des Augufre, ee mOllve–
ment impétueux auquel le peuple s'abandonnoit
eomme par enthouíiaíme, devint un art, un eoncert
appreté. Un Muíieien dOllnoit le ton,
&
le peuple
faiJant denx ehreurs répétoit alternativement la for–
mule d'aeclamation. La fauífe nonvelle de la eonva–
lefcenee de Germanicus s'étant répandue aRome,
le peuple coumt en foule au Capitole avee dcs f1am–
beaux
&
des viaimes en chantant,falva
Roma,falva
patria, falvus ejl Germanicus.
Néron paffionllé [lour
la mufique, lorfqu'il joiioit de la Iyre nlr le théatre,
avoit pOllT premiers acclamateurs Seneqlle
&
Bur–
rhus, puis cinc¡ mille íoldats nornmés
Au~Jlales,
qui entonnoient fes loitan&es, que le refre des fpec–
tateurs étoit obligé de répeter. Ces acclamations en
mufique durerent ju[qu'a Théodonc. Aux aeclama–
tions
[e
joignoient les applaudiífemens auffi en ca–
dence. Les formules les plns ordinaires étoientfelici–
ur, longwrem vitam
,
annos felices;
celles des triom–
phes étoient des vers
a
la loiiange dn Général,
&
les
[oldats
&
le peuple crioient par intervalles
/0
trium–
¡he:
m.ais
a.
ces loiian.$es I.e foldat meloit
qu~lquefois
des tralts plquans
&
latynques contre le vamquenL
Les acclamations du Sénat,quoique plus férieu[es,
avoient le meme butd'honorer le Prince,
&
fouvent
de le f1atter. Les Sénateurs marquoient l.eur confen–
tement a les propolitions par ees formules,
omnes ,
omlleS, l1u!uum
efl,
jujlum
efl.
On a vii des éleaiolls
d'Empereurs fe faire par acclamation, fans ancune
déliberation précédente.
Les gens de Lettresrécitoient ou déclamoient leurs
pieces dans le Capitolc ou dans les Temples,
&
en
préfence d'une nombreufe aífemblée. Les acclama–
tions s'y paífoient a peu pres comme celles des fpec–
tacles, tant pour la mulique que pour les accompa–
gnemens. Elles devoienr convenir au [ujet
&
anx
perfonnes; il
Y
en avoit de propres pour les Philofo–
phes, pour les Orateurs, pour les Hifroriens, pour
les Poetes. Une des formules les plus ordinaires étoit
le
fophos
qu'on répétoit !rois fois. Les comparaifons
&
les hyperboles n'étoient point épargnées, furtout
par les admirateurs
a
gages payéS ponr applaudir ;
car il y en avoit de ce genre, au rapport de Philo–
ftrate.
(G)
ACCLAMPER,
acclampe, mde acclampé, mátju–
mellé.
C'eí!: un mat fortifié par les pieces de bois at–
tachées a fes cotés.
Voye{
CLAMP
&
JUMELLE.(Z)
A
CC
LIV ITAS,
f. f. pente d'un!;! Iigne ou d'un
plan incliné
a
l'horifon, prife en montant.
V~e{
PLAN
in.cliné.
Ce mot efr tout latin: il vient de la propolition
Ild,
&
de
clivus ,pente ,penchant.
La raifon pour laquelle nous inférons iei ce mot ,
c'eí!: qu'il [e trouve dans quelques ouvrages dePhy–
fique
&
de Méchanique ,
&
qu'il n'y a point de mot
francrois qui luí réponde.
La pente,
pri.feen defeendant, fe nomme
declivitas.
Quelques auteurs de fortifications ont employé
acclivitas
pour [ynonyme
a
talud.
Cependant
le
mot
talud
efr d'ordinaire employé
indiJféremment pour ,déligner la pente, foit en mon–
¡ant, foit en defcendant.
(O)
ACCOINTANCE, f. f. vieux mot qui s'emploie
Tome 1,
ACC
73
encore quelquefois au Palais, pour lignifier
un cóm–
merce ilticiee
avee une femme
011
une filie.
(H)
ACCOISEMENT,
f.
m.
terme
dt
Medeáne.
II n'ea
d'uíage que dans cette phrafe )
l'accoiflment des lIu–
meurs;
&
ü
déligne alors la eeffation d'un mouve–
ment cxcetrif excité en elles par quelque caufe que
ce foil.
Voye{
CALME.
(N)
ACCOISER, v. aa.
en Medecine,
calmer, appai–
fer, rendre coi.
Accoiflr les humeurs, les lIumeursJont
accoifées.
(N)
ACCOLADE,
f.
f cérémonie <¡ui [e pratiquoiten
...f"
conférant un Ordre de Chevalerie, dans le tems
011
les Chevaliers étoient recrlls en cette qualité par les
Princes ehrétiens. Elle confilloit en ce que le Prince
armoit le nouveau Chevalier,I'embrafi"oiten[uite en
ligne d'amitié,& lui donnoit[ur
['~paule
un petitcoup
du plat d'uneépée.Cette marque de faveur &de bien–
veillance efr
Ii
aneienne, que Grégoire de Tours écrit
que les Rois de France de la premiere race, donnant
le baudrier & la ceinture dorée, baifoient les Che–
va1iers
a
la joue gauche, en proférant ces paroles,
au nom du Pere
&
du Fils
&
du Saint-EJPrie,
& com-
me nous venons de dire, les frappoienr de I'épée lé–
geremeht fur l'épaule. Ce nlt de la forte que Guil–
¡aume le eonquéranr, Roi d'Angleterre, conféra la
Chevalerie
a
Henri ron fils agé de dÍJ(-neufans, en
lui donnant encore des armes; & c'efr pour cette
raifon 9ue le Chevalier qui reeevoit l'accolade étoit
nomme
C!u.valier d'nnnes,
&
en latin
Miles;
parce
qu'on le mettoit en poífeffion de faire la guerre, dont
l'épée, le haubert, & le heaume, étoient les fymho–
les. On y ajoutoit le collier comme la marque la plus
brillante de la Chevalerie.
Il
n'élOit permis qu'a
ceux qui avoient ainli recrll I'accolade de porter l'é–
pée,
&
de chauífer des éperons dorés; d'oll ils
étoient nommés
E'luites aurati,
dilférant par-la des
Ecuyers qui ne portoient que des éperons argentés.
En Angleterre, les fimples Chevaliers ne pouvoient
porter que des comettes chargées de leurs armes:
mais le Roi les faifoit fouvcnt ChevaLiers Bannerets
en tems de guerre, leur permettantde porter la ban–
niere comme les Barons.
V
~e{
BANNERET.
(G)
ACCOLADE,
en M/iz'lue,
eíl: un trait tiré a la
marge de haut en bas, par leque! on joint enfemble
dans une partition les portées de toutes les différentes
parties. Comme toutes ces parties doivent s'exécuter
e.n meme tems , on compte les lignes d'une parti–
tlon, non par le nombre des portées, mais par celU¡
des accolades; car tout ce qui efr fous une accola–
de ne forme qu'une feule ligne.
V.
PARTlTlON.
(S)
*
ACCOLAGE,
f.
m. fe dit de la vigne : c'efr
un
travail qui eonfú!:e a attacher les farmens aux écha–
las.
Il
y a des pays
Ol!
on les lie ou accole, ear ces
tem1es font [ynonyrnes, auffitot qu'ils [ont taillés.
Il
yen a d'autres
Gil
on n'accole que ceux qui [ont
erus
depuis la taille.
Il
faut commencer l'accolage de bonne heure. On
dit que pour qu'il
ñu
auffi utile qu'il doit l'etre,
il
faudroit s'y prendre a deux fois: la premiere, on ac–
coleroit les bourgeons des jeunes vignes au bas [eu–
lement, afin qu'ils ne [e melalfent point les uns avec
les autres, ni par le milieu, ni par le haut; cette pré–
caution empecheroit qu'on ne les calfat, quand il s'a–
giroit de les [éparer pour les accoler entierement.
La feconde fois , onles accoleroit touS généralement.
Quoiqu'entre les bourgeons il y en eut de plus grands
les uns que les autres, il [eroit néceífaire de les aceo–
ler tous la premiere fois
&
par le haut & par le bas :
íi on attendoit qu'ils nltrent lOns a peu pres de la me–
me hauteur pour leur donner la meme facron , un vent
qui furviendroit pourroit les calfer: mais les vigne–
roas n'ont garde d'avoir toutes ces attentions,a moins
que la vigne ne leur appartienne.
ACCOLER, v. a. ,'cfr attacher une branche d'¡tr
7
K
















